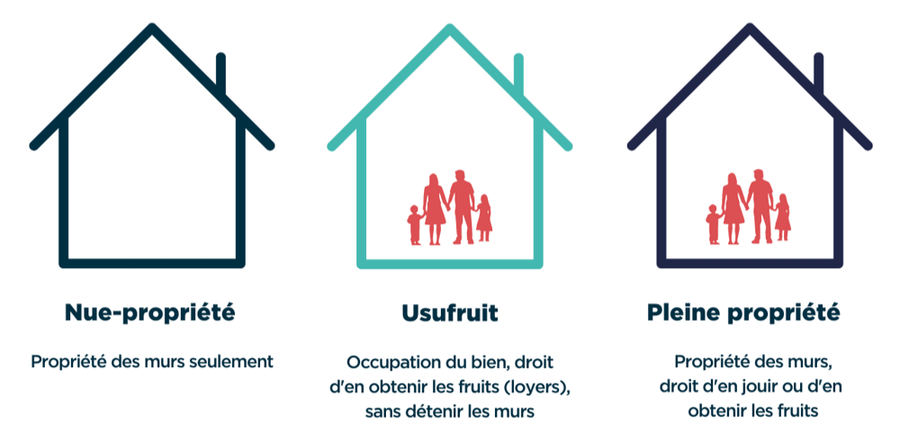Dans une certaine mesure, l’exercice du commentaire d’arrêt emprunte à la dissertation, ainsi qu’au cas pratique. À l’instar de celle-là, le commentaire est une réflexion théorique débouchant sur une analyse du droit positif ; comme celui-ci, le commentaire a pour objet un cas particulier, une affaire déterminée. Aussi n’est-il pas rare de rencontrer des commentaires confinant tantôt à la dissertation, tantôt au cas pratique. Dans le premier cas, l’étudiant s’inspire du thème général de l’arrêt pour livrer ses connaissances. Ce faisant, il part de la décision pour se désintéresser d’elle, trahissant sa probable incompréhension de l’espèce. La plupart des développements seront alors qualifiés de « hors sujet » par le correcteur. Dans le second cas, l’étudiant spécule sur les faits d’espèce et néglige la décision proprement dite. Cette démarche procède généralement d’un défaut de connaissance, et la copie sera fréquemment taxée de « paraphrase ».
Ces deux écueils traduisent l’ambivalence du commentaire d’arrêt, entre le général et le particulier, entre l’abstrait et le concret. Cette singularité doit précisément guider le commentateur dans son entreprise.
D’une part, l’exposé des connaissances n’est pertinent que dans la mesure où il éclaire le lecteur sur la compréhension critique de l’arrêt. D’autre part, la référence à l’espèce n’est utile que dans la mesure où elle sert l’analyse de la décision et son insertion dans l’évolution du droit positif.
En résumé, la décision soumise à commentaire n’est pas l’occasion d’une récitation de cours dénuée de toute réflexion personnelle, ni le prétexte à une analyse dépouillée de matériaux spécifiques et techniques.
Cela étant précisé, nous proposons une méthode du commentaire d’arrêt jalonnée par cinq étapes chronologiques. Pour plus de simplicité nous la consacrons au commentaire d’arrêts rendus par la Cour de cassation.
1- La lecture de l’arrêt
Loin d’être passive, la lecture de la décision est une phase de repérage, voire de fouille systématique. L’étudiant portera son attention respectivement sur la forme et le fond de la décision.
1.1 La forme
Cette étape est généralement mésestimée par les étudiants. Elle offre pourtant d’éviter bien des contresens et de cerner précisément le sens et la portée de la décision. Les éléments à relever sont les suivants :
- La date de l’arrêt. Elle permet de situer d’emblée la décision dans l’évolution du droit positif. La précision est importante, surtout en présence d’un arrêt ancien ou d’un arrêt d’espèce. Elle est également indispensable pour déterminer si l’arrêt constitue un revirement de jurisprudence, ou encore si la solution a été consacrée postérieurement par une disposition législative. Concrètement, l’étudiant pourra d’ores et déjà se poser les questions suivantes : « la solution de l’arrêt est-elle toujours en vigueur ? » ; « la solution a-t-elle été ou vat- elle être démentie par la suite ? ».
- La juridiction. Par hypothèse, la décision émane de la Cour de cassation. Mais il faut préciser : « s’agit-il de la Chambre criminelle ou de la chambre civile ? » ou encore, « la Cour de cassation statue-t-elle en chambre mixte ou en Assemblée plénière ? ». Cette information est précieuse pour déterminer la portée de l’arrêt. Ainsi, une décision rendue par l’Assemblée plénière a une valeur considérable puisqu’elle tranche une divergence de positions entre juridictions et pose un principe général. Il peut arriver également que la première et la troisième chambre civile donnent des réponses opposées au même problème de droit. Il est donc impératif de déterminer si la décision analysée confirme cette opposition ou signifie, au contraire, le ralliement d’une chambre à l’autre.
- La technique de cassation. C’est le point le plus délicat. Il ne doit cependant pas heurter l’étudiant dans la mesure où il est indispensable à la compréhension de l’arrêt. Pour l’essentiel, il faut tout d’abord repérer si l’arrêt est de cassation ou de rejet, puis si l’on est en présence d’un arrêt d’espèce ou de principe.
- Arrêt de cassation ou de rejet
L’arrêt de cassation. Schématiquement, la structure de l’arrêt de cassation se présente comme suit : le visa des textes en cause (obligatoire), un « chapeau » énonçant un principe général (facultatif), les faits et la procédure ayant aboutie à la décision attaquée, la décision attaquée, les raisons pour lesquelles l’arrêt encourt la cassation, et enfin le dispositif qui énonce la cassation et désigne la juridiction de renvoi. Si l’arrêt est de cassation, on prendra soin de relever les cas d’ouverture à cassation. On en rencontre principalement deux qu’il convient de distinguer. Il y a un défaut de base légale lorsque la motivation des juges du fond est insuffisante pour que la Cour de cassation exerce son contrôle et constate la conformité de la décision à la loi. Un tel arrêt est signalé par des formules du type : « la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision… ». La Cour de cassation vise alors la disposition dont l’application n’est pas justifiée et indique les éléments que les juges auraient du rechercher avant de se prononcer. Ce qu’il importe de retenir, c’est qu’en reprochant aux juges du fond de n’avoir pas recherché toutes les conditions d’application du texte visé, la Cour de cassation peut préciser indirectement ces conditions, ce qui confère à la solution une portée considérable. Il est également fréquent de rencontrer des arrêts de cassation pour violation de la loi. Dans cette hypothèse, et contrairement à la précédente, la cour régulatrice a trouvé dans la décision censurée les éléments de fait ou de droit lui permettant d’assurer son contrôle. Mais au terme de ce contrôle, elle constate que les juges du fond ont mal appliqué la disposition en cause. En présence d’un tel arrêt, il faut s’attendre à ce que la Cour de cassation livre son interprétation du texte visé. Celle-ci est formulée dans le « chapeau » qui coiffe les autres motifs de l’arrêt.
L’arrêt de rejet. En principe, l’arrêt de rejet ne comporte pas de visa, ni d’attendu de principe en tête de l’arrêt. Il est généralement composé d’un exposé des faits, un exposé de la procédure et de la décision attaquée, un résumé du pourvoi, la réfutation du pourvoi précédée de l’expression « Mais attendu que ». L’arrêt de rejet présente habituellement moins d’intérêt que l’arrêt de cassation pour l’évolution de la jurisprudence. En réalité, cela dépend du motif qui fonde le rejet du pourvoi. Il se peut que la Cour de cassation n’exerce aucun contrôle sur la qualification des faits et se réfère à « l’appréciation souveraine des juges du fond ». En pareil cas, il faut comprendre que la Cour régulatrice n’approuve, ni ne désapprouve la qualification donnée par les juges du fond mais se refuse à l’apprécier. Une telle décision ne fait qu’illustrer la difficulté de mise en œuvre de la règle de droit. Au contraire, il se peut que la Cour de cassation contrôle la qualification litigieuse, tel un troisième degré de juridiction. Cette démarche est reconnaissable par l’emploi de formules telles que : « la cour d’appel a pu estimer… », ou « a justement déduit de ces énonciations… ». Dans ce cas, la Cour de cassation approuve la position des juges du fond, tout particulièrement lorsqu’elle recourt à l’expression : « la cour d’appel décide à bon droit ». L’interprète doit donc rechercher les critères retenus par la Cour de cassation pour admettre ou exclure la qualification en cause, en reprenant le raisonnement des juges du fond.
- Arrêt d’espèce ou de principe
L’arrêt de principe. L’arrêt de principe est celui qui établit une règle générale et abstraite. La solution vaut alors comme précédent. Il s’agit normalement d’un arrêt de cassation puisque le principe est énoncé dans le « chapeau » qui suit le visa. Cependant, un arrêt de rejet peut être de principe. Simplement, le « chapeau » figure à l’intérieur, et non en tête de l’arrêt. Quelle que soit la nature de la décision, il importe donc de repérer l’énoncé d’un principe général et abstrait afin de déterminer si l’on est ou non en présence d’un arrêt de principe. Plus généralement, il faut rechercher si la question posée est une question de principe pour mesurer l’importance de la réponse fournie par la Cour de cassation.
L’arrêt d’espèce. L’arrêt d’espèce est celui dont la solution est justifiée par les faits d’espèce. Elle n’est donc pas destinée à servir de modèle pour des décisions ultérieures. L’absence de chapeau, d’attendu de principe, signale l’arrêt d’espèce. Cependant, il se peut qu’une décision contienne un « faux chapeau », c’est-à-dire un attendu qui reprend littéralement la disposition du visa, sans rien ajouter à son interprétation. Par exemple, une décision vise l’article 2279 du Code civil, et le chapeau énonce uniquement : « Attendu qu’en fait de meuble, la possession vaut titre ». Dans cette hypothèse, l’arrêt n’apporte rien que la disposition visée ne nous donne déjà.
1.2 Le fond
Après avoir lu plusieurs fois l’arrêt qui lui est soumis, l’étudiant s’attachera à repérer le conflit en présence. En effet, il convient de garder à l’esprit qu’une décision judiciaire est le théâtre d’un différend. Le litige stigmatise des prétentions contradictoires et, en amont, des opinions divergentes. C’est autour d’un rapport antagoniste que se noue la décision et les raisonnements qui la nourrissent. Aussi, au cours de la lecture, l’étudiant peut se poser les questions suivantes : « quel litige doit trancher la Cour de cassation ? » ; « quelles positions sont impliquées dans ce litige ? »
Cette première approche conduit à relever l’intérêt de la décision. Le problème qui est soulevé, la thématique à laquelle il renvoie, les arguments qui sont développés de part et d’autres, et qui cristallisent des considérations pragmatiques comme des implications théoriques, enfin, le choix opéré par la Cour de cassation, sont autant d’éléments qui permettent d’appréhender la question centrale : « en quoi cet arrêt est-il intéressant ? »
Par cette lecture approfondie, l’étudiant pose en quelque sorte des balises. Pratiquement, il soulignera, surlignera ou annotera la décision pour mettre en exergue les points importants. Cependant, à ce stade, il ne s’agit pas d’anticiper ou de précipiter la réflexion d’ensemble qui alimentera les développements.
Si cette présentation de la lecture d’arrêt est volontairement détaillée, c’est pour que rien n’échappe à la vigilance du commentateur. Chaque élément a son importance et doit servir la construction du commentaire. Pour les synthétiser, il convient de procéder à une fiche d’arrêt.
2. La fiche d’arrêt
La fiche de jurisprudence fera l’objet d’une étude ultérieure (voir infra). Il faut la soigner car elle sera notamment utilisée aux fins d’introduction du commentaire. Jusqu’à cette étape, le travail porte strictement sur l’arrêt lui-même. À présent, l’étudiant doit apporter ses connaissances au service de la réflexion qui nourrira le commentaire.
3. La réflexion
En partant de la question de droit préalablement posée dans la fiche d’arrêt, il convient de réunir les connaissances qui s’y rapportent. Parallèlement, l’étudiant peut livrer ses remarques personnelles, des ébauches de raisonnement qui lui semblent pertinents. Mieux vaut être spontané, la sélection des éléments utiles sera opérée par la suite.
Pour éviter de partir dans tous les sens et de perdre du temps, il peut être conseillé de procéder de façon systématique. Ainsi, l’étudiant peut dresser au brouillon un tableau comportant les références textuelles, jurisprudentielles, doctrinales, ainsi que les idées diverses. On évitera d’utiliser le code annoté pour faire du remplissage, en rapportant toutes les jurisprudences mentionnées sous les dispositions textuelles.
Ensuite, l’étudiant va utiliser les connaissances qu’il a rassemblées. Il construit l’ébauche du raisonnement qui constitue la substance du commentaire. En répertoriant les idées qu’il compte développer, il peut y associer les références qui seront exploitées dans telle ou telle perspective.
Au terme de cette réflexion, il faut considérer que le contenu du commentaire est défini. Reste à l’organiser de manière rationnelle en déterminant sa structure, c’est-à-dire le plan.
4. Le plan
Dans le fond, le plan se dessine à la lumière de la réflexion qui précède son élaboration. Le plan thématique sera préféré au plan type du genre : sens/portée. Concrètement, le plan doit s’articuler autour des questions de droit antérieurement dégagées. Dans le meilleur des cas, l’arrêt comporte deux moyens, ou deux branches au moyen, permettant de dégager deux questions et donc une partie consacrée à chacune des questions posées. À défaut, il convient de dégager deux thèmes autour d’une même question.
Les deux parties peuvent présenter un intérêt distinct et être traitées de manière autonome. Au contraire, elles peuvent présenter un rapport logique entre elles. Dans ce cas, la première partie sera consacrée au problème dont la résolution engendre le second, lequel sera l’objet de la seconde partie.
Dans la forme, l’étudiant doit impérativement soigner les intitulés. Il est déconseillé d’employer des formes interrogatives ou suspensives du type : I. un principe de responsabilité… / II. …tempéré par des exceptions. De même, on évitera de commencer un intitulé par l’expression suivante : « La Cour de cassation admet le principe… ». Dans cet exemple, on lui substituera : « L’admission du principe… ». La concision est toujours préférable aux formules alambiquées. La fantaisie n’est pas de mise, les objectifs sont la clarté et la cohérence.
Un plan de commentaire comporte deux parties (I / II), elles-mêmes subdivisées en deux sous-parties (A / B). Exceptionnellement, si la décision analysée comporte trois problèmes de droit, on pourra ajouter une troisième partie au plan du commentaire. Dans tous les cas, il est important que le titre d’une partie ou d’une sous-partie reflète clairement son contenu. À la lecture du plan, le correcteur doit immédiatement saisir le cheminement de l’étudiant dans son analyse de la décision.
Une fois le plan bien établi, il est temps de passer à la dernière étape au brouillon avant la rédaction définitive du commentaire.
L’introduction
L’introduction est la seule partie du commentaire qui sera intégralement rédigée au brouillon. Il importe que sa structure soit apparente. C’est pourquoi il est recommandé de passer à la ligne à chaque étape la composant. Voici les éléments qui doivent y figurer :
- L’entrée en matière. C’est tout d’abord une phrase d’accroche, un coup d’archet. Si l’originalité n’est pas proscrite, il faut néanmoins se garder des banalités ou des généralités. Plusieurs possibilités sont envisageables. L’étudiant peut débuter par des considérations extra-juridiques en rapport avec le problème soulevé par l’arrêt (en évoquant, par exemple, l’actualité). Au contraire, il peut directement situer l’arrêt dans son contexte juridique, ou encore faire allusion aux faits de l’espèce de manière anecdotique.
La seconde phrase de l’entrée en matière consiste à amener la décision commentée. On pourra s’inspirer les expressions suivantes : « C’est précisément cette difficulté qu’avait à résoudre la Cour de cassation dans un arrêt du… » ; « C’est ce qu’illustre la décision rendue par la Cour de cassation le… »
- Le résumé des faits. Il figure dans la fiche d’arrêt. On l’introduira par l’expression : « En l’espèce,… ».
- Le résumé de la procédure. Là encore, on reprendra les éléments compilés dans la fiche de jurisprudence.
- Les thèses en présence. Cette étape ne doit pas être négligée ou être confondue avec les deux précédentes. Ce qui souligne, là encore, la nécessité de soigner la fiche d’arrêt.
- La question de droit. Elle n’est pas nécessairement posée sous forme interrogative. On peut l’exprimer par l’affirmative, en l’introduisant par : « Pour la Cour de cassation, il s’agit de savoir si… ».
- La réponse de la Cour de cassation. Dans un premier temps, il est recommandé de décrire et de résumer la réponse apportée par la Cour de cassation à la question posée. Par exemple : « La Cour de cassation répond par l’affirmative, en décidant que… ». C’est également le moment de préciser la technique de cassation utilisée ( arrêt de rejet, cassation pour violation de la loi…) et la qualité de la motivation (précise, lapidaire…). Ensuite, si l’attendu n’est pas trop long, on peut le citer intégralement. L’important est de veiller à ne pas anticiper les développements.
- L’annonce du plan. Mieux vaut éviter de parler à la première personne du pluriel : « Nous allons voir dans une première partie… ». On préférera des formules du type : « Cet arrêt conduit à analyser dans un premier temps… ». Il n’est pas nécessaire de reprendre littéralement les intitulés des parties. L’important est d’annoncer les deux idées qui seront développées, en mentionnant simplement entre parenthèses à quelle partie elles correspondent (I et II ou première partie et deuxième partie).
La rédaction
On veillera respectivement au style et à la présentation du commentaire.
Pour le style, le principe est simple : ce qui s’explique clairement, s’exprime clairement. Autrement dit, des phrases maladroites et pompeuses sont souvent le signe d’un raisonnement fragile ou de connaissances défectueuses. Il faut rechercher la concision et la clarté. Ce n’est pas un exercice de littérature ! Une phrase doit comporter les mots nécessaires pour exprimer une idée, ni plus, ni moins.
Pour la présentation, il faut tout d’abord veiller à aérer l’ensemble du commentaire. Sauter des lignes lorsque l’on passe à une autre partie ou sous-partie, passer à la ligne à l’intérieur des développements pour signaler une nouvelle étape de raisonnement, sont autant d’éléments qui facilitent la lecture du commentaire.
Ensuite, il ne faut pas omettre les phrases d’introduction en début de partie, qui annoncent les deux sous-parties. De même, il ne faut pas oublier les phrases de transition en fin de chaque partie ou sous-partie. Ce sont, en quelque sorte, les passerelles qui relient entre elles chaque partie de l’analyse.
Enfin, il est recommandé de commencer chaque développement en partant de la décision. Par exemple, on citera le pourvoi pour l’analyser, de même pour la décision des juges du fond et la décision de la Cour de cassation. C’est un moyen de « coller » à l’arrêt et de ne pas s’éparpiller.
En conclusion, nous voudrions rappeler qu’une bonne méthode ne remplace pas l’entraînement. Pour progresser, il faut multiplier les exercices et ne pas hésiter à rechercher un plan chaque fois que l’on doit analyser une décision en travaux dirigés. Il s’agit d’une gymnastique d’esprit, une logique propre au droit, que seule une pratique régulière permet d’acquérir.