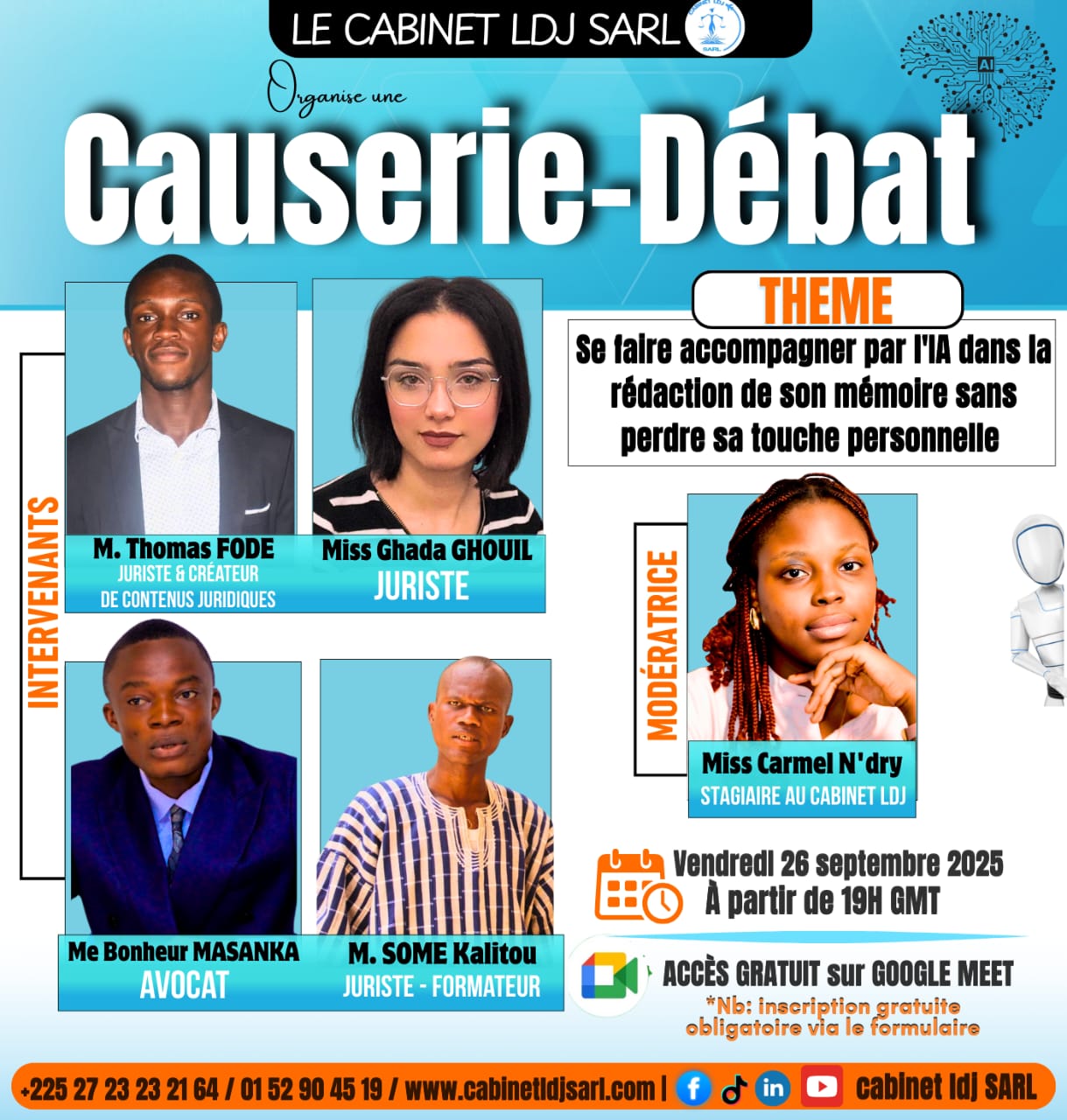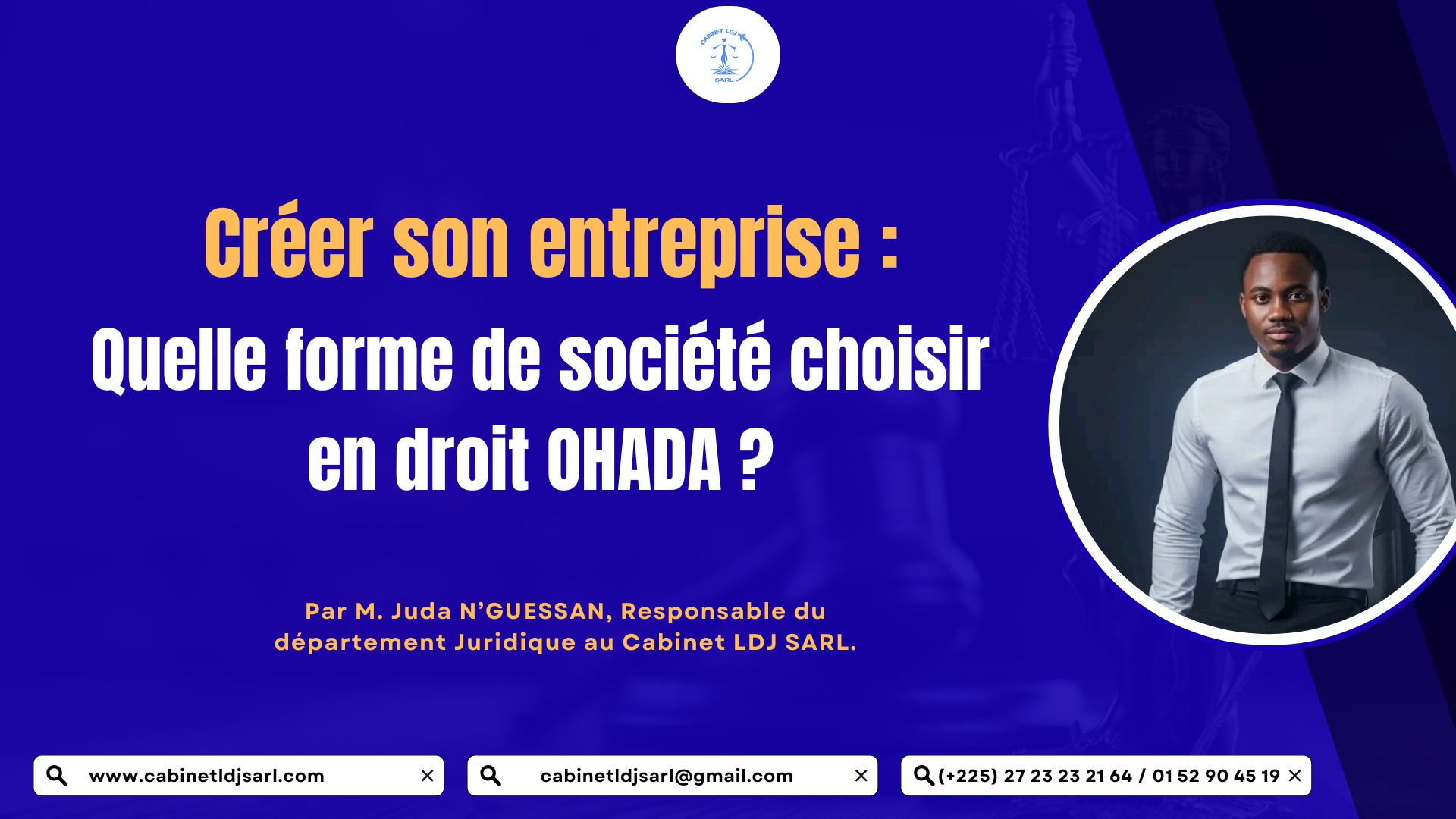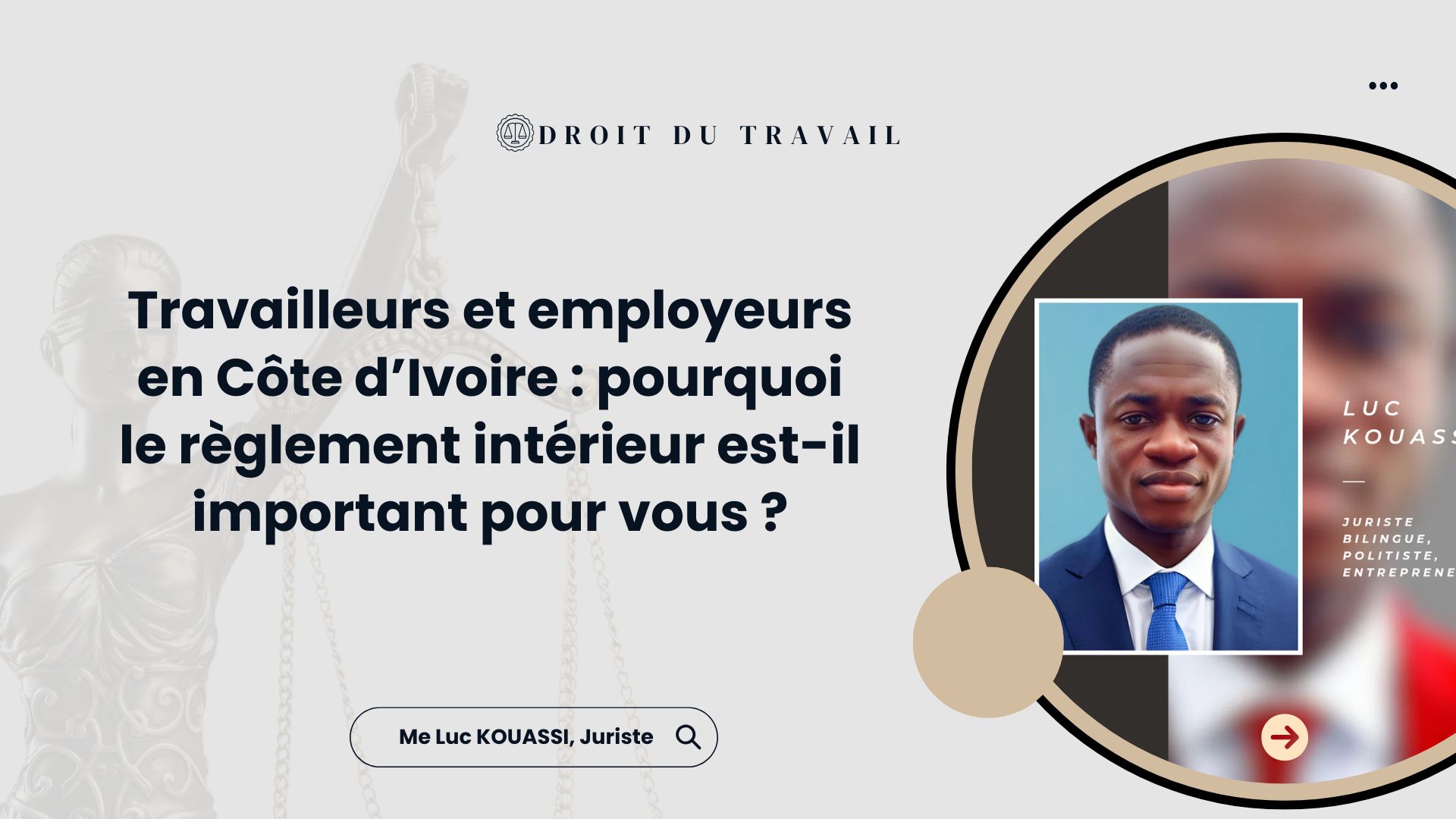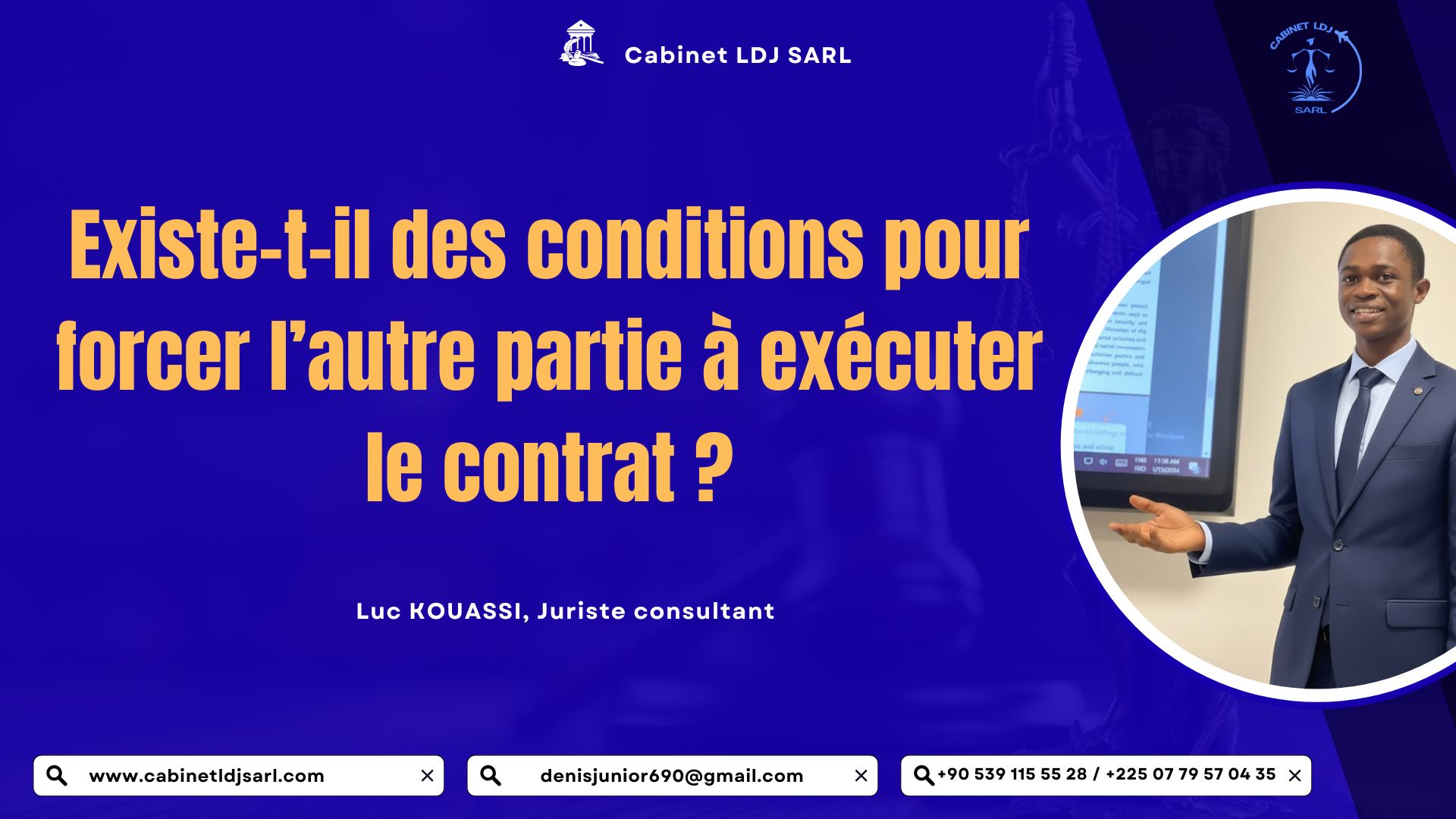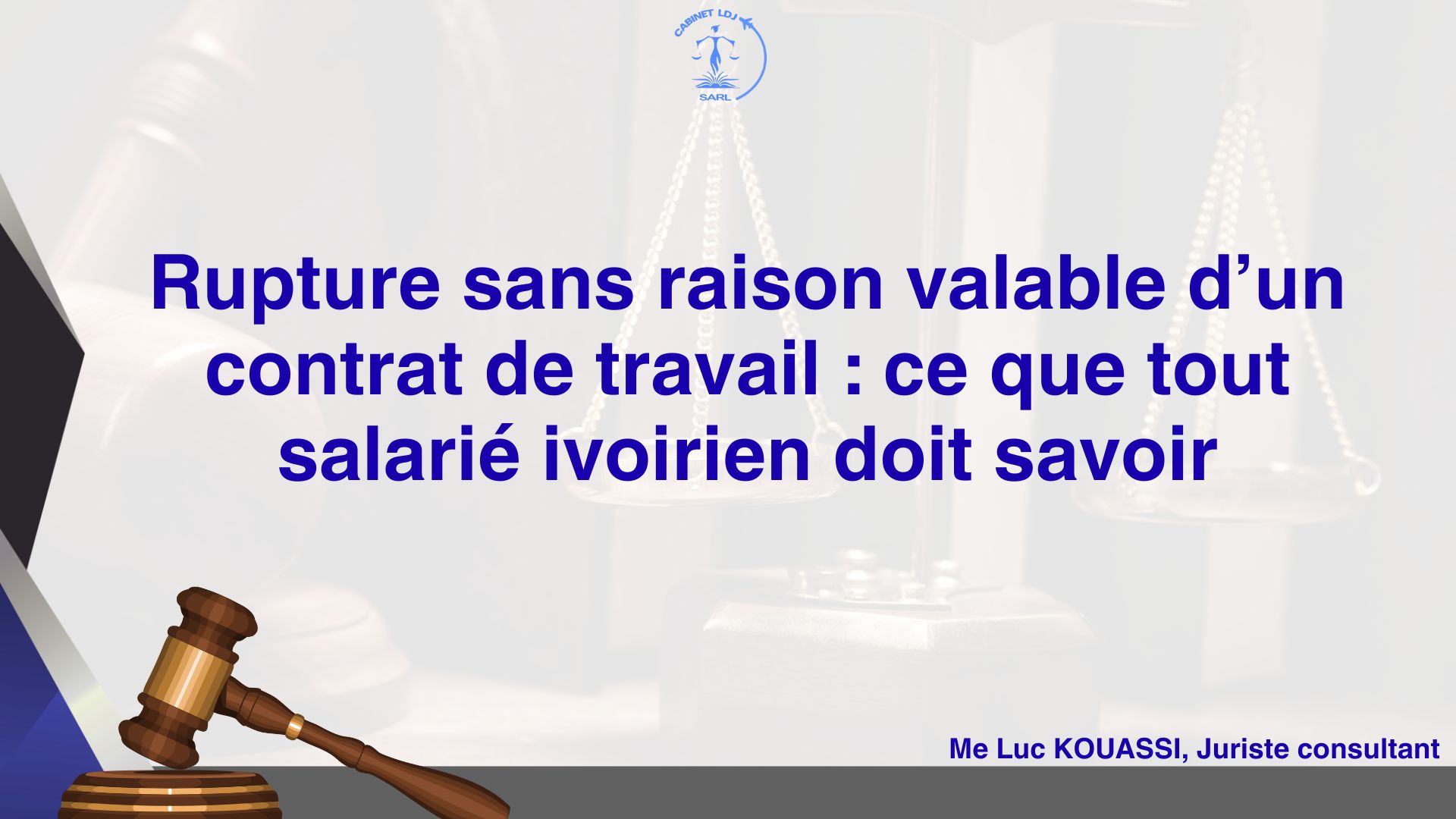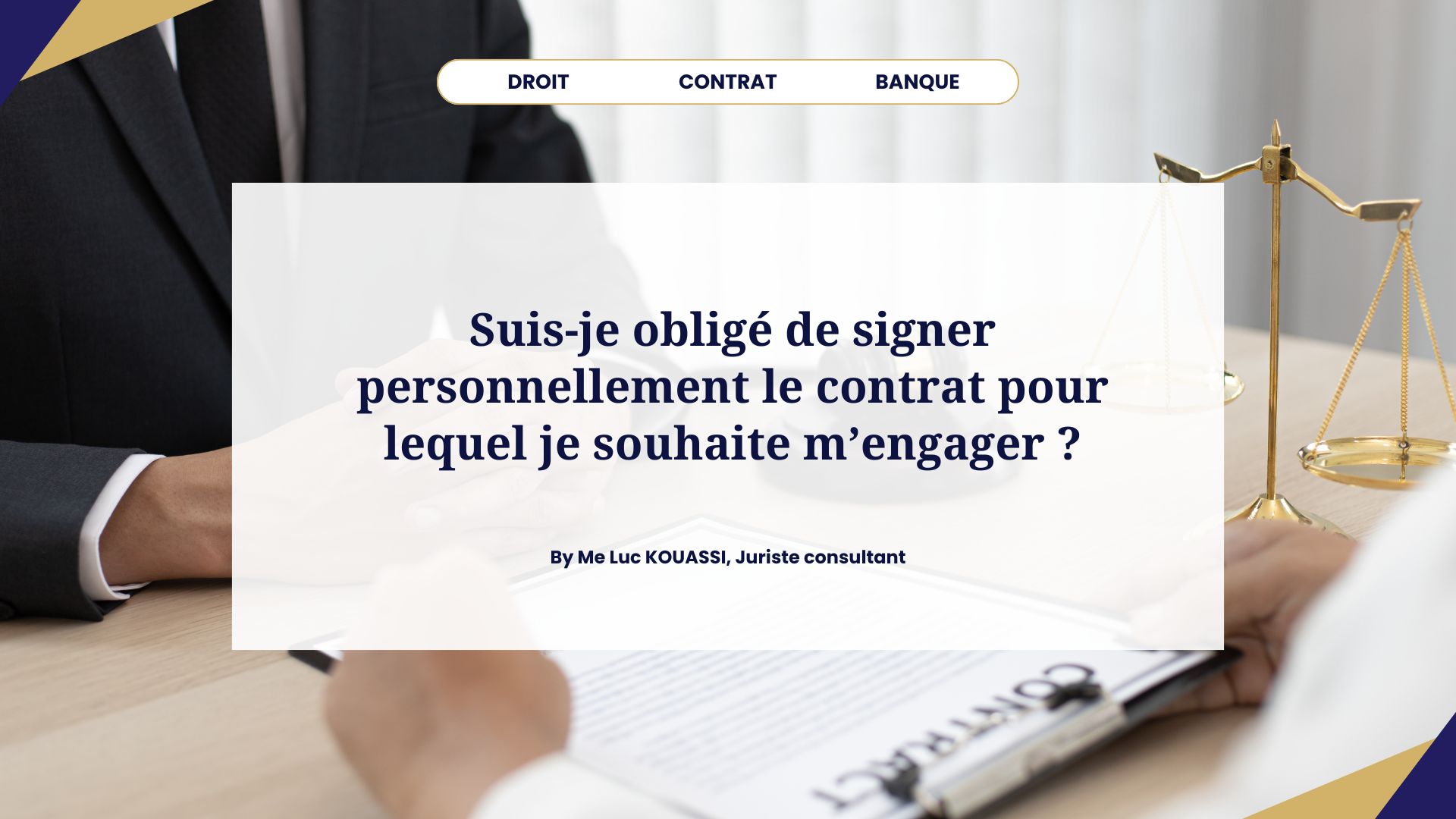Le contrat, en tant qu’accord de volontés destiné à produire des effets de droit, ne se réduit pas à sa formation : il doit encore être exécuté. Comme le souligne la doctrine classique, « le contrat n’a de véritable utilité que dans la mesure où il est suivi d’exécution »[1]. Or l’exécution des obligations ne va pas toujours de soi. Les parties peuvent se heurter à la mauvaise volonté du débiteur, à son inertie, à des stratégies dilatoires, voire à une incapacité matérielle d’honorer ses engagements. La question qui s’impose alors est décisive pour la sécurité des transactions : dans quelles conditions le créancier peut-il contraindre son débiteur à exécuter le contrat, et notamment obtenir une exécution forcée en nature de la prestation convenue ?
Le droit positif français et le droit ivoirien, héritiers du modèle napoléonien, admettent en principe ce recours. En France, depuis l’ordonnance du 10 février 2016, le Code civil prévoit que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier »[2] ; ledit code ouvre, après mise en demeure, la voie d’une exécution par substitution aux frais du débiteur[3]. En Côte d’Ivoire, si le Code civil n’a pas repris textuellement ces innovations, la force obligatoire des conventions[4] et l’exigence de bonne foi[5] structurent un régime fonctionnellement voisin : le créancier peut obtenir la prestation convenue, à défaut de dommages-intérêts, et le juge veille à la loyauté et à la proportionnalité des remèdes[6]. Dans l’espace OHADA, l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) complète ce socle par un arsenal processuel (injonction de payer, saisies, exécution sur les biens) destiné à garantir l’effectivité des droits reconnus par le droit commun des obligations[7].
Cette faculté d’obtenir l’exécution forcée, évidente sur le papier, n’est pourtant ni automatique ni illimitée. Elle suppose la réunion de conditions de forme et de fond (mise en demeure, possibilité matérielle et juridique, absence de disproportion) et demeure encadrée par des limites d’équité et de bonne foi. La jurisprudence le rappelle avec constance : l’exécution forcée ne doit pas dégénérer en abus, ni conduire à un résultat manifestement injuste au regard de la situation concrète des parties[8]. C’est ce triple mouvement, principe, conditions, limites que l’on se propose d’examiner.
I. Le principe de l’exécution forcée : un droit reconnu au créancier
L’exécution forcée découle directement de la force obligatoire des conventions. En droit français, l’article 1103 du Code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; il en résulte un véritable devoir d’exécution conforme, qui n’est pas un simple vœu pieux mais un impératif susceptible de contrainte. Le Code civil ivoirien, fidèle à la tradition, consacre la même règle à l’article 1134, complété par l’article 1135 sur la bonne foi, qui commande non seulement l’exécution des stipulations expresses, mais encore toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. Autrement dit, l’obligation contractuelle n’est pas optionnelle : le débiteur qui n’exécute pas s’expose à la contrainte du juge.
Cette logique, de droit substantiel, trouve sa traduction processuelle en OHADA : l’AUPSRVE offre au créancier des voies rapides de recouvrement (injonction de payer) et des saisies (conservatoire ou d’exécution) qui permettent de transformer un droit en satisfaction concrète, y compris en l’absence de coopération du débiteur. L’exécution forcée n’est donc pas une faveur ; c’est le corollaire naturel de la force obligatoire.
La Cour de cassation rappelle de longue date que le créancier n’a pas à prouver un préjudice autonome pour obtenir l’exécution en nature : l’inexécution suffit à fonder l’action[9]. Cette approche distingue clairement la sanction-exécution (qui vise la réalisation de la prestation due) de la sanction-réparation (dommages-intérêts), laquelle suppose, elle, l’établissement d’un dommage indemnisable. Le droit ivoirien raisonne pareillement : l’inexécution ouvre droit, en principe, à l’exécution de la prestation convenue ; à défaut ou en sus, à des dommages-intérêts[10]. La logique commune est simple : ce n’est pas parce que le créancier n’a pas encore subi un dommage quantifiable qu’il devrait être privé de la chose même qui lui est due.
II. Les conditions de l’exécution forcée
En droit français, l’article 1221 exige une mise en demeure préalable. Celle-ci peut procéder d’une sommation d’huissier, d’une lettre recommandée avec avis de réception, ou de tout acte non équivoque par lequel le créancier demande l’exécution[11]. La mise en demeure remplit une double fonction : elle « moralise » le recours au juge en offrant au débiteur une ultime chance de s’exécuter spontanément, et elle fixe la date à partir de laquelle les retards et frais imputables au débiteur seront appréciés.
En Côte d’Ivoire, si aucun texte général ne subordonne toujours l’exécution forcée à une mise en demeure formalisée à l’identique, la combinaison des articles 1134 et 1135 (force obligatoire et bonne foi) conduit, en pratique, à exiger un préavis loyal avant toute contrainte judiciaire, sauf urgence manifeste ou stipulation contractuelle contraire. Cette exigence irrigue d’ailleurs l’ensemble du droit OHADA : l’injonction de payer suppose la preuve d’une créance liquide et exigible, et la régularité des significations est une condition de validité des voies d’exécution. Prévenir avant de contraindre est devenu un standard de loyauté procédurale.
La seconde condition tient à la possibilité de la prestation. L’exécution forcée est exclue si l’obligation est devenue objectivement impossible : destruction de la chose déterminée par force majeure, illégalité superveniens rendant l’exécution contraire à la loi, disparition de l’objet pour une cause non imputable au débiteur[12]. C’est le sens constant de la jurisprudence française, que relaie la doctrine ivoirienne : l’impossibilité libère le débiteur de l’exécution en nature, sans nécessairement le décharger de toute responsabilité (il peut rester redevable de dommages-intérêts si l’impossibilité lui est imputable). Pour les obligations intuitu personae (exécution artistique, prestation hautement personnelle), la contrainte en nature est en principe écartée : la substitution heurte la nature même de l’engagement ; le remède sera alors pécuniaire.
Innovation de 2016 en droit français, l’article 1221 introduit un filtre de proportionnalité : le juge peut refuser l’exécution en nature lorsqu’elle imposerait au débiteur de bonne foi un coût manifestement disproportionné au regard de l’intérêt du créancier. Cette clause d’équilibre évite de transformer l’exécution forcée en instrument de harcèlement économique, par exemple, exiger la reconstruction intégrale d’un ouvrage alors qu’une réparation partielle suffit à atteindre l’intérêt contractuel. Le droit ivoirien, bien que dépourvu de texte jumeau, connaît une logique voisine par l’exigence de bonne foi (art. 1135 C. civ.) et par l’évaluation du dommage in concreto (art. 1149 C. civ.) : l’office du juge inclut un pouvoir de modération lorsque la prétention est déraisonnable au regard de l’intérêt réellement protégé. L’OHADA, de son côté, laisse aux juges nationaux l’office d’apprécier, au stade de l’exécution, les mesures les plus adéquates et proportionnées, y compris en suspendant des voies d’exécution manifestement abusives.
III. Les limites de l’exécution forcée : l’abus et la mauvaise foi
L’exécution forcée n’est pas un droit illimité. Le créancier qui l’invoque dans des conditions contraires à l’équité commet un abus de droit. L’affaire fictive Mme VOLTEFACE illustre ce point : réclamer, après dix années de silence et à la suite d’un décès, l’intégralité d’arriérés de rente viagère pour provoquer la résolution au détriment d’une veuve en difficulté traduit un usage dévoyé du droit contractuel. La jurisprudence française sanctionne ces comportements au visa de la bonne foi (art. 1104 C. civ.) et de l’interdiction générale d’abuser de ses droits[13]. En Côte d’Ivoire, la solution serait la même sur le fondement de l’article 1135 (exécution de bonne foi) et de la responsabilité pour abus (faute dans l’exercice d’un droit). L’idée directrice est simple : la lettre du contrat ne peut être actionnée contre son esprit loyal.
Par ailleurs, l’article 1104 du Code civil français impose que les contrats soient « négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’équivalent ivoirien, l’article 1135, formule la même exigence, dont la portée est transversale : information, coopération, absence de manœuvres, refus des chantages procéduraux. La doctrine comme la jurisprudence en font un standard d’évaluation des comportements : un créancier qui a laissé s’installer une situation de confiance ou de tolérance ne peut subitement durcir le ton pour piéger son cocontractant ; un débiteur ne saurait non plus invoquer la bonne foi pour perpétuer une inexécution stratégique[14]. La bonne foi, en ce sens, est le garde-fou qui empêche l’exécution forcée de devenir un outil de persécution.
IV. Les sanctions disponibles en cas d’inexécution
Le panel des remèdes, en droit comparé, est aujourd’hui bien établi et hiérarchisé.
En premier lieu, l’exécution en nature. En France, elle constitue le remède de principe, sous les réserves de l’article 1221 (mise en demeure, impossibilité, disproportion). En Côte d’Ivoire, à défaut de texte spécifique, le principe de force obligatoire (art. 1134) et la responsabilité pour inexécution (art. 1147) permettent au juge d’ordonner la délivrance, la remise conforme, la cessation d’un trouble, ou toute mesure d’exécution conforme à l’économie du contrat.
Ensuite, l’exécution par substitution. L’article 1222 du Code civil français autorise, après mise en demeure, le créancier à faire exécuter lui-même l’obligation aux frais du débiteur, voire à détruire ce qui a été mal fait, sur autorisation judiciaire. En droit ivoirien, même sans texte miroir, l’office du juge et la réparation intégrale du préjudice permettent d’aboutir à des solutions fonctionnellement équivalentes : le juge peut autoriser la passation aux frais du débiteur défaillant, ordonner la remise en état, ou condamner le débiteur à avancer les coûts nécessaires.
En outre, la résolution du contrat. En France, les articles 1224 et suivants organisent la résolution judiciaire, unilatérale après mise en demeure restée vaine, ou de plein droit en présence d’une clause résolutoire. En Côte d’Ivoire, l’article 1184 du Code civil (dans son économie classique) admet la résolution pour inexécution, avec un pouvoir d’appréciation du juge sur la gravité du manquement. Dans les deux droits, la résolution anéantit rétroactivement le contrat et ouvre droit aux restitutions corrélatives.
Aussi, les dommages-intérêts. En France, l’article 1231-1 (ex-1147) pose le principe de la responsabilité contractuelle pour inexécution, retard ou mauvaise exécution. En Côte d’Ivoire, l’article 1147 joue ce rôle, et l’article 1149 encadre l’évaluation du préjudice indemnisable (perte subie et gain manqué), sous le contrôle du juge. L’allocation de dommages-intérêts peut se cumuler avec l’exécution en nature lorsque celle-ci n’efface pas entièrement le préjudice (retard, frais supplémentaires, atteinte à l’image).
Enfin, les voies d’exécution OHADA. Quel que soit le droit national applicable à l’obligation, la réalisation concrète des condamnations pécuniaires et de certaines obligations de faire passe, en pratique, par les procédures de l’AUPSRVE : saisie-attribution des comptes, saisie-vente, saisie des rémunérations, mesures conservatoires, exécution sur les immeubles. La cohérence du triptyque droit substantiel, décision, exécution suppose de maîtriser ces leviers procéduraux, faute de quoi la victoire judiciaire demeure symbolique.
V. Cas pratique
- Faits: Il y a une dizaine d’années, Mme VOLTEFACE a vendu à son petit-fils et à l’épouse de celui-ci une charmante maison située en plein cœur de la Puisaye, près d’une jolie petite rivière. Aux termes du contrat, Mme VOLTEFACE conservait l’usufruit (Juridiquement, il est possible de « diviser » le droit de propriété en deux (la propriété devient alors usufruit et nue-propriété)). Dans cette optique, l’usufruit est le droit pour une personne d’utiliser un bien et d’en percevoir les fruits (des fruits naturels mais aussi civils comme des loyers par exemple) sans avoir la possibilité d’en disposer (le vendre notamment). Ce dernier pouvoir n’appartient qu’au seul nu-propriétaire)) et bénéficiait du paiement comptant d’un prix de 20 000 000 FCFA ainsi que d’une rente viagère (Il s’agit d’une somme d’argent versée jusqu’à la mort de celui qui en bénéficie), versée mensuellement, à laquelle était attachée une clause résolutoire en cas de défaut de paiement. Son petit-fils ayant récemment succombé à un tragique accident de la circulation, Mme VOLTEFACE, n’appréciant guère sa veuve, lui réclama le paiement de la totalité de la rente viagère qui n’avait jusque-là jamais été réclamée. La jeune veuve, qui avait la conviction que la rente ne serait jamais réclamée en raison des liens d’affection qui les unissaient, ne s’y était clairement pas préparée. En outre, n’étant pas en mesure d’effectuer un quelconque versement compte tenu de ses faibles revenus, elle répondit négativement à la mise en demeure adressée par la vieille femme. Face à cette réponse, cette dernière saisit le tribunal pour que la vente soit résolue en vertu de la clause résolutoire insérée dans le contrat et ainsi récupérer la pleine propriété.
- Analyse : Nous avons vu que l’exécution forcée d’un contrat ne devait pas dégénérer en abus. Dans le cas présent, la vieille femme n’a réclamé le paiement de la rente viagère que dix ans après la conclusion du contrat, suite au décès de son petit-fils, et visiblement en raison d’une mésentente familiale récente. Au surplus, elle devait bien connaître les difficultés financières de la jeune veuve. En réclamant d’un seul coup la totalité de l’arriéré, elle savait pertinemment qu’elle ne pourrait pas payer et que la clause résolutoire entraînerait de ce fait l’anéantissement du contrat à son profit. Mme VOLTEFACE a manifestement exigé de mauvaise foi l’application du contrat. En l’espèce, le juge pourrait donc bien refuser de faire jouer la clause résolutoire.
Conclusion
L’exécution forcée constitue la garantie cardinale de l’effectivité contractuelle. Elle prolonge la force obligatoire des conventions (art. 1103 C. civ. fr. ; art. 1134 C. civ. ivoir.) et se nourrit d’un principe directeur de bonne foi (art. 1104 C. civ. fr. ; art. 1135 C. civ. ivoir.). En France, la réforme de 2016 a clarifié la physionomie du remède en posant trois verrous : mise en demeure, possibilité de la prestation, proportionnalité économique (art. 1221), complétés par l’outil pratique de l’exécution par substitution (art. 1222). En Côte d’Ivoire, même sans reprise textuelle, les équivalents de fond jouent à plein : la force obligatoire, la bonne foi et la réparation intégrale guident l’office du juge, tandis que l’OHADA fournit l’infrastructure procédurale d’exécution.
Rien, toutefois, n’autorise à instrumentaliser l’exécution forcée contre l’esprit du contrat. La mauvaise foi et l’abus de droit en marquent les limites. La figure de Mme VOLTEFACE en est l’illustration paradigmatique : le juge, gardien de l’équilibre contractuel, refuse que la lettre d’une clause serve des fins ouvertement déloyales. C’est dans cette dialectique rigueur du lien et justice contractuelle que s’inscrit le droit contemporain des remèdes : l’exécution en nature demeure la règle, mais une règle raisonnable, tempérée par la loyauté, l’équité et la proportionnalité. Ainsi se concilient, dans les systèmes français et ivoirien, les impératifs de sécurité des échanges et la protection contre les dévoiements, sous le regard attentif des mécanismes OHADA qui en assurent la concrétisation.
Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : (+225) 27 23 23 21 64 / 05 96 11 90 94 / 01 52 90 45 19 (WhatsApp).
Achetez le Kit LDJ SMART PRO (+1000 Modèles de contrats, lettres, courriers…) au prix de 20500 FCFA en suivant ce lien : https://cabinetldjsarl.com/formation/kit-ldj-smart-pro-1000-modeles-de-contrats-lettres-courriers/
Me Luc KOUASSI
Juriste Consultant Polyglotte| Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.
denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28
[1] F. Terré et Y. Lequette, Droit civil : Les obligations, Dalloz, 12ᵉ éd., 2022, p. 512.
[2] Code civil francais, art. 1221.
[3] Ibid., art. 1222
[4] Code civil ivoirien, art. 1134.
[5] Ibid., art. 1135.
[6] Ibid., art. 1184 ; Ph. Malaurie & L. Aynès, Droit des obligations, LGDJ, 13ᵉ éd., 2024, p. 604.
[7] Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE), 10 avr. 1998, révision 2010 puis le 17 oct. 2023 ; v. not. injonction de payer (art. 1 s.), saisies conservatoires et d’exécution (art. 54 s.).
[8] Cass. 1re civ., 10 juill. 1995, n° 93-18.632 (rappel de l’encadrement par l’équité) ; sur la fonction « correctrice » de la bonne foi, v. J.-L. Aubert & É. Savaux, Droit civil : Les obligations – L’acte juridique, Sirey, 18ᵉ éd., 2020, p. 287.
[9] Cass. 3e civ., 4 déc. 1991, n° 90-13.206 : l’inexécution suffit à fonder l’exigence d’exécution en nature ; B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, 9e édition, 2019, 602 p.
[10] Code civil ivoirien, art. 1147 et 1149 C. civ. ivoirien, sur la responsabilité contractuelle et l’évaluation du préjudice
[11] C. civ. fr., art. 1221 ; pour la mise en demeure, v. aussi C. civ. fr., art. 1344 ; en pratique, sommation d’huissier ou LRAR. Pour l’exigence de loyauté préalable en droit ivoirien, v. C. civ. ivoir., art. 1135 (bonne foi).
[12] Cass. 1re civ., 6 mars 1990, n° 88-17.729 (impossibilité objective d’exécution) ; comp. pour l’issue pécuniaire de l’inexécution en droit ivoirien, C. civ. ivoir., art. 1147 et 1149.
[13] Cass. 1re civ., 10 juill. 1995, n° 93-18.632
[14] C. civ. fr., art. 1104 (bonne foi) ; C. civ. ivoir., art. 1135 ; v. F. Terré et Y. Lequette, op. cit., p. 567 s. (bonne foi, loyauté, coopération).