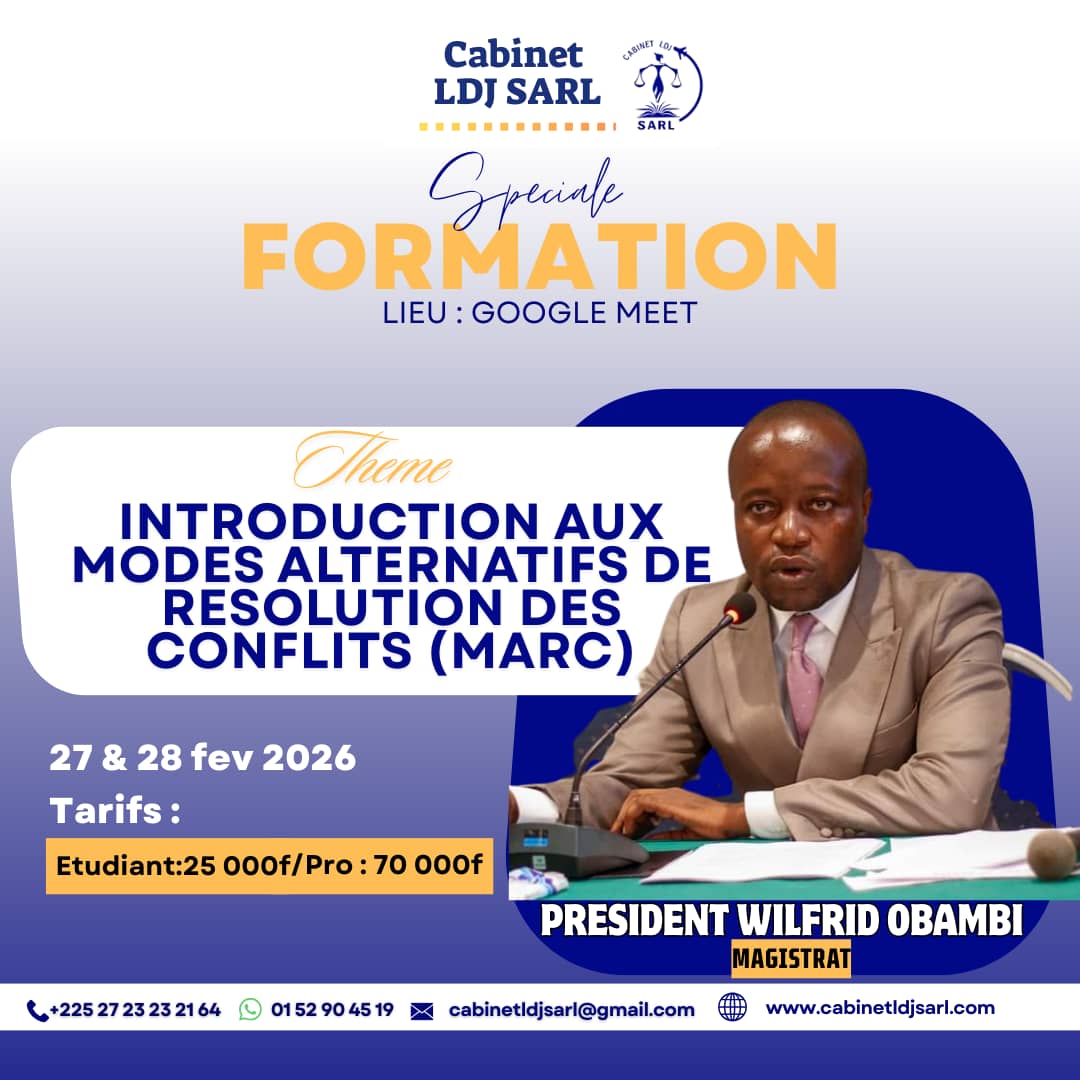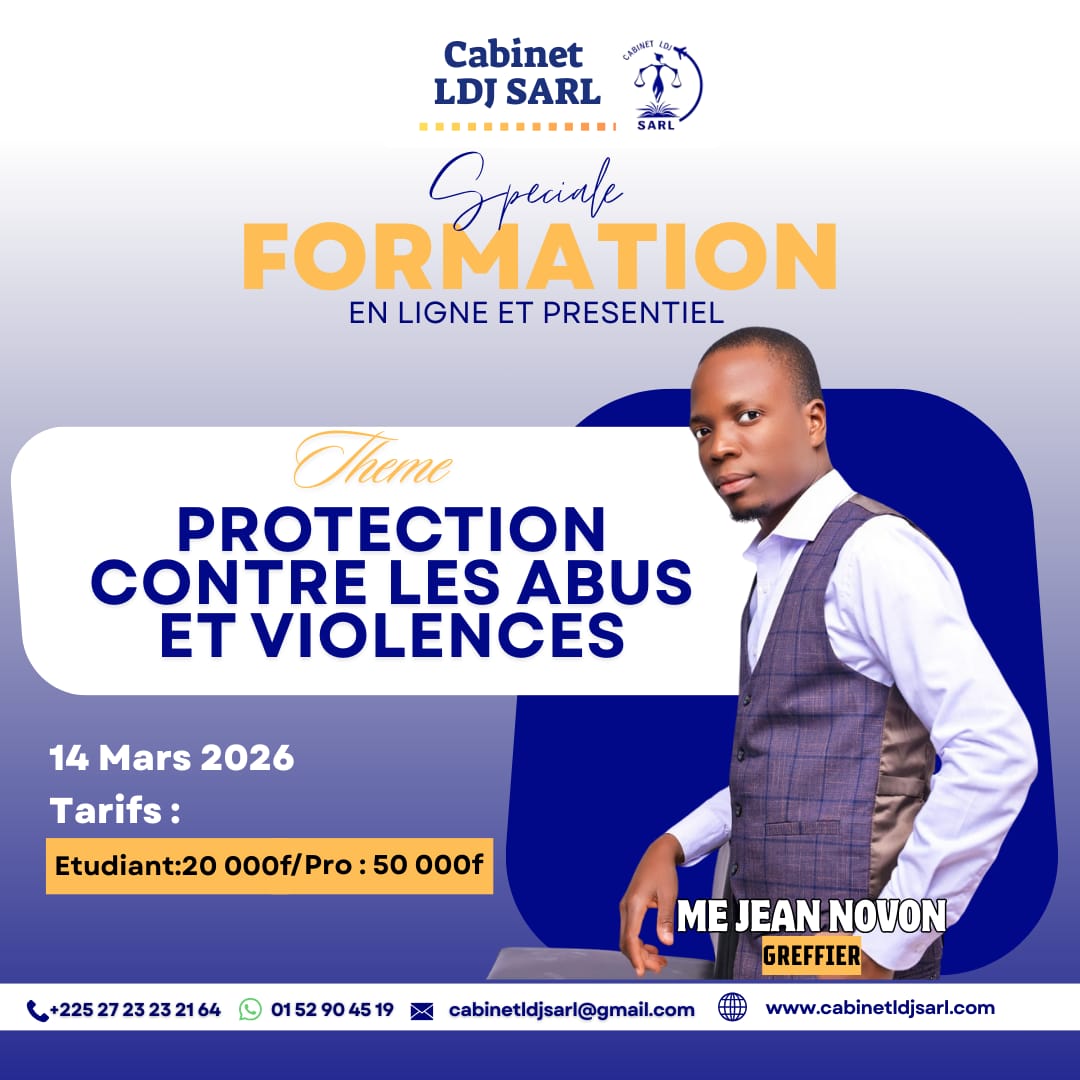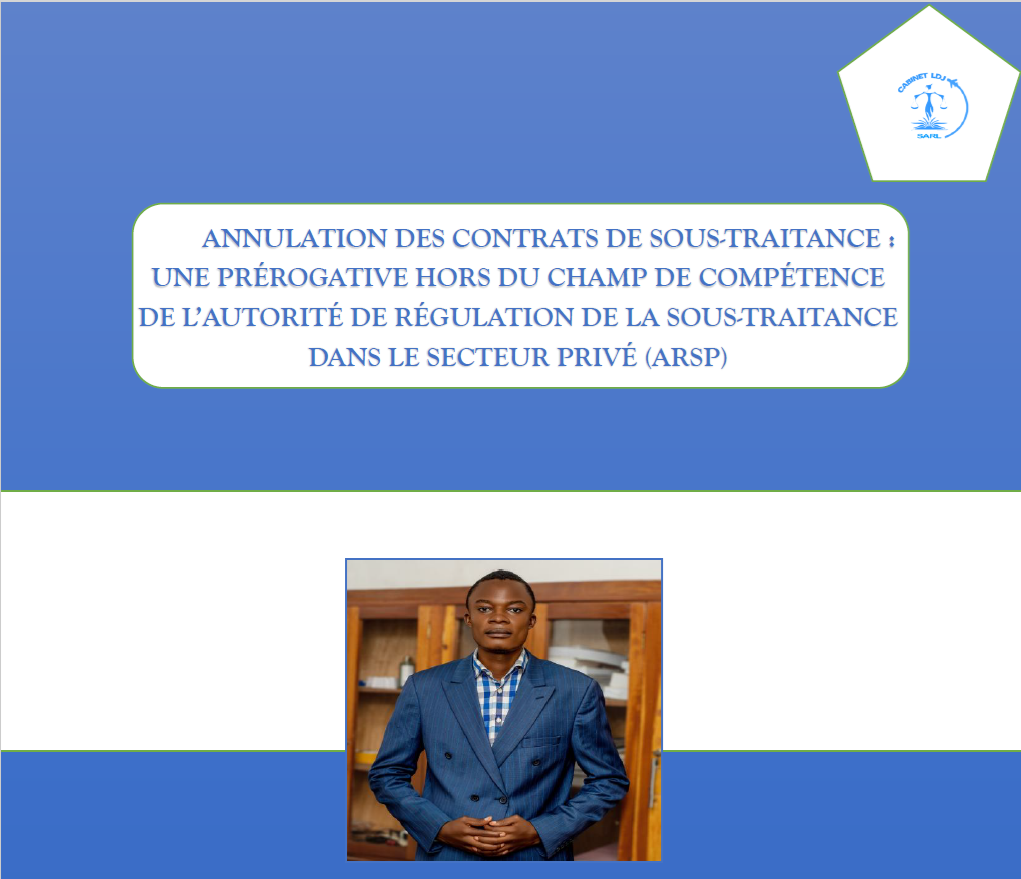Le titre foncier est le seul titre de propriété immobilière incontestable prévu par le droit guinéen. Aux termes des dispositions de l’article 10 du code foncier et domanial guinéen : « la garantie des droits réels est obtenue par la publication sur le livre foncier… à un compte particulier ouvert pour chaque immeuble pour tous les droits réels qui s’y rapportent, ainsi que des modifications de ces mêmes droits, ladite publication étant précédée de la vérification des justifications produites et faisant foi à l’égard des tiers ». Cette disposition rassure et garantie le droit de la propriété immobilière notamment foncière en Guinée par sa publication au livre foncier.
C’est une mesure de protection de la propriété immobilière, car l’article 11 du code foncier et domanial guinéen dispose que « l’immatriculation préalable de l’immeuble dans le livre foncier est obligatoire dans le cas où l’immeuble doit faire l’objet d’un acte à publier ; l’immatriculation est définitive ».
Dans la pratique, la garantie des droits réels se matérialise par l’inscription de l’immeuble sur le livre foncier afin d’obtenir le titre foncier. En effet, l’immeuble une fois inscrit pour l’obtention du titre foncier, ce dernier revêt une force probante c’est-à-dire le degré de valeur à un mode de preuve. Le professeur Loïc Cadiet définit la preuve comme « l’établissement d’un fait ou de l’existence d’un acte juridique »[1]. Il faut prouver que l’on est propriétaire, mais aussi prouver que son titre est régulier. Dès lors, il va de soi que celui qui obtient un titre foncier selon les procédures légales d’immatriculation définies par le code foncier et domanial est et demeure propriétaire de cet immeuble.
En matière immobilière, il est de principe que celui qui dispose le titre foncier portant sur un immeuble soit déclaré propriétaire dudit bien en présence d’un conflit. Toutefois, comment résoudre ce conflit surtout en cette période où la consécration du droit commun des preuves bat son plein caractérisée par des enjeux de preuves.
Au sein de cette importante littérature, la question probablement plus technique du titre foncier comme preuve par excellence de la propriété immobilière occupe une place plus limitée[2].
En droit positif guinéen, la problématique de la preuve de la propriété immobilière implique qu’on se pose la question de savoir : Quelle place occupe le titre foncier dans la hiérarchie des modes de preuve de la propriété immobilière ?
Pour pouvoir être qualifié de preuve irréfutable de la propriété immobilière, l’immeuble doit être régulièrement inscrit (I) c’est en cela réside la force probante du titre foncier (II)
I. L’inscription de l’immeuble pour l’obtention du titre foncier
L’inscription est généralement une force probante. Elle constitue une preuve de la propriété immobilière. Par force probante des inscriptions, il faut entendre la valeur donnée aux inscriptions, comme mode de preuve. Pour ce faire en Guinée, un service appelé le Bureau de la Conservation Foncière a été créé pour l’immatriculation des immeubles (A) dans le strict respect de la procédure (B).
A. Le service en charge de l’immatriculation des immeubles
En effet, Le Bureau de la Conservation Foncière est un service rattaché au Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement. Il a été créé en 1994 suivant le décret D/94/180/PRG/SGG/ du 07 décembre 1994 portant création, attribution et organisation du Bureau de la Conservation Foncière.
Le Bureau de la Conservation Foncière a pour mission de garantir, à partir de leur publication dans les livres fonciers, tous les droits réels qui s’y rapportent, ainsi que les modifications de ces mêmes droits.
A ce titre, il est particulièrement chargé de donner suite aux démarches des formalités de publicité sur les livres fonciers ; inscrire, à la suite des titres fonciers et des copies de ces titres, des droits réels constitués sur les immeubles et devant, pour ce motif, être publiés ; conserver les actes et plans relatifs aux immeubles et de communiquer au public les renseignements contenus en leurs archives et relatifs aux propriétés.
Le Bureau de la Conservation Foncière est doté d’un compte spécial, qui fait l’objet d’une réglementation particulière. Placé sous la tutelle du Ministre chargé des domaines, le Bureau de la Conservation Foncière comprend cinq services :
- Le service des formalités préalables est chargé de toutes les opérations préalables à l’immatriculation et à l’inscription des droits, ainsi que des renseignements et de l’archivage.
- Le service du livre et des titres fonciers est chargé de la tenue du livre foncier ainsi que de la production des titres fonciers.
- Le service des archives chargé de créer pour chaque dossier un avis de classement ; de classer les dossiers par zone et par ordre chronologique et de transmettre l’avis de classement pour le service informatique.
- Le service informatique chargé d’informatiser le système de travail par la mise en place d’un réseau de communication et d’assurer la maintenance des appareils et équipements informatiques.
- Le service de la comptabilité chargé d’élaborer et d’exécuter le budget du Bureau de la Conservation Foncière, d’assurer l’approvisionnement et la gestion du matériel et des équipements du Bureau de la Conservation Foncière, de centraliser les avant projets de budget et préparer la synthèse définitive en relation avec la DAF et d’élaborer le rapport financier et comptable.
Les dispositions des articles 8 à 10 du décret précité prévoient que : « Le Bureau de la Conservation Foncière est tenu par un Conservateur Foncier nommé dans les conditions prévues par le présent Décret.
Le Conservateur Foncier est assisté d’un adjoint, chargé de veiller sur la régularité des procédures de publicité foncière.
Le Conservateur Foncier est nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé des domaines et du cadastre.
Pour être nommé aux fonctions de Conservateur Foncier il faut remplir les conditions suivantes:
- Être titulaire d’une maîtrise en Droit ou de tout autre diplôme jugé équivalent et avoir au moins cinq (5) ans d’expérience de la gestion foncière et domaniale ;
- Avoir servi pendant cinq (5) ans au moins dans un service public ;
- Jouir des droits civiques et politiques ;
- N’avoir pas été condamné pour des agissements contraires à l’honneur et à la probité ;
- N’avoir pas été auteur, co-auteur ou complice d’agissements ayant entraîné une sanction disciplinaire ».
Le Conservateur Foncier doit, avant de prendre fonction, souscrire un cautionnement prévu à l’article 224 du Code Foncier et Domanial. Le montant de ce cautionnement est fixé à un million de francs guinéens (1.000.000 GNF). Dans les mêmes conditions, il doit prêter serment de loyalement remplir sa fonction, avec probité et exactitude, sans enfreindre les devoirs de sa charge. Le Conservateur Foncier est soumis aux obligations prévues aux articles 215 à 224 du Code Foncier et Domanial.
En cas de vacance de la fonction de Conservateur Foncier, le Ministre chargé des Domaines et du Cadastre désigne un intérimaire dans les soixante-douze heures qui suivent, en attendant la nomination du nouveau Conservateur.
Le Conservateur Foncier et les agents du Bureau de la Conservation Foncière ont droit à des primes perçues sur les prestations par eux accomplies. Les hauteurs de ces primes sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Finances et des Domaines et du Cadastre.
Il convient de préciser que la réquisition d’immatriculation d’un immeuble auprès de la Conservation Foncière doit obéir à une procédure préétablie par la loi et les règlements.
B. La procédure d’immatriculation des immeubles
La procédure d’immatriculation des immeubles est prévue aux articles 135 à 151 du code foncier et domanial guinéen. Aux termes des dispositions de l’article 135, « peuvent requérir l’immatriculation des immeubles sur les Livres Fonciers :
- Le propriétaire, alors même que sa capacité est restreinte aux seuls actes d’administration;
- Le copropriétaire chargé de l’administration de l’immeuble indivis ou muni du consentement des autres ayants droit ;
- Le titulaire d’un des droits réels déterminés par le code civil, autre que la propriété, avec le consentement du propriétaire ;
- Le tuteur, administrateur ou curateur d’un incapable ayant l’une des qualités ci-dessus.
Dans tous les cas les frais de la procédure sont, sauf convention contraire, supportés par le requérant, à charge de répétition en ce qui concerne les représentants légaux des incapables ».
Peut également requérir l’immatriculation le créancier poursuivant l’expropriation d’un immeuble, lorsque le Tribunal a ordonné l’accomplissement de cette formalité préalablement à la mise en adjudication. Dans ce cas, les frais sont acquittés par le requérant et assimilés aux frais de justice pour parvenir à la mise en vente.
Sont seuls susceptibles d’immatriculation sur les livres fonciers les fonds de terre, bâtis ou non bâtis.
Il doit être établi une demande spéciale pour chaque corps de propriété appartenant à un seul propriétaire ou à plusieurs copropriétaires indivis et composé d’une ou plusieurs parcelles, pourvu que lesdites parcelles soient contiguës.
Sont considérées comme telles les parcelles constitutives d’un domaine rural qui ne sont séparées les unes des autres que par des cours d’eau ou des voies de communication, affectés ou non d’une façon permanente à l’usage du public.
Préalablement à toute demande d’immatriculation, l’immeuble non clôturé doit être, par les soins du propriétaire, déterminé quant à ses limites au moyen de bornes.
Le requérant doit avoir acquis légalement le bien immeuble et adresser au Conservateur Foncier une demande d’immatriculation accompagnée des documents prouvant le mode d’acquisition du bien immeuble (acte de cession, arrêté d’attribution, acte de donation, etc.). Toutefois, les actes sous-seing privés doivent obligatoirement être authentifiés par les notaires ou les greffiers en chef pour l’intérieur du pays. L’article 140 du code foncier et domanial prévoit que : « tout requérant d’immatriculation d’un immeuble doit remettre au Conservateur, qui lui en donne récépissé, une déclaration signée de lui ou d’un mandataire spécial et contenant :
- Ses nom, prénoms, qualité et domicile et son état civil ;
- La description de l’immeuble ainsi que des constructions et des plantations qui s’y trouvent, avec indication de sa situation et, s’il y a lieu, du nom sous lequel il est connu ;
- L’estimation de sa valeur locative ou du revenu dont il est susceptible ;
- L’estimation de sa valeur vénale avec rappel, s’il y a lieu, des ventes dont il a été l’objet dans les dix dernières années ou de la dernière seulement si cette vente remonte à plus de dix ans ;
- Le détail des droits réels et des baux de plus de trois années afférentes à l’immeuble, avec mention des nom, prénoms et domicile des ayants droit et, le cas échéant, de ceux du subrogé tuteur des mineurs ou interdits dont il peut avoir la tutelle ;
- Réquisition au Conservateur de procéder à l’immatriculation de l’immeuble décrit.
Si le requérant ne peut ou ne sait signer, le Conservateur certifie le fait au bas de la déclaration, qu’il signe en ses lieu et place.
A l’appui de sa déclaration, qui prend le nom de réquisition, le requérant dépose :
- Tous les contrats et actes publics constitutifs des différents droits énumérés dans ladite pièce ou, à défaut, un état des transcriptions et inscriptions afférentes à l’immeuble dont il s’agit ;
- Le livret foncier, l’arrêté d’attribution, l’autorisation d’occuper ou le permis d’habiter dont il est titulaire ;
- Un plan de l’immeuble daté et signé, établi conformément aux instructions du Service Topographique, pour les terrains ruraux ».
La réquisition n’est acceptée par le Conservateur qu’autant que la régularité en est reconnue par lui ; il s’assure en conséquence que les titres produits ou invoqués sont établis dans les formes prescrites par la législation applicable tant au propriétaire qu’à la propriété, sans examiner leur valeur intrinsèque. Il peut exiger au surplus toutes justifications qu’il juge nécessaires sur l’identité et les qualités du requérant.
Si la réquisition émane d’une autorité administrative et que le Conservateur ait des objections à formuler sur la qualité des titres produits ou invoqués, il en fait part à l’autorité requérante des titres produits ou invoqués.
Celle-ci peut passer outre, mais dans ce cas elle doit confirmer la réquisition par écrit et substitue ainsi sa propre responsabilité à celle du Conservateur quant aux suites de l’immatriculation de l’immeuble.
Si un ou plusieurs des actes invoqués par le requérant se trouvent en la possession de tiers, le Conservateur, sur l’avis qui lui est donné, fait sommation aux détenteurs d’en opérer le dépôt, contre récépissé, à la Conservation dans le délai de huitaine, augmenté des délais de distance s’il y a lieu.
Il peut être délivré au déposant, sur sa demande et sans frais, par le Conservateur, une copie certifiée de l’acte déposé.
Enfin, le requérant dépose, en même temps que sa réquisition, une provision égale au montant présumé des frais de la formalité, arbitré par le Conservateur.
L’article 144 précise que : « l’immatriculation d’un immeuble sur les livres fonciers comporte :
- L’inscription au registre des dépôts d’une mention constatant l’accomplissement de la formalité ;
- L’établissement du titre foncier sur les livres fonciers ;
- La rédaction de bordereaux analytiques pour chacun des droits réels soumis à la publicité et reconnus au cours de la formalité ;
- La mention sommaire de ces divers droits, à la suite du titre foncier ;
- L’annulation des anciens titres de propriété, remplacés par le nouveau titre foncier ;
- L’établissement d’une copie du titre foncier à remettre au propriétaire et de certificats d’inscription à délivrer aux titulaires de droits réels susceptibles de cession ».
Le Conservateur constate au registre des dépôts le versement qu’il effectue, au dossier des pièces de la formalité d’immatriculation. Il dresse sur le livre foncier de la circonscription dans laquelle l’immeuble se trouve situé, le Titre foncier, qui comporte, répartis dans les divisions du cadre imprimé, les renseignements suivants :
- Description de l’immeuble, avec indication de ses consistance, contenance, situation et abornements (par numéros de titres fonciers des immeubles voisins, si possible) ;
- Mention sommaire des droits réels existants sur l’immeuble et des charges qui le grève ;
- Désignation du propriétaire.
Il annule et annexe à ses archives les titres de propriété produits à l’appui de la réquisition d’immatriculation.
Toutefois si ces titres concernent, outre la propriété inscrite, un immeuble distinct de cette propriété, le Conservateur remet aux parties le titre commun, dont il conserve une copie qu’il certifie conforme après avoir apposé sur le dit titre commun une mention d’annulation relative à l’immeuble immatriculé.
Enfin, il établit sur des formules spéciales :
- Pour le propriétaire requérant ou, s’il y a lieu mais sur demande expresse, pour chacun des copropriétaires indivis d’un immeuble, une copie exacte et complète du titre foncier ;
- Pour chacun des titulaires de charges ou de droits réels susceptibles de cession et mentionnés, un certificat d’inscription.
Les copies de titres et certificats d’inscription emportent exécution forcée, indépendamment de toute addition de formule exécutoire.
Le domaine public restant imprescriptible, toute immatriculation qui aurait pu être faite au nom d’un particulier est nulle de plein droit.
En cas de perte par le titulaire d’une copie de Titre foncier ou d’un certificat d’immatriculation, le Conservateur n’en peut délivrer un duplicata que sur le vu d’un jugement l’ordonnant, rendu après publication d’un avis inséré dans deux numéros consécutifs du journal officiel ou dans un journal habilité à publier les annonces légales.
Les titulaires de droits réels garantis par une formalité régulièrement accomplie antérieurement à la date du présent code peuvent obtenir le bénéfice de la conservation de ces mêmes droits dans les conditions déterminées ci-après.
Dans ce cas spécial, l’immatriculation peut être requise :
- Par le propriétaire, le copropriétaire chargé de l’administration de l’immeuble indivis ou muni de l’autorisation des autres ayants droit, le successeur légal ou institué du propriétaire ou du copropriétaire au nom duquel a été effectuée la dernière publication ;
- Par le titulaire d’un des droits réels, autres que la propriété, tenant son droit d’un acte transcrit, avec le consentement du propriétaire ;
- Par le créancier hypothécaire titulaire d’une inscription non périmée à la date du dépôt de la réquisition, sous la même condition ;
- Par le tuteur, administrateur ou curateur d’un incapable ayant l’une des qualités ci-dessus.
La réquisition d’immatriculation, rédigée en la forme fixée par l’article 140, doit faire connaître, en distinguant s’il y a lieu pour chacune des parcelles réunies en un corps de propriété, qualité et domicile de précédents propriétaires et indication des actes translatifs depuis trente années ou depuis la constitution de la propriété si elle remonte à moins de trente années.
En ce qui concerne le propriétaire ou l’usufruitier requérant, elle doit être complétée par l’énonciation des fonctions par lui remplies et pouvant emporter hypothèque légale.
Elle doit en outre être appuyée, indépendamment des pièces énumérées à l’article 140 :
- D’un état, délivré par le Conservateur Foncier, des publications d’actes concernant l’immeuble, ou d’un certificat négatif ;
- D’un état, également délivré par le Conservateur Foncier, des inscriptions non radiées ni périmées paraissant grever la propriété, du chef tant du détenteur actuel que des précédents propriétaires désignés en la réquisition.
Il appartient au requérant ou au propriétaire intéressé de provoquer dans la forme légale et avant de requérir la délivrance de l’état dont il s’agit, la radiation de toutes inscriptions devenues sans objet ou prises pour la garantie d’hypothèques judiciaires.
Les inscriptions qui seront reportées au Titre Foncier pour la conservation de droits réels non admis par le présent Code seront périmées, à défaut de renouvellement, à l’expiration d’un délai de dix ans à compter du jour de l’inscription et, dans ce cas, seront radiées d’office par le Conservateur.
La production des actes ou contrats constitutifs de droits réels n’est pas exigée lorsque les droits constitués sont révélés par l’un des états susdits.
A partir du jour du dépôt de la réquisition d’immatriculation à la Conservation Foncière aucune formalité nouvelle, aucun renouvellement d’une formalité ancienne ne peuvent être requis.
Les constitutions et transmissions de droits qui pourraient se produire sont publiées, s’il y a lieu, jusqu’à achèvement de la formalité d’immatriculation.
En conséquence, le dépôt de la réquisition est constaté par un enregistrement au registre de dépôts et une mention, sous forme d’analyse sommaire de la demande, au registre des publications de la conservation foncière. Cette double formalité a pour effet de suspendre le délai de préemption des inscriptions hypothécaires pouvant grever l’immeuble à immatriculer.
Le Conservateur Foncier mentionne la réquisition d’immatriculation sur tous les états de publication qui sont désormais requis par lui, et publie, aux frais du requérant, la demande d’immatriculation dans un journal d’annonces légales.
Au cas où la réquisition serait annulée, pour quelque cause que ce soit, les pièces déposées en vue de la publication sont transférées à la Conservation Foncière.
Les conventions et faits publiés sont, préalablement à toute inscription nouvelle, reportés d’office et sans frais sur les registres de la Conservation Foncière, dans l’ordre qui leur était assigné.
Tout immeuble immatriculé au livre foncier est désigné par le numéro du titre foncier qui le concerne. Le titre foncier revêt par la suite, le degré d’autorité de l’instrument dans son aptitude à servir de moyen de preuve à la propriété immobilière.
II. La force probante du titre foncier
La force probante du titre foncier réside dans le fait qu’il en constitue l’acte de naissance de l’immeuble (A) puisqu’après son établissement, le titre foncier devient irrévocable (B).
A. Le titre foncier l’acte de naissance de l’immeuble
Les problèmes d’accaparement, de légitimité, de maîtrise, d’exploitation et de partage équitable des biens immobiliers ont toujours été source de conflits, de rapport de forces entre les différents acteurs en présence, notamment les personnes privées. Dans ce contexte, le système de l’immatriculation s’installe dans la législation guinéenne, pour permettre à un individu qui veut tirer meilleur parti de son bien immobilier, d’en asseoir sa propriété, de la délimiter et d’en fixer de manière irrévocable son droit, en le consacrant dans un acte public.
Un éminent juriste affirmait déjà que, « le droit de propriété est un droit légitime, qui répond aux efforts de l’homme pour l’amélioration de son sort et du sort de sa famille, qui assure sa liberté, et constitue la condition première du meilleur rendement économique, ainsi que le gage de la paix sociale. La terre par elle seule, constitue alors un instrument d’exploitation économique et de mobilisation de crédit »[3]. En effet, à travers la procédure d’immatriculation, il s’agit pour les particuliers d’assurer la garantie des droits sur un immeuble, car, comme l’écrit AMBIALLET Charles, « l’immatriculation est la liquidation complète du passé juridique d’un immeuble et l’avènement de celui-ci à une vie nouvelle, dont l’histoire sera écrite sous la partie relative à l’inscription… »[4].
Par ces dispositions, la doctrine magnifie la propriété immobilière, et relève en conséquence, l’importance de la procédure d’immatriculation, en tant que garantie de la propriété privée immobilière. Tout cela signifie que, la propriété immobilière constitue un pilier majeur dans le processus de développement de l’individu.
De ce fait, la matière foncière qui englobe, l’ensemble des règles gouvernant l’accession à la propriété immobilière par les personnes privées, recouvre des enjeux indéniables. Lors d’une immatriculation, il ne s’agit pas seulement de dégager des prétentions collectives pour asseoir des prétentions individuelles ; cela va plus loin, l’instinct de possession est profondément enraciné dans la nature de l’homme, le droit à une propriété immobilière stable correspond à un besoin universel et permanent chez l’individu. La propriété immobilière s’impose comme condition de l’indépendance et de la liberté de l’homme. Par l’immatriculation, l’homme recherche un prolongement et un approfondissement de sa personnalité ; celui qui n’a rien en propre dépend des autres, n’a rien en garantie pour son futur, et celui de ses descendants.
L’immatriculation a pour objet de placer un immeuble « sous l’empire du régime des livrets fonciers »[5]. Elle se concrétise par la remise d’un titre foncier qui est la certification officielle de la propriété immobilière. Le titre foncier constitue donc l’acte de naissance du droit de propriété immobilière.
B. L’irrévocabilité du titre foncier
Acte délivré par une autorité administrative compétente, et constituant la seule preuve de la propriété foncière, le titre foncier est inattaquable, intangible, définitif. De ce fait, le titre foncier est requis non seulement « ad probationem », c’est-à-dire pour faire la preuve qu’on est propriétaire de l’immeuble, mais aussi, et surtout « ad validitatem », c’est-à-dire, pour consolider son droit de propriété et le rendre opposable à toutes autres prétentions concurrentes.
De ce point de vue, la nature juridique de cet acte est incontestable et lourde de conséquences. Néanmoins, cette force probante du titre foncier est conditionnée par une immatriculation dénuée d’irrégularités, étant entendu que toute irrégularité sape les bases et fondements de cet acte conformément à l’article 10 du code foncier et domanial précité. Ainsi, le titre foncier est définitif, intangible et inattaquables.
Le titre foncier est considéré comme définitif, dans la mesure où le titre foncier clôture une procédure minutieuse, entourée de publicité, par conséquent, ne peut plus être remis en question. Ainsi, le titre foncier est définitif, car il marque la fin de la procédure d’immatriculation. Son obtention est aux termes de l’article 154 du code foncier et domanial, « le point de départ des droits réels et charges foncières existant sur l’immeuble au moment de l’immatriculation ». On n’attend plus rien d’autre pour être déclaré propriétaire de l’immeuble.
Inattaquable, car le titre foncier met fin à toutes prétentions concurrentes et aucune action portant sur ce document ne peut être recevable, en clair, cela signifie que dès lors qu’il est délivré, aucun recours n’est plus admissible, « la seule forme de contestation qui soit admise est, en cas de dol, l’action personnelle en dommages et intérêts contre l’auteur du dol, ouverte à toute personne dont les droits ont été lésés » ;
Intangible, parce qu’on ne peut ni retrancher ni ajouter des mentions au titre foncier établi. C’est un acte absolu, qui fait foi de la preuve de la propriété. Cela veut dire qu’en principe, on ne peut plus, ni ajouter, ni retrancher les mentions qu’il contient. Cela signifie aussi que la force probante que la loi attache à l’immatriculation et aux énonciations portées sur le titre au moment même de l’immatriculation est absolue. Cette figure s’agit ici de savoir si on est encore libre de toucher le titre foncier, c’est-à-dire d’ajouter ou de retrancher certaines mentions déjà portées sur le titre foncier puisqu’il peut y avoir des erreurs humaines ou des fautes intentionnelles. Le législateur a répondu par la négative pour affirmer davantage l’absolutisme de la force probante du titre foncier[6].
Le système de l’immatriculation s’accompagne à ne point douter d’effets très énergiques en dotant une base incontestable au titre foncier établi. Car tous les titres antérieurs à l’immatriculation sont annulés pour faire place au titre foncier qui porte en lui la preuve du droit de propriété immobilière. Il ne s’agit plus après l’immatriculation, de chercher, ni même de savoir, comment celui-ci a pu, antérieurement acquérir son droit. Est-ce par voie de succession, de donation, de vente ? Peu importe. Il tient désormais son droit d’immatriculation. L’immatriculation purge les droits antérieurs qui ne seraient pas mentionnés au titre foncier[7].
Par M. Aubin KOLAMOU, Conseiller juridique pour entreprises et particuliers.
[1] L. CADIET, « la preuve : regards croisés », éd. Dalloz, 2015.
[2] P. MENDELSOHN, De la preuve de la propriété immobilière, Thèse de doctorat, Paris, 1922.
[3] V. A. MPESSA, « Le titre foncier devant le juge » in JCP n° 59 juillet-août-septembre 2004. III- Doctrine et études, p. 78.
[4] V. AMBIALLET, « Les effets de la force probante de l’inscription sur le livre foncier marocain », Paris, Domat-Montchrestien, 1934, pp. 42-43.
[5] V. GASSE, « Régimes fonciers africains et malgaches : évolutions depuis l’indépendance », LGDJ Paris 1971 p. 52.
[6] V. GASSE, « Régimes fonciers africains et malgaches : évolutions depuis l’indépendance », op. cit.
[7] C. AMBIALLET, « Les effets de la force probante de l’inscription sur le livre foncier marocain », Ibidem.