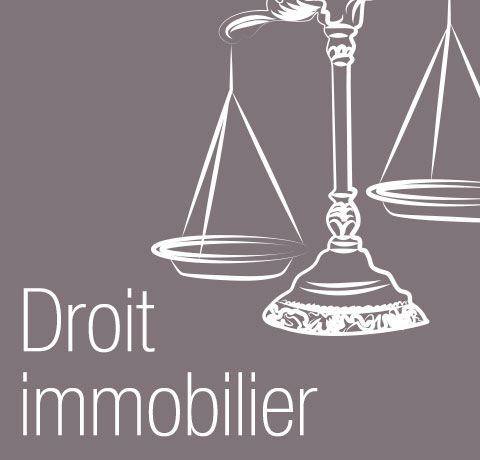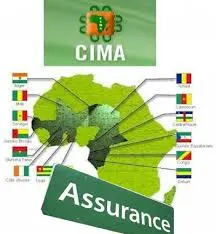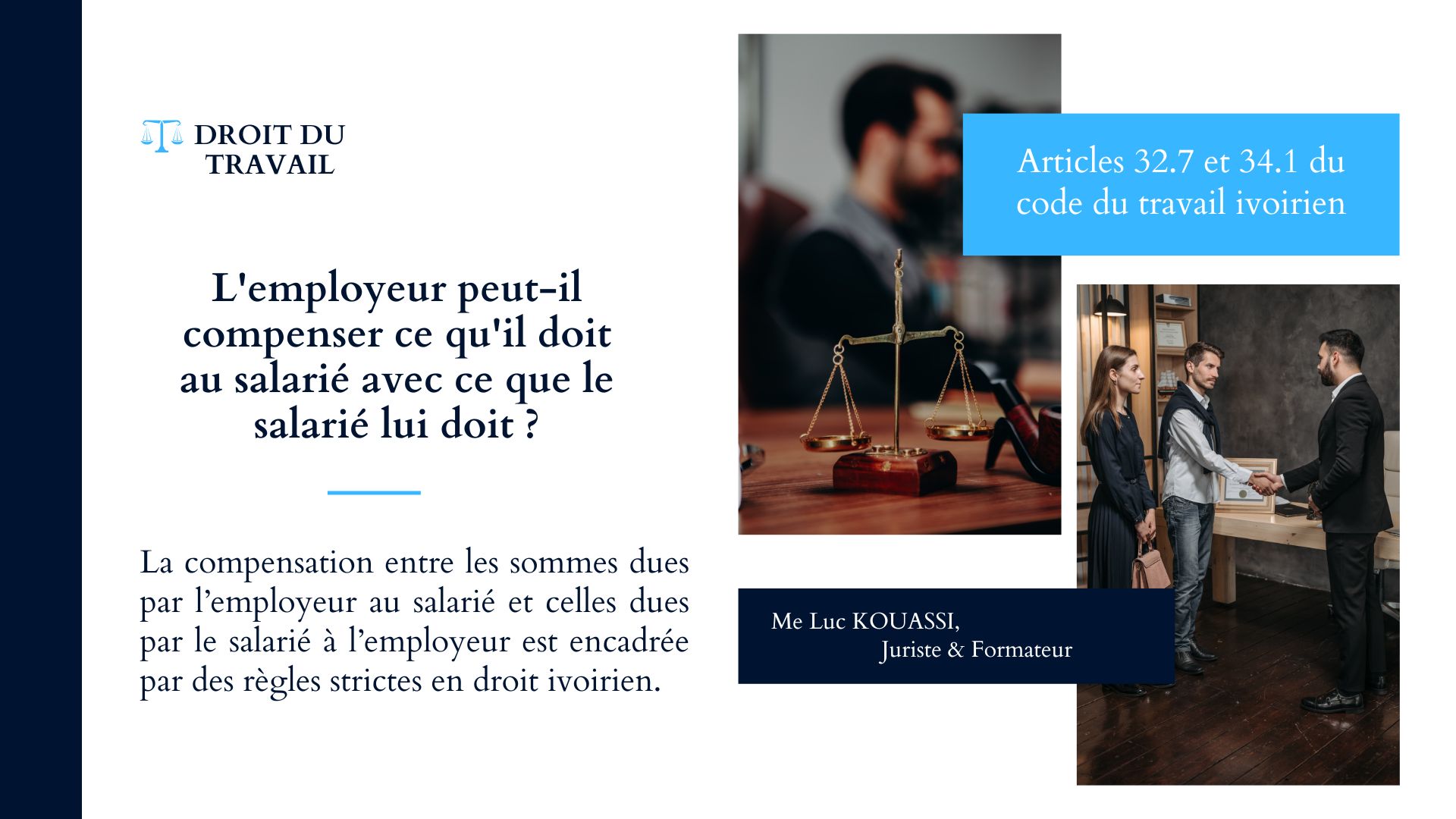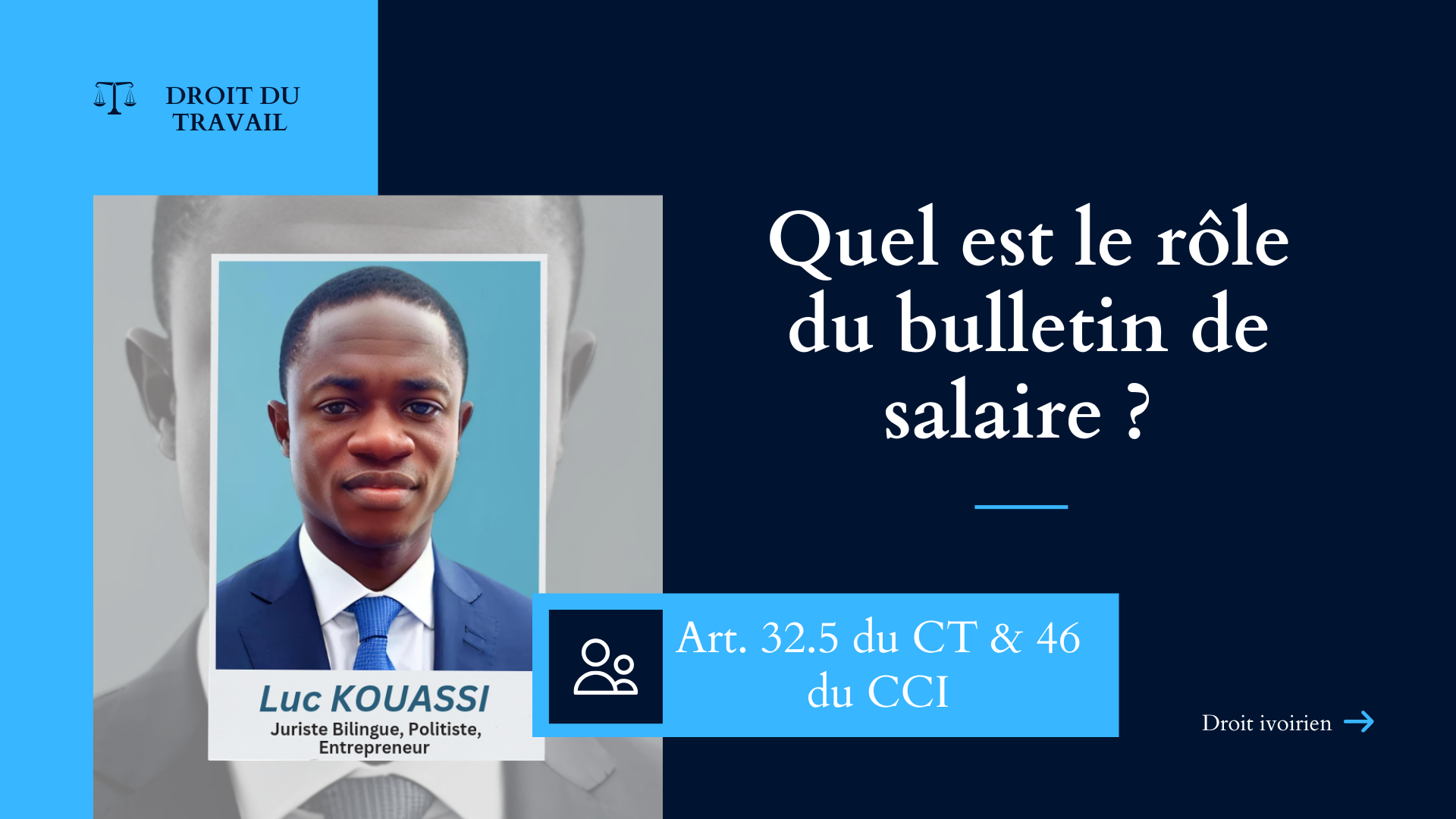L’Organisation Non Gouvernementale était anciennement régie par la loi Ivoirienne n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations. Dorénavant, elle est régie par l’ordonnance n°2024-368 du 12 juin 2024 relative à l’organisation de la société civile. L’ONG est une organisation à but non lucratif. Son but n’est pas de réaliser des bénéfices.
Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives :
- Statuts et Règlement intérieur
- Procès-verbal et annexes
- Déclaration en préfecture
- Récépissé d’immatriculation
I. Qu’est-ce qu’une ONG?
L’Organisation Non Gouvernementale est régie par l’ordonnance n°2024-368 du 12 juin 2024 relative à l’organisation de la société civile. Ainsi, en l’état actuel du droit ivoirien, l’ONG est une association à but non lucratif, qui ne relève ni de l’État, ni d’institutions internationales. Les ONG sont définies par certains critères dont les principaux sont les suivants:
- Le but non lucratif de son action ;
- L’indépendance financière ;
- L’indépendance politique ;
- La notion d’intérêt public.
Elle est une personne morale agissant au plan national ou international.
II. A qui s’adresse une ONG et pourquoi?
Une ONG s’adresse aux populations les plus vulnérables telles que les orphelins, les veuves, les sans-abris, les victimes de catastrophes ou de guerres etc… Elle va là où les autres acteurs de la société civile ne vont pas et contribue ainsi à créer une société civile plus forte. Elle agit dans les domaines de la santé, de l’éducation, du social, des droits de l’homme …; ne recherchant parfois que l’instauration d’un État de droit ou de la démocratie véritable ou encore d’une justice sociale.
III. Comment fonctionne une ONG?
Pour bien organiser votre ONG, vous aurez besoin de repartir les responsabilités administratives en trois organes: l’Assemblée Générale (AG), le Bureau Exécutif (BE) et le Commissariat aux Comptes (CC).
- L’AG est l’organe suprême de décision de l’ONG. Elle est qualifiée d’ordinaire ou d’extraordinaire selon l’objet des délibérations. Elle est composée des membres du BE, des commissaires aux comptes et des membres actifs. Elle définit la politique générale de l’ONG.
- Le BE est l’organe de gestion et d’administration de l’ONG. Il agit conformément aux pouvoirs qui lui sont propres et ceux qui lui sont délégués par l’AG. Il est composé de membres élus dont le président et six autres membres. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l’ONG.
- Les membres du CC sont élus par l’AG pour une durée déterminée. Il examine les comptes annuels et dresse un rapport à l’AG.
IV. Quelle est votre mission?
Les organisations non gouvernementales (O.N.G.) s’insèrent parfaitement dans la typologie d’institutions cherchant à établir un état de paix. Elles ne sont pas aussi récentes que leur dénomination actuelle pourrait le laisser croire, car ces ONG sont en réalité la continuation des « œuvres » et «institutions de bienfaisance » que le monde a toujours entretenues.
Elles sont actuellement assimilables à des associations ou institutions, car elles interviennent dans la résolution des conflits, et incitent le pouvoir étatique à l’action en faisant du lobbying et en alarmant l’opinion publique.
Les institutions charitables ont toujours été associées à l’idée de préserver la paix sociale. Toutefois, elles se distinguent des institutions politiques et religieuses, car si celles-ci sont vouées à la pérennité, les institutions charitables doivent dans l’idéal être temporaires, pour pallier aux imperfections momentanées des systèmes
Les ONG sont aujourd’hui indéniablement devenues des acteurs incontournables dans la résolution de conflits et de situation de crises. Leur neutralité est affichée depuis la création de la Croix rouge en 1864, ce qui leur confère un pouvoir de médiateur unique. Les bons sentiments qui les animent et l’aide apportée sur le terrain en font des institutions respectées le plus souvent par l’ensemble des belligérants dans la résolution des conflits.
Les ONG étaient initialement dédiées à apporter une aide ponctuelle d’urgence, puis elles ont déplacé leurs actions vers le développement, la prévention. Cette seconde direction prise par leurs activités en fait à double titre un acteur de paix.
Les actions de développement qu’elles coordonnent sont souvent marquées par les valeurs, la culture, etc…
V. Comment obtenir le financement ?
Association à but non lucratif, l’ONG tire principalement ses ressources des Droits d’adhésion de chacun de ses membres, ainsi que de leurs cotisations annuelles. Les cotisations et les droits d’adhésion sont fixés par l’AG dans les statuts de l’ONG. Accessoirement, les ONG peuvent recevoir des dons privés et des subventions nationales ou internationales. Par ailleurs, et dans certains cas seulement, les produits des activités font partie des ressources. Il s’agit entre autres des ventes de charité, des œuvres caritatives productives etc…
VI. De façon concrète, comment créé-t-on une ONG ?
Vous devez préalablement rédiger l’ensemble de vos documents constitutifs (statuts, règlement intérieur, PV AG etc…). Ensuite, il faudra faire un dépôt de ces documents à la préfecture du siège social. Vous pouvez être tenté de les rédiger vous-mêmes, cependant il est conseillé de laisser faire des spécialistes. En réalité, la subtilité de certains termes, et la complexité que revêt cet exercice peuvent rapidement vous submerger.
VII. C’est quoi le récépissé de déclaration?
Une fois les documents rédigés, le représentant de l’ONG devra les déposer auprès du service dûment habilité pour les réceptionner. A la suite de ce dépôt, un récépissé vous sera délivré.
VIII. A quoi sert-il?
Dans un premier temps, il sert à attester de la constitution de votre ONG, ou tout au moins de son commencement de création. Pendant un bon moment, il sera le seul document permettant à l’organisation d’être reconnue légalement et d’exercer ses activités.
IX. Une enquête de moralité? (Qu’est-ce que c’est?)
Une enquête de moralité est un ensemble de procédés visant à déterminer les raisons qui motivent une personne à agir. Dit autrement, l’enquête de moralité vise à éclairer les bonnes mœurs d’un individu. Elle peut être indispensable pour bien comprendre une personne et prendre une décision avisée à son endroit. De façon concrète, l’enquête de moralité est faite pour s’assurer d’avoir affaire à une personne sérieuse et digne de confiance.
X. Une enquête de moralité? (Qui la fait?)
Dans le cadre de la création d’une ONG, l’enquête de moralité est faite par le Ministère de l’intérieur. Ainsi, la sûreté mène l’enquête et délivre un document attestant de la conformité de l’activité avec les bonnes mœurs.
XI. Une enquête de moralité? (Comment se déroule-t-elle?)
De façon générale, les dirigeants et fondateurs de l’ONG se verront interroger sur :
- Leurs antécédents judiciaires;
- Le domaine d’activité de l’ONG;
- Sur les raisons pour lesquelles ils créent cette ONG;
- L’origine des fonds utilisés…
XII. Une enquête de moralité? (Combien de temps dure-t-elle?)
Elle peut durer jusqu’à environ six (6) mois voire plus. Le but étant de mener une bonne enquête une fois pour toute et d’être sûr du résultat.
Nous avons 3 types d’assistance en la matière :
- Nous rédigeons ou corrigeons uniquement les actes (Statuts, règlement intérieur, lettre, listes, procès verbal)
- Nous assistons jusqu’à l’obtention du récépissé de déclaration (Rédaction des actes + légalisation + déclaration + obtention du récépissé)
- Nous assistons jusqu’à l’obtention de l’agrément (Rédaction des actes + légalisation + déclaration + récépissé + assistance enquête + agrément)
Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp)
Luc KOUASSI
Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire