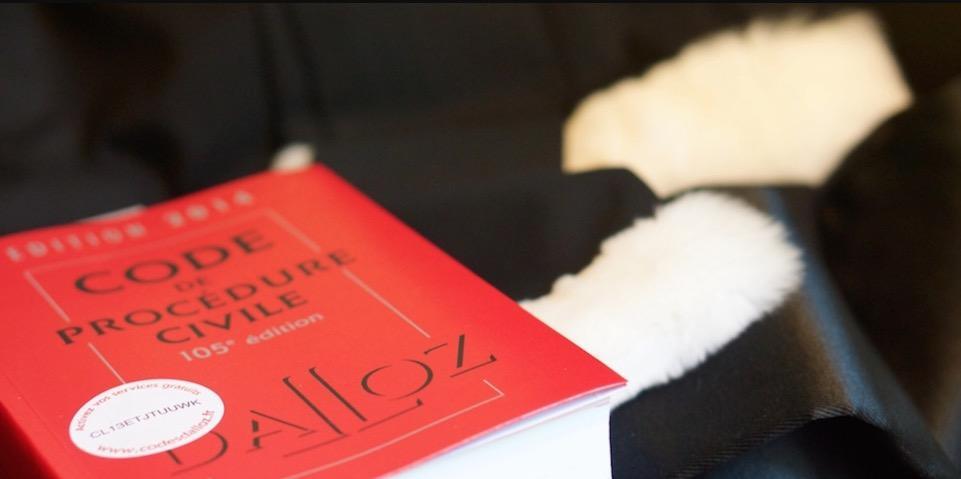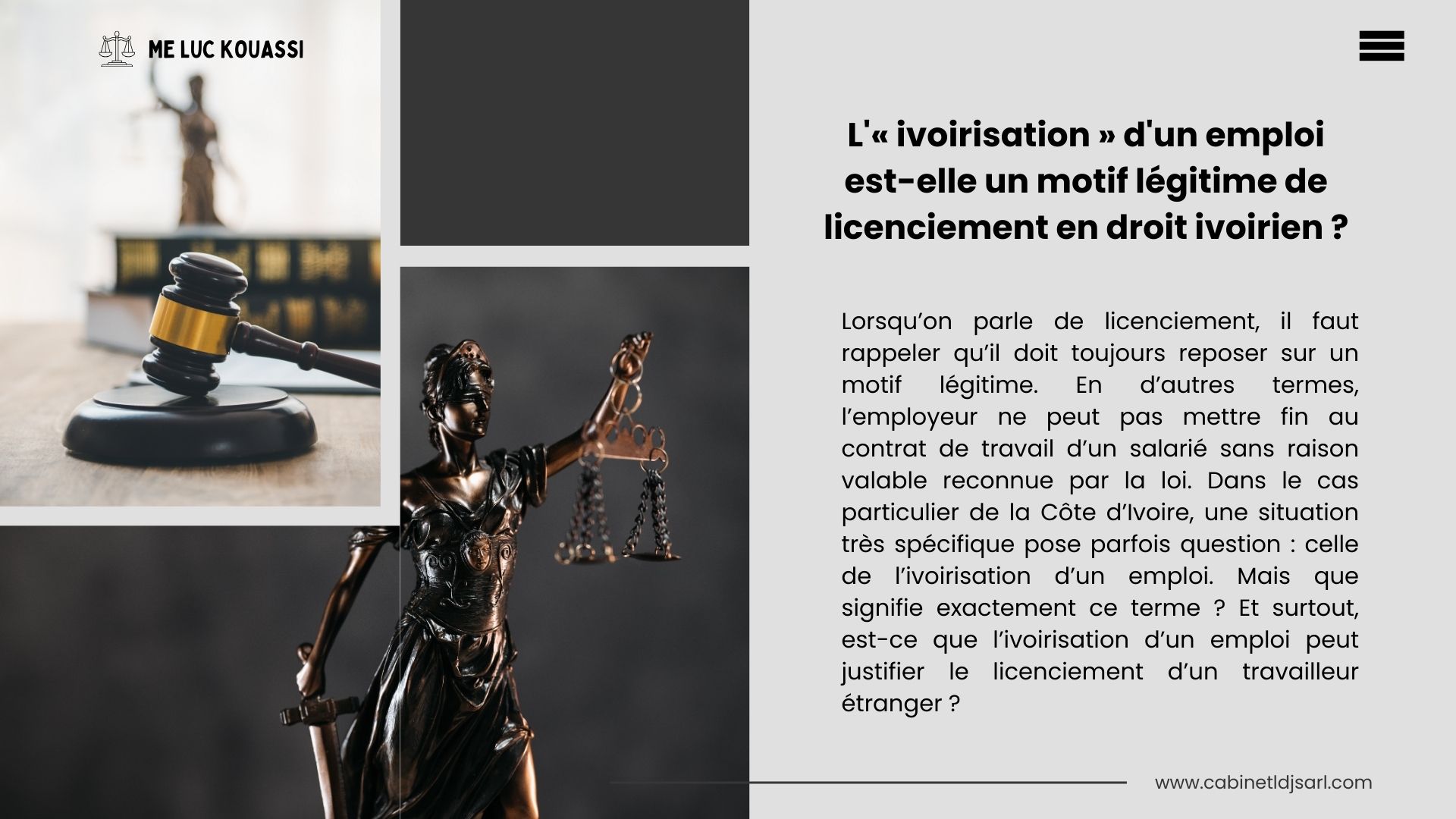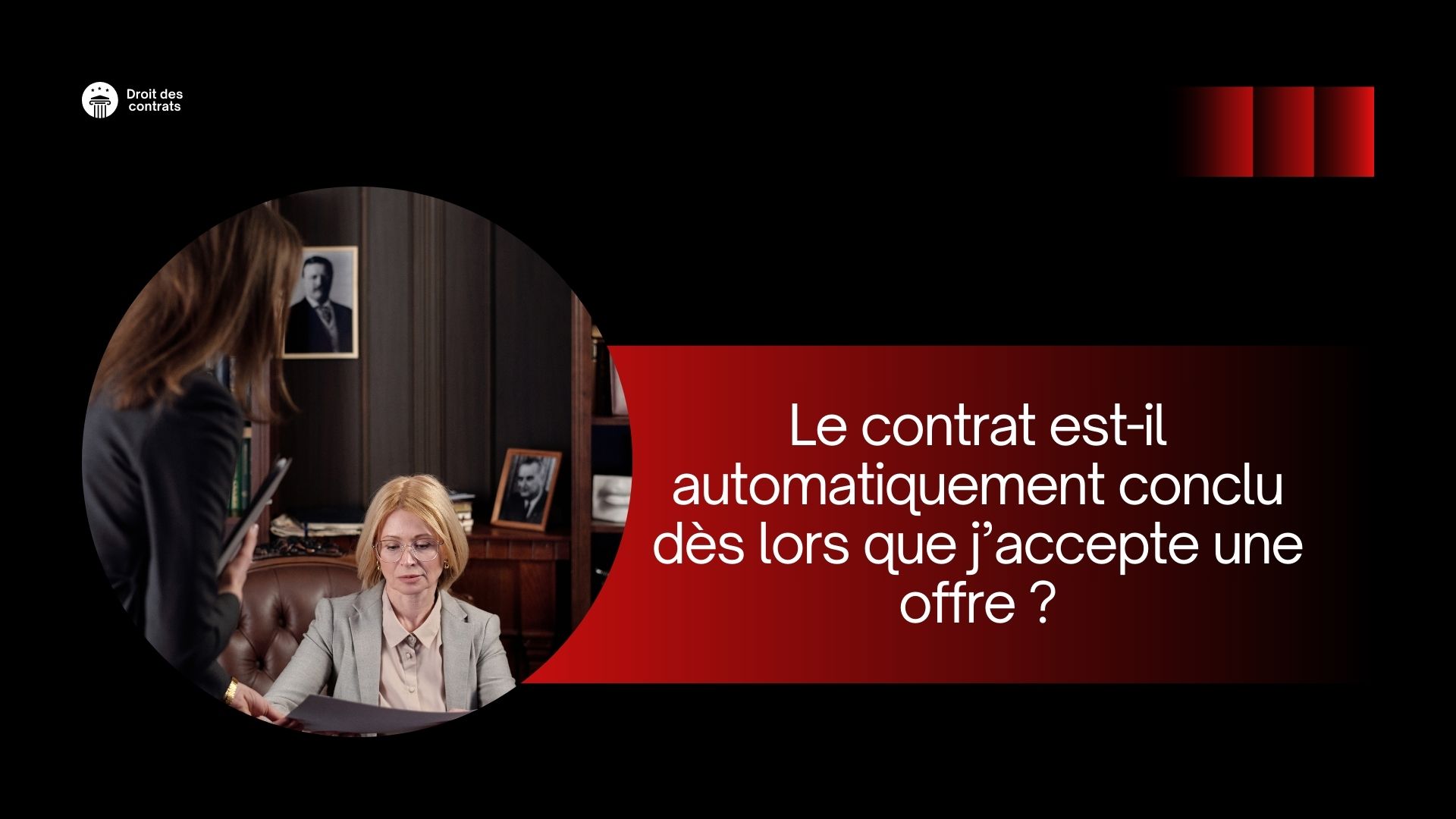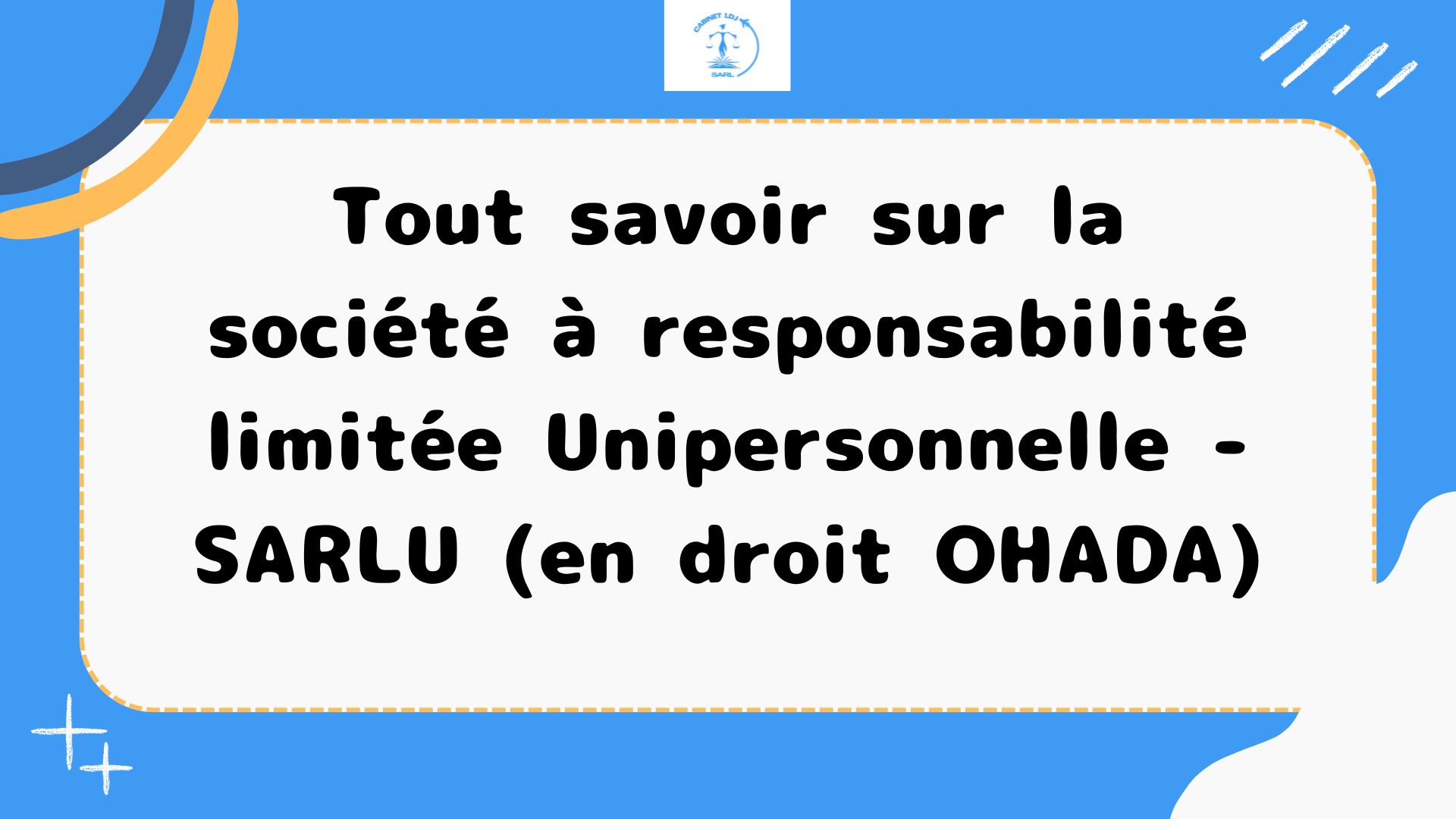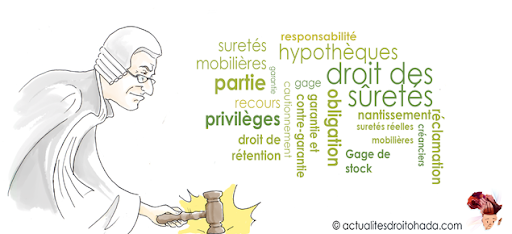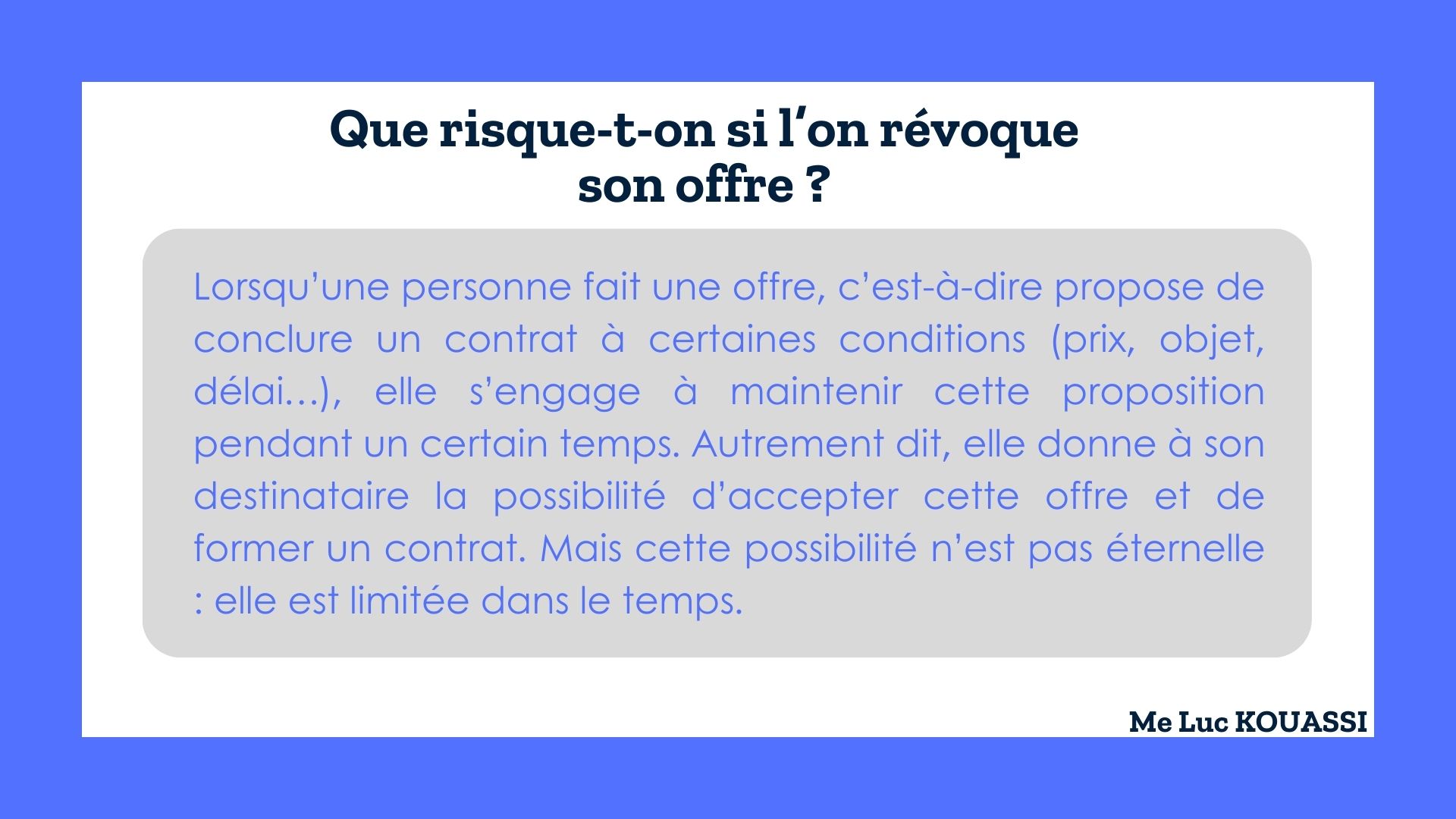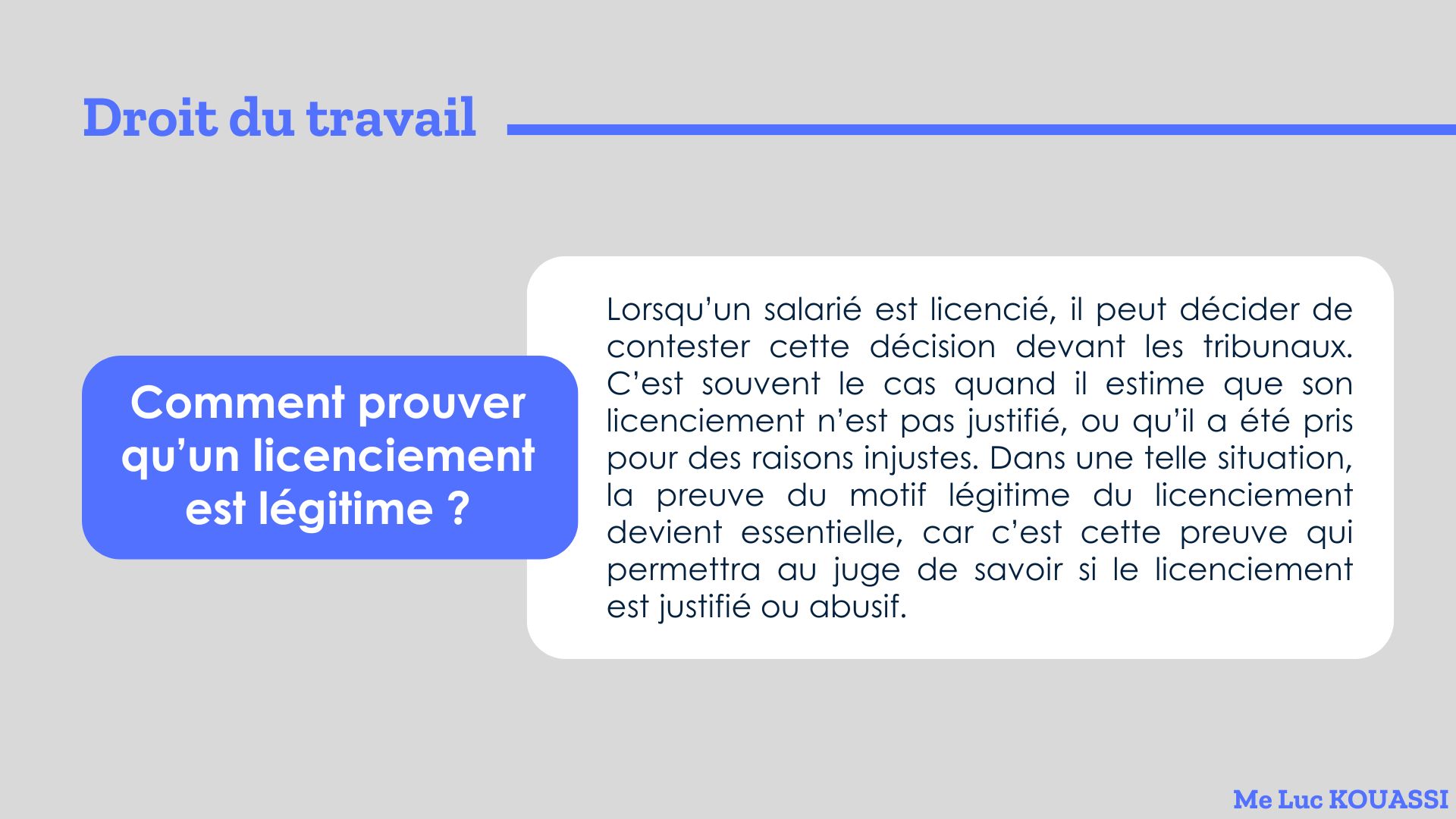La SARL (société à responsabilité limitée) est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports. En cas de perte, les associés seront responsables qu’à hauteur de ce qu’ils ont apporté à la société. C’est donc une société dans laquelle les biens personnels des associés sont protégés.
I. Qu’est-ce qu’une Société A Responsabilité Limitée (SARL) ?
La SARL est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales. En cas de perte, les associés seront responsables qu’à hauteur de leurs apports. C’est donc une société dans laquelle les biens propres des associés sont protégés.
La société à responsabilité limitée (ci-après « SARL ») est une société commerciale par sa forme dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports (article 309 de l’Acte Uniforme OHADA du 30 janvier 2014 relatif aux droits des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique (GIE), ci-après l’ « AUSCGIE »).
En d’autres termes, un associé d’une SARL ne pourra pas être poursuivi sur son patrimoine personnel pour répondre du passif social de la société.
II. Qu’est-ce qu’une SARL à capital variable ?
La société à capital variable est une société dont le capital peut, en vertu d’une disposition statutaire, augmenter ou diminuer à tout moment, en raison soit de l’accroissement de la participation de certains associés, soit de l’augmentation de leur nombre, soit encore du retrait ou de l’exclusion d’un ou de plusieurs associés, et cela sans qu’il y ait lieu de procéder aux formalités sociétaires habituelles d’augmentation ou de réduction du capital.
III. Quel doit être le montant minimum du capital social d’une SARL ?
Le capital social minimum pour constituer une SARL est de 1 million de francs CFA divisible en part sociales égales et dont la valeur nominale ne peut être inférieure à cinq mille (5 000 francs CFA). Toutefois, depuis la révision de l’acte uniforme portant droit des sociétés commerciales de 2014, les Etats ont la possibilité de déroger à ce minimum légal. Par exemple en Côte d’Ivoire, aucun minimum du capital social n’est exigé pour créer une SARL.
IV. Qui peut être associé d’une SARL ? Faut-il être commerçant pour être un associé d’une SARL ?
Toute personne physique (individu, qu’elle soit commerçante ou non) ou morale (société) peut devenir associée d’une SARL. Même les majeurs incapables, mineurs et époux peuvent être associés d’une Sarl.
Ainsi, conformément à l’article 309 paragraphe 2 de l’AUSCGIE, une SARL peut-elle être constituée par un associé personne physique ou morale ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales.
Au regard de cette disposition, deux observations ressortent :
- L’associé d’une SARL peut être personne physique ou morale ;
- Une SARL peut être instituée par un associé unique ou une pluralité d’associés. Ainsi, une SARL peut être unipersonnelle ou pluripersonnelle, sans que les textes ne viennent préciser le nombre maximum d’associés.
NB: Au sein d’une SARL, les droits des associés sont dénommés parts sociales.
V. Combien d’associés minimum faut-il pour créer ma SARL ?
Pour créer une SARL, il faut au minimum deux associés. Toutefois, une seule personne à la possibilité de créer sa SARL. On parlera, dans ce cas, de SARL unipersonnelle. (Voir section précédente)
VI. Qui dirige la SARL ?
La gestion de la SARL est quotidiennement assurée par le gérant (dirigeant de la SARL) d’un côté et de l’autre côté les associés qui assurent un pouvoir souverain. Le gérant est nécessairement une personne physique.
Le ou les gérants personnes physiques associées ou non sont nommés par les statuts ou dans un acte postérieur. En l’absence de dispositions prévues par les statuts, le gérant ou les gérants sont nommés pour 4 ans. Ils sont rééligibles.
Pour ce qui est de leur rémunération, le gérant peut exercer à titre gratuit ou onéreux dans les conditions fixées dans les statuts ou dans une décision collective des associés. Le gérant dispose de pouvoirs considérables dans ses relations soit avec les associés ou avec les tiers.
Il peut démissionner, être révoqué ou simplement arrêter ses fonctions à l’arrivée du terme de son mandat
VII. Dans une SARL, comment calculer la part sociale de chaque associé ?
Le capital d’une société à responsabilité limitée est divisé en parts sociales qui représentent un certain nombre de voix. En droit OHADA, un montant de capital social est donné à titre indicatif ce montant est d’un million (1.000.000 CFA) avec une valeur nominale de 5000 (CFA).
Ainsi, pour une SARL ayant 1.000.000 CFA de capital social avec des valeurs nominales équivalant à 5000 CFA on aura 200 parts sociales.
Ces 200 parts sociales seront donc reparties proportionnellement entre les associés. En fonction, bien sûr, de ce que chacun aura apporté à la formation du capital social.
En clair, plus tu as apporté, plus tu as de parts sociales. Exemple : Prenons une société de 2 associés au capital de 1 000.000 CFA. Cette somme divisée par 5000 CFA soit la valeur nominale. On aura donc un résultat de 200 parts sociales d’une valeur nominale de 5000 CFA.
L’associé A a fait un apport de 750.000 CFA, l’associé B un apport de 250000 CFA. L’associé A reçoit donc 750.000 / 5000 = 150 parts sociales, et l’associé B 250.000 / 5.000 = 50 parts sociales. C’est donc l’associé A qui aura le pouvoir effectif de décision dans l’assemblée générale.
VIII. Que doivent contenir les statuts de la SARL ?
Les statuts de la SARL doivent obligatoirement contenir les mentions telles que :
- La forme de la société ;
- Sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
- La nature et le domaine de son activité, qui forment son objet social ;
- Son siège ;
- L’identité des apporteurs en nature, la nature et l’évaluation de l’apport effectué par chacun d’eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
- Si la société accorde des avantages particuliers, l’identité des bénéficiaires de ces avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;
- Le montant du capital social ;
- Le nombre et la valeur des titres sociaux émis, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de titres créées ;
- Les stipulations relatives à la répartition du résultat, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
- Les modalités de son fonctionnement.
IX. Quelles sont les formalités à accomplir pour créer une SARL ?
Afin de constituer une SARL, il convient de respecter des conditions de fond (A) et de forme (B).
A- Les conditions de fond :
S’agissant des conditions qualifiées « de fond » applicables aux SARL selon l’AUSCGIE, il se distingue trois éléments : le capital social, l’évaluation des apports en nature et le dépôt des fonds et mise à disposition.
Concernant le capital social, l’article 311 de l’AUSCGIE prévoit depuis 2014 que, sauf dispositions nationales contraires, le capital social d’une SARL doit être de 1.000.000 F CFA au moins.
Son capital social est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à 5.000 F CFA (article 311 AUSCGIE).
Les Etats parties ont néanmoins la possibilité d’adopter des dispositions nationales différentes.
A titre d’exemple, et à date, nous pouvons noter qu’au Sénégal, au Togo ou au Bénin aucun capital social minimum n’est requis pour la création d’une SARL à l’inverse du Cameroun qui fixe le capital social minimum pour une SARL à 100.000 F CFA.
NB : Les SARL dont le capital social était inférieur au capital minimal prévu à l’article 311 de l’AUSCGIE avaient un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’AUSCGIE pour : Soit augmenté leur capital social; soit prononcer leur dissolution; soit se transformer en société d’une autre forme pour laquelle l’AUSCGIE n’exige pas un capital minimal supérieur au capital existant. A défaut, lesdites sociétés sont dissoutes de plein droit à l’expiration dudit délai (article 911 de l’AUSCGIE).
Concernant les apports à réaliser aux fins de constituer une SARL, ils peuvent être de trois types :
- En nature : Il s’agit de droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels.
En cas d’apport par nature dans une SARL, (1) les parts sociales doivent être intégralement libérées et (2) les statuts doivent préciser l’évaluation de chaque apport en nature.
L’évaluation de l’apport est contrôlée par un commissaire aux apports si la valeur du ou des apports considéré(s) est supérieure à 5.000.000 F CFA.
A contrario, dans le cas où la valeur du ou des apports considéré(s) est inférieur à 5.000.000 F CFA le recours à un commissaire aux apports contrôlant l’évaluation n’est pas obligatoire.
En amont, en cas d’avantages particuliers, l’évaluation est obligatoirement contrôlée par un commissaire aux apports qu’importe la valeur.
Le défaut de recours à un commissaire aux apports ou si la valeur retenue par les associés est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, la responsabilité des associés pourra être recherchée.
En effet, dans ces hypothèses, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature.
A toutes fins utiles, il convient de préciser que la valeur de l’apport en nature ne sera garantie qu’au moment de la constitution ou de l’augmentation de capital (article 312 de l’AUSCGIE).
Ainsi, le maintien de cette valeur tout au long de la vie de la SARL n’est pas garanti.
- En numéraire : Il s’agit de l’apport d’argent par un associé, ou futur associé de la SARL.
Dans cette hypothèse, les parts sociales peuvent être libérées lors de la souscription du capital de la moitié au moins de leur valeur nominale (article 311-1 de l’AUSCGIE).
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois dans un délai de deux ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier (ci-après le « RCCM »), selon les stipulations statutaires.
A défaut de libération du capital social dans le délai imparti, l’article 43 de l’AUSGIE prévoit que les sommes restant dues à la société portent de plein droit intérêt au taux légal à compter du jour où le versement devait être effectué, sans préjudice, le cas échéant, de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 313 de l’AUSCGIE, les fonds provenant de la libération des parts sociales font l’objet d’un dépôt immédiat par le fondateur, en banque ou dans tout autre établissement de crédit ou de micro finance dûment agréé, contre récépissé, dans un compte ouvert au nom de la société en formation, ou en l’étude d’un notaire.
Une mention de la libération des parts et du dépôt des fonds sera portée aux statuts.
Sauf dispositions nationales contraires, la libération et le dépôt des fonds sont constatés par un notaire du ressort du siège social, au moyen d’une déclaration notariée de souscription et de versement.
Les fonds déposés sont indisponibles jusqu’au jour de l’immatriculation de la société au RCCM. A défaut d’immatriculation de la SARL dans le délai de six mois à compter du premier dépôt des fonds en banque, dans tout autre établissement de crédit ou de microfinance dûment agréé, ou chez le notaire, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander au président de la juridiction compétente l’autorisation de retirer le montant de leurs apports (article 314 de l’AUSCGIE).
- En industrie : L’apport en industrie permet d’apporter à la société des connaissances techniques ou professionnelles ou des services dans les conditions posées par l’AUSCGIE.
Ce type d’apport ne permet pas de former le capital social de la société, toutefois, il donne lieu à l’attribution de titres sociaux qui ne sont ni cessibles ni transmissibles.
L’apport en industrie est, au même titre que l’apport en nature, évalué.
Il convient de préciser qu’aucune disposition n’exclue explicitement l’apport en industrie pour les SARL.
L’article 4 de l’AUSCGIE précise également que « la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, ou de l’industrie, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui peut en résulter ».
La SARL étant une société commerciale par la forme conformément à l’article 4 de l’AUSCGIE, nous comprenons que l’AUSCGIE admet le recours à l’apport en industrie dans le cadre de sa constitution.
En cas de recours à ce type d’apport, les statuts de la SARL préciseront l’identité des apporteurs en industrie, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie des apports.
La nature et la durée des prestations fournies seront, pour chaque apport en industrie, précisées.
B- Les conditions de forme :
S’agissant des conditions de forme, et sauf dispositions nationales contraires, les statuts de la SARL sont établis soit par un acte notarié soit par un acte sous seing privé déposé au rang des minutes d’un notaire (article 10 de l’AUSCGIE).
Dans ce dernier cas, un exemplaire original des statuts sera remis à chaque associé.
Conformément à l’article 315 de l’AUSCGIE applicable à la SARL, il convient de préciser que l’intervention, en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial, du ou des associés à l’acte instituant la société est nécessaire.
À défaut du respect de cette formalité, la société est nulle.
La SARL doit également être immatriculée au RCCM du ressort de son siège social dans le mois de sa constitution (articles 97 de l’AUSCGIE et 46 de l’Acte Uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général).
En effet, c’est à compter de cette immatriculation par les représentants légaux de la SARL que cette dernière acquiert la personnalité juridique.
Enfin, et dans un délai de quinze jours à la suite de l’immatriculation de la SARL, les représentants légaux devront procéder aux formalités de publicité liées à la constitution de la société.
Plus précisément, un avis doit être inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’État partie du siège social afin d’informer les tiers.
Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : Contacts : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp)
Luc KOUASSI
Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire