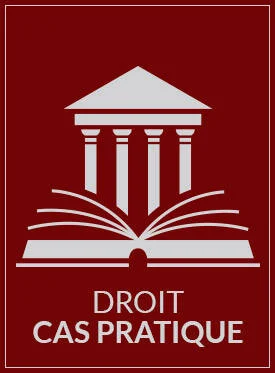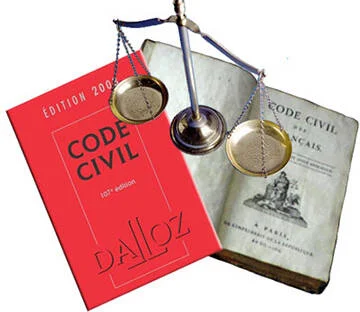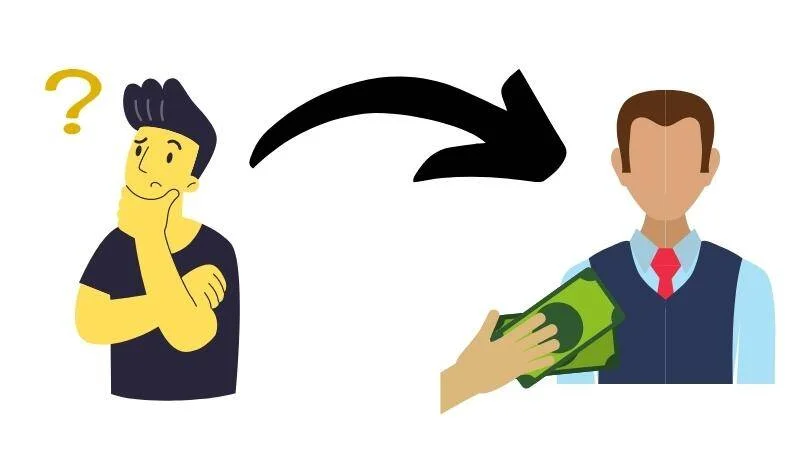Le 1er mars 2010, Anguirande a été embauchée en tant que « commercial » par la société « ARPO PHARMA » dans la vente de produits pharmaceutiques. Le secteur de prospection qui lui est confié est la Seine-et-Marne (77).
Son contrat stipule qu’en cas de rupture, elle ne pourra travailler pour une entreprise concurrente ou exercer une activité similaire dans le département de Seine-et-Marne pendant une période de deux ans.
La clause prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, la salariée percevra une contrepartie financière pendant la période de non-concurrence. Le montant de la contrepartie correspond à 50% du salaire moyen perçu par elle au cours des trois ans précédant la rupture.
Le 1er février 2020, Anguirande démissionne de la société et crée le 1er mai 2020 une entreprise spécialisée dans la vente de produits pharmaceutiques.
Anguirande peut-elle faire l’objet d’une action en justice pour non-respect de l’obligation de non-concurrence ? Si oui, quelles seraient les conséquences juridiques du non-respect de cette obligation ?
Résolution
Faits : Une salariée a conclu un contrat de travail le 1er mars 2010 avec une société spécialisée dans la vente de produits ,pharmaceutiques. Elle a été engagée en tant que « commercial » et est chargée de la prospection en Seine-et-Marne. Elle est régulièrement en contact avec les prospects et la clientèle de l’entreprise.
Son contrat contient une clause de non-concurrence stipulant qu’en cas de rupture du contrat elle ne pourra travailler pour une entreprise concurrente, ou exercer une activité similaire, dans le département de Seine-et-Marne pendant une période de deux ans. Par ailleurs, la clause prévoit qu’en cas de rupture à l’initiative de son employeur, une contrepartie financière lui sera versée pendant la période de non-concurrence égale à 50% du salaire perçu par elle au cours des trois années précédant la rupture.
La salariée démissionne le 1er février 2020 et crée son entreprise de vente de produits pharmaceutiques le 1 mai 2020.
Sur les conditions de la clause de non concurrence
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (Code du travail français, art. L. 1121-1).
Or, la clause de non-concurrence constitue une restriction à la liberté de travailler et à la liberté d’entreprendre de l’ancien salarié (Soc., 9 novembre 1996, 94-19.404) et doit donc, pour être valable, être légitime et proportionnée.
Sur la légitimité de la clause
Problème de droit : La clause imposant une obligation de non-concurrence à l’ancien commercial d’une société spécialisée dans la vente de produits pharmaceutiques est-elle légitime ?
Solution en droit : La Cour de cassation juge régulièrement que la clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et que la légitimité ressort, d’une part, de l’activité de l’entreprise et, d’autre part, des fonctions du salariés (Soc., 9 novembre 1996, 94-19.404).
Solution en l’espèce : En l’espèce, la société exerce une activité de vente de produits pharmaceutiques. Il s’agit d’une activité concurrentielle.
Par ailleurs, la salariée exerce des fonctions de « commercial » avec un secteur de prospection bien défini de sorte qu’elle s’occupe d’une clientèle en particulier. Elle est par ailleurs en contact avec la clientèle de l’entreprise.
Il est donc possible de considérer que l’insertion d’une clause de non-concurrence dans son contrat de travail est légitime en raison de la nature de l’activité de l’entreprise et des fonctions de la salarié salarié.
Sur la proportionnalité de la clause
La proportionnalité de la clause implique un double contrôle. Le champ d’application de la clause doit être limitée et une contrepartie financière doit être prévue au bénéfice du salarié.
Sur le champ d’application de la clause de non-concurrence
Problème de droit : Une clause de non-concurrence peut-elle interdire à un salarié d’accepter toute activité salariée ou non salariée auprès d’une société concurrente et d’exercer une activité similaire pour une durée de deux ans à compter de la rupture des relations contractuelles sur le département de Seine-et-Marne ?
Solution en droit : La clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps (ex : Soc., 13 mars 2019, nº 17-11.197) et l’espace (ex : Soc. 3 juillet 2019 n° 18-16.134).
Elle doit en outre laisser au salarie la possibilité d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience (Soc., 10 juillet 2002, n° 00-45.135).
La clause qui ne permet pas au salarié de retrouver un emploi conforme à son expérience professionnelle est illicite, même si elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Soc. 18 sept. 2002, n°99-46.136).
Solution en l’espèce : La clause de non-concurrence interdit au salarié de travailler pour une entreprise concurrente ou exercer une activité similaire dans le département de Seine-et-Marne pendant une période de deux ans. Le champ géographique (le département de Seine et marne), temporel (deux ans) et professionnel (activités concurrentes) sont donc bien circonscrits.
Par ailleurs, la clause de non-concurrence ne semble pas de nature à empêcher la salariée de retrouver un emploi.
Il ne semble donc pas possible de remettre en cause la clause de non-concurrence sur ce terrain.
Sur la contrepartie de l’obligation de non-concurrence
Problème de droit : Une contrepartie financière égale à 50% du salaire perçu par le salarié au cours des trois ans précédant la rupture et due uniquement en cas de rupture à l’initiative de son employeur pour une obligation de non-concurrence couvrant l’ensemble du département de Seine et Marne pour une durée de deux ans est-elle licite ?
Solution en droit : La clause de non-concurrence doit comporter une contrepartie financière qui doit être réelle et sérieuse (Soc., 18 sept. 2002, n° 99-49.136).
Le versement de l’indemnité de non-concurrence doit être prévu quel que soit le motif de la rupture du contrat. L’ouverture du droit au bénéfice de la contrepartie financière ne peut dépendre du type de rupture.
La clause de non-concurrence qui exclut le versement d’une contrepartie pécuniaire en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur est nulle (Soc., 27 février 2007, n° 05-44.984).
Solution en l’espèce : En l’espèce, sans qu’il ne soit nécessaire de s’interroger sur le montant de la contrepartie à l’obligation de non-concurrence prévue en cas de rupture du contrat de travail, la clause de non-concurrence qui prévoit une contrepartie qui n’est due qu’en cas de rupture à l’initiative de l’employeur est nulle.
Conclusion : Par conséquent, la salariée est fondée à solliciter la nullité de la clause de non-concurrence.
Sur les effets de la nullité de la clause
Problème de droit : La stipulation d’une clause de non-concurrence nulle entraine-t-elle la réparation automatique du préjudice subi par le salarié ?
Solution en droit : Auparavant, même lorsque la clause atteinte de nullité n’avait fait l’objet d’aucune exécution, la Cour de cassation estimait que « la stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié » en limitant tout au long de la relation de travail la possibilité de postuler dans des entreprises concurrentes (Soc., 12 mai 2011, 08- 45.280).
La Cour de cassation est revenue sur cette position et juge sur cette position et juge désormais, même si la clause est déclarée nulle pour absence de contrepartie financière, que le salarié ne peut obtenir de dommages-intérêts que s’il parvient à démontrer le préjudice que lui a causé la stipulation de la clause nulle (Soc., 25 mai 2016, 14-20.578).
Solution en l’espèce : La clause de non-concurrence prévoit une contrepartie financière uniquement en cas de rupture à l’initiative de l’employeur ce qui a pour effet de la rendre nulle au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Anguirande peut réclamer des dommages-intérêts uniquement si elle réussit à établir l’existence et l’étendue du préjudice qu’elle a subi du fait de la stipulation d’une clause illicite dans son contrat.
NB : Le raisonnement peut varier d’un droit positif à un autre alors n’hésitez pas à mettre vos appréhensions en commentaire selon le droit positif de votre pays.