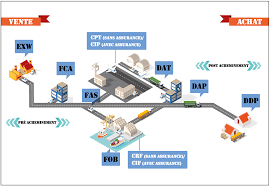Pour « repenser » l’action publique, encore faudrait-il qu’elle ait été préalablement pensée, ce qui est tout sauf certain. Bien peu d’écrits, en effet, tant scientifiques que pédagogiques, révèlent la nature d’une action dont ils se contentent, généralement, de présenter le régime.
En ces temps d’essor du « droit processuel », pourtant, c’est-à-dire de comparaison des différentes procédures, il serait opportun de déterminer enfin ce qui particularise l’action publique des autres actions en justice. Cela serait d’autant plus pertinent que, nul ne l’ignore, ladite action a connu nombre de bouleversements au cours de ces dernières années : essor des pouvoirs de la victime, évolution de l’application des peines, développement des procédures alternatives, remise en cause de l’instruction, etc.
À la fin, l’action publique est- elle encore ce qu’elle devrait être ?
Précisément, qu’est-ce, au juste, que l’action publique ? Une action « pour l’application des peines », pose l’article 1er du Code de procédure pénale. Si sa mise en œuvre ne conduit pas inéluctablement à une peine, tel n’en demeure pas moins l’objet, son déclenchement ayant bien ce seul et unique but. À une infraction commise doit, en principe, répondre la punition de son auteur. Et c’est parce qu’il existe des soupçons à l’encontre d’une personne d’avoir agi de la sorte qu’une juridiction va être saisie pour en juger.
À ce but doit, néanmoins, pour le moment, être rattaché un autre, qui lui est indissociable et qui justifie l’éventuelle dérivation de l’action publique devant un juge préalable – ou préparatoire ou de mise en état : c’est la recherche de la vérité. Il ne devrait effectivement pas exister de peine sans vérité, puisque le doute, autrement dit l’incertitude, profite à l’accusé, en vertu de la présomption d’innocence.
À frapper dans l’obscurité, ne risque-t-on pas surtout de se tromper de cible ?
Faute de trouver la vérité où on la cherchait, des faits vers les personnes qu’on « examine », en bien comme en mal – « à charge et à décharge » –, l’action publique sommeillera puis s’éteindra. Demain, peut-être, lorsque ce mal-aimé de juge d’instruction disparaîtra à son tour, il y aura encore un juge de l’enquête ? des libertés ? de l’enquête et des libertés ? pour contrôler la régularité de la recherche de la vérité et autoriser les actes coercitifs et intrusifs que cela suppose ; mais d’action publique, point, du moins à ce stade.
De là deux questions : l’action publique ne deviendra-t-elle pas une pure action pour l’application des peines ? Quelle action fondera la saisine de ce juge de l’enquête ?
Il reste que les parties à ces actions demeureront les mêmes : ministère public en demande, mis en cause en défense, victime énigmatiquement et épisodiquement présente. C’est, d’ailleurs, à travers les premières que l’on étudie généralement les secondes. Pourtant, le droit de punir, que l’action publique réalise, n’appartient qu’à la société, le ministère public ne faisant alors, au nom de cette dernière, c’est-à-dire comme représentant, que la déclencher et l’exercer. Il le fait, au surplus, en suivant un chemin tracé par le législateur et qui le conduira au juge. Quoi de plus sécurisant que cette association des autorités les plus légitimes ? La procédure pénale qui fait peur est toujours celle qui s’en écarte, en reléguant le juge à des autorisations et des contrôles.
À la victime qui, après tout, est une composante inévitable de la plupart des situations pénales, on concède, pour cette raison, quelques prérogatives, la plus importante étant, bien entendu, celle d’obtenir le déclenchement de l’action publique.
Quant au mis en cause, il n’est plus seulement présumé innocent: bénéficiant de l’essor du principe du contradictoire, pilier du procès équitable à l’européenne, il est, aujourd’hui, une partie au sens fort du procès pénal au sens strict. Ses armes juridiques sont similaires à celles dont dispose le ministère public.
Toutefois, c’est surtout en amont et en aval du procès de la peine que les choses ont le plus évolué.
En amont du procès, la politique pénale, à laquelle le ministère public est soumis, mais qu’il participe également à déterminer – paradoxe hiérarchique –, s’est étoffée à un point tel qu’il apparaît difficile d’affirmer encore que, dans ce cadre, il n’a pas la disposition de l’action publique. L’opportunité dont il dispose pour recourir à telle ou telle réponse pénale, d’autant plus étendue que ces réponses sont de plus en plus nombreuses, démontre que l’action publique ne représente plus qu’un élément au sein de cette politique ; l’élément principal, sans doute, car même si elle n’est pas la voie la plus empruntée, c’est sa menace qui garantit l’efficacité de la plupart des autres.
Ceci précisé, l’opportunité du déclenchement de l’action publique ne diffère guère de celle du déclenchement d’une action privée, l’éthique gouvernant alors, pour celle-ci, ce que le droit autorise où, comme on vient de le dire pour celle-là, la politique le fait en vertu de cette même autorisation. En revanche, une fois exercée, l’action publique, contrairement à l’action privée, devient proprement indisponible: point d’abandon, de transaction, de désistement ou d’acquiescement. Quel que soit l’avis du ministère public, qui peut ne pas ou ne plus l’assumer, elle doit parvenir à son terme, le juge saisi étant le seul à décider s’il s’agira de faire appliquer une peine.
N’est-il question, pour autant, que de faire appliquer la loi, comme semble le dire l’article 31 du Code de procédure pénale ? L’action serait, en ce sens, « objective », au moins du point de vue de son demandeur, ce qui se conçoit mieux depuis que le législateur a ajouté, à la fin de ce texte, que le ministère public agit « dans le respect du principe d’impartialité auquel il est tenu ». Est- il d’objectivité sans impartialité ? Il n’empêche : l’affirmation a peu d’incidence tant que le statut des magistrats concernés, qui ne sont, en réalité, ni indépendants ni impartiaux, n’est pas réformé. Dans l’attente, on ne saurait donc affirmer que l’action publique soit plus objective qu’une autre. Tout au plus est- elle portée par l’intérêt général plutôt que par un intérêt particulier ; elle n’est donc pas « désintéressée » !
En conséquence, la réforme du ministère public est urgente, car c’est bien lui qui a été le principal destinataire des grandes évolutions procédurales de ces dernières années. Il s’est, on le sait, opéré une contractualisation de la justice pénale, ce qui ne signifie pas que cette dernière s’est, par là même, privatisée, comme on l’affirme si souvent. Le contrat, en effet, n’est ni privé ni public ; c’est un outil qui, en l’occurrence, est à la disposition du seul ministère public, dont le rôle s’est accru au fur et à mesure des années. De plus, si sont effectivement en question des contrats, ce ne sont alors que des contrats d’adhésion. C’est dire que, en vérité, le procès pénal n’a peut-être jamais été aussi public que depuis qu’il est devenu la chose du ministère public. Là est peut-être la seule et véritable révolution !
En aval du procès, qu’il y ait condamnation ou pas, l’action publique est-elle éteinte ?
L’autorité de la chose jugée bénéficie assurément à celui qui, pour des raisons de droit, n’est pas condamné. Mais, à l’inverse, quelle action fonde les demandes en révision et en réexamen régies par les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ? Est-on alors confronté à la renaissance de l’action publique ou au déclenchement d’une nouvelle action ?
La première réponse signifierait que l’impératif de vérité est principalement et non accessoirement consubstantiel à l’action publique, qui ne se limiterait donc jamais à l’application des peines et rendrait, en droit pénal, l’autorité du jugement plus fragile que dans d’autres matières. En ce sens, pourrait-on faire un lien entre ces recours et l’article 6 du Code de procédure pénale, qui précise que « si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte, l’action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux ». Pourquoi, dès lors, ne pas considérer, par symétrie, que des poursuites ayant faussement entraîné condamnation et, partant, extinction de l’action publique, puissent également conduire à permettre une reprise de ladite action dans le simple but de rétablir la vérité ?
La seconde réponse, quant à elle, qui lierait donc les recours en révision et en réexamen à d’autres actions, ne contribuerait guère à rétablir une théorie générale du procès pénal, en faisant de ces recours des «procédures particulières » du livre IV davantage que des « voies de recours extraordinaires » du livre III. Alors que le pourvoi en cassation est une issue possible de l’action publique, ces recours ne seraient ainsi pas liés à elle. Il faudrait, mais qui en doute encore de nos jours ? refaire le plan du Code de procédure pénale.
Surtout, lorsque la condamnation est assumée, c’est-à-dire lorsque la peine est mise à exécution, celle-ci demeure un objet litigieux qu’un magistrat spécialisé, le juge de l’application des peines, est compétent pour connaître. Le fondement de son intervention est-il encore l’action publique ? Une fois de plus, il existe deux façons de voir les choses.
L’action pour « l’application des peines », autrement dit l’action publique, ne prend-elle pas fin seulement lorsque la peine est exécutée ? Après tout, le processus punitif n’a vocation à s’achever qu’à l’issue de la punition du condamné ; ne serait-il alors pas logique que cela soit également le cas de l’action qui a conduit à la punition, à partir du moment où cette dernière ne se cristallise que lors de son achèvement ? En ce sens, rappelons que le passage d’un juge à l’autre, du juge qui instruit au juge qui condamne, n’apparaît pas comme un obstacle à la continuité de l’action publique. Pourquoi en irait-il différemment du passage du juge qui fait la condamnation au juge qui fait exécuter la condamnation ?
Le problème est que l’article 6 du Code de procédure pénale dispose que « l’action publique pour l’application de la peine s’éteint par (…) la chose jugée » et non par « la peine exécutée ». Là encore, on pourrait concevoir la décision du juge d’instruction, en l’occurrence de renvoi et non pas de non-lieu, comme la preuve de la relativité de cette règle : une chose est jugée, qui ne va pourtant pas conduire à la fin de l’action publique. C’est que la question de la peine, elle, n’est pas encore tranchée. Tel sera le rôle de la juridiction de jugement dont il est difficile de contester, lorsqu’elle a rendu sa décision, que quelque chose ne s’est pas achevé. Mais c’est alors plus de culpabilité et de condamnation dont il est question, celles-ci étant, en principe irrévocables, que d’une peine qui, à la fin, servira plus de référence pour la peine qui sera réellement exécutée…
En conclusion de cet état des lieux très et trop succinct, toutes ces questions et ces alternatives démontrent, au-delà de la nécessité évidente de penser et repenser l’action publique, un impératif plus ambitieux encore : celui de mieux construire la procédure pénale et le code qui l’accueille. On se prend à rêver, en effet, d’un ouvrage ambitieux qui lierait théorie et pratique avec élégance aussi bien qu’efficacité.
Guillaume BEAUSSONIE, Professeur à l’Université Toulouse 1-Capitole IEJUC (EA 1919)