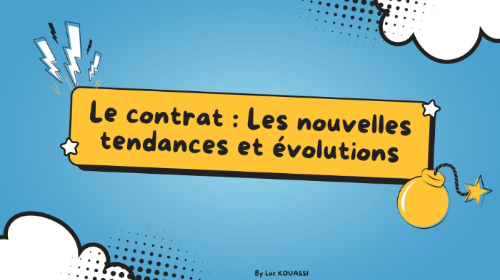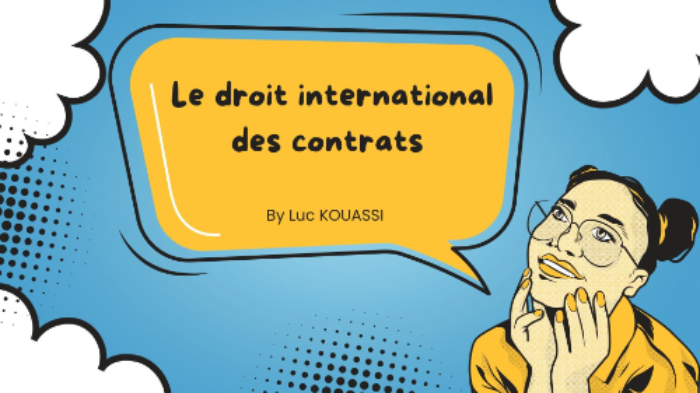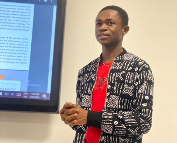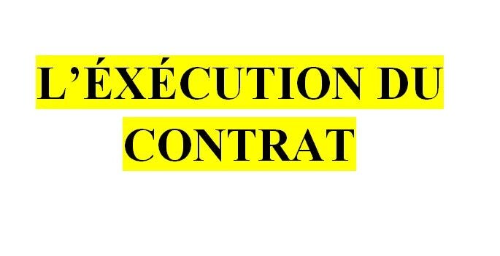Le recours aux structures sociétaires se prête à des fins multiples et différenciées, parfois étranges, voire pernicieuses pour les participants, les tiers et l’intérêt général[1]. Aussi le schéma habituel de la société organisant juridiquement une entreprise industrielle ou commerciale s’en trouve affecté de manière à ce que la société se trouve désorientée de ses objectifs légaux pour être utilisée à des fins illicites comme par exemple le blanchiment d’argent .En effet, pour justifier la provenance de leurs revenus illicites , les blanchisseurs ont généralement besoin d’un certain nombre de sociétés pour qu’ils puissent agir dans un cadre légal , ces sociétés vont être purement fictives , des entités artificiellement dotées de la personnalité morale, qui n’existent qu’en nom et ne correspondent à aucune réalité .
Les sociétés fictives constituent un instrument idéal pour le blanchiment d’argent, grâce à leur ensemble de caractéristiques et aux moyens qu’elles utilisent pour dissimuler discrètement l’origine illégale de l’argent. Ces outils incluent la simulation illicite, un procédé fondamental sur lequel les sociétés fictives frauduleuses s’appuient.
I. La simulation illicite : un procédé fondamental émanant des sociétés fictives
La simulation illicite constitue une technique fondamentale utilisée par les sociétés fictives dans le but de faciliter le blanchiment d’argent, et c’est précisément cette technique qui les différencie des sociétés fictives relevant du droit civil. Ainsi, il est essentiel d’approfondir l’étude de cette technique pour mieux appréhender la spécificité des sociétés fictives du droit pénal et pour mieux comprendre leur mode de fonctionnement en général.
A- La définition de la simulation illicite
Le législateur Tunisien n’a pas présenté une définition de la simulation même en droit civil, il s’est contenté d’en référer au niveau de l’article 26 du C.O.C en évoquant le terme de « contres lettres », cet article dispose que : « Les contre-lettres ou autres déclarations écrites n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et leurs héritiers. Elles ne peuvent être opposées aux tiers, s’ils n’en ont eu connaissance ; les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article. »
En droit français, la simulation est prévue à l’article 1201 du code civil qui dispose :
« Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir. »
A ce niveau, une définition étymologique de la simulation ne manquerait pas d’importance. Le dictionnaire juridique de Gérard Cornu l’a définit comme étant le « fait de créer un acte juridique apparent (dit ostensible) qui ne correspond pas à la réalité des choses, soit pour faire croire à l’existence d’une opération imaginaire, soit pour masquer la nature ou le contenu réel de l’opération (ex. dissimulation du prix, déguisement d’une donation en vente), soit pour tenir secrète la personnalité d’une ou de plusieurs des parties à l’opération (interposition de personnes), etc.»[2]
On peut déduire de cette définition que la simulation se base sur deux situations : une situation apparente et une situation occulte. La première est trompeuse alors que la deuxième traduit la volonté réelle des parties, une volonté qui veut rester caché. Pour se faire, elle utilisera un couvert convenable.
La simulation est une pratique ancienne, déjà connue du droit romain. La simulation consiste, de façon générale, à créer une fausse apparence afin de dissimuler la réalité (…) . Il faut qu’il ait deux conventions une apparente dont les effets soient modifiés ou supprimés par une autre convention, destinée à rester secrète, que l’on appelle « contre-lettre ».
B- La simulation n’est pas d’essence illicite
Le plus souvent la simulation tend à permettre une fraude à la loi, spécialement une fraude fiscale, ou aux droits des tiers, notamment des créanciers ou des héritiers. Mais, la simulation peut également avoir un but moralement neutre, tel, pour des commerçants, le souci de ne pas révéler leurs marchés à des concurrents, ou même louable, tel le désir de ne pas faire apparaitre une action charitable. C’est pour cela que la simulation ne peut donc, malgré certaines tendances contestables de la jurisprudence être assimilée à la fraude. [3]
Il convient de noter que la simulation n’est pas d’essence illicite, elle le devient dans le cadre du droit des sociétés lorsqu’elle est employée pour contourner certaines dispositions d’ordre public, elle est alors constitutive d’une véritable fraude à la loi .La simulation est illicite lorsque l’acte apparent cache un acte secret contenant des stipulations contraires à l’ordre public.
ABEILLE préconisait une recherche des mobiles qui président à l’utilisation du procédé de la simulation parce qu’il pensait que c’est cette analyse qui ferait ressortir la licéité ou l’illicéité de la simulation.[4]
Par exemple, lorsque la cause réelle de l’acte est la dissimulation de l’origine sale de l’argent, cette cause n’apparaitra pas au grand public, elle sera masquée par une cause ayant une apparence légale.
C’est dans ce cadre que se présente la société fictive au service du blanchiment d’argent, celle-ci est le résultat d’un emploi abusif de la technique sociétaire, destinée à occulter un objectif illicite à travers le procédé de simulation illicite.
Quels que soient les motifs qui président à la création d’une société écran, l’utilisation du procédé de la simulation crée une dissociation entre l’apparence et la réalité. La simulation cachera dans ce cas une réalité illicite, elle n’est plus neutre et se transformera en un procédé permettant de réaliser une violation de la loi.[5] Il s’agit de mettre en œuvre la société personne morale dans le seul dessein de cacher une réalité illicite en recourant à plusieurs procédés artificiels.
De manière générale, la règle sacrée des blanchisseurs d’argent pour réussir une opération de blanchiment d’argent est de toujours faire en sorte qu’elle ressemble le plus possible à une opération légale. Par conséquent, les procédés utilisés ne sont eux-mêmes que de simples méthodes inspirées par ceux employées par les entreprises licites. Ainsi, la tarification de cessions internes entre entreprises affiliées de sociétés transnationales lorsqu’elle est utilisée par des criminels, se transforme en une fausse facturation; les opérations immobilières entre entreprises affiliées deviennent de la carambouille, les crédits adossés des escroqueries, les opérations sur titres et sur options maquillent de fausses plus-values, et les opérations de compensation déguisent des plans bancaires interlopes. À première vue, il peut être impossible de distinguer les procédés licites des procédés illicites; la différence n’apparaît clairement que lorsqu’une activité criminelle a été repérée et que les autorités commencent alors à démêler l’écheveau.[6]
D’ailleurs la simulation illicite en tant que procédé qui préside la création de la société fictive, découle de la transformation des actes légaux à des outils parfaits pour le blanchiment d’argent. Étant donné la gravité de ce procédé et son rôle clé dans le cadre du blanchiment d’argent, il est essentiel de se pencher sur la question de sa preuve après avoir présenté les différentes typologies de cette pratique. En effet, la preuve de la simulation illicite constitue un moyen indispensable permettant de démasquer les sociétés fictives et de mettre un frein à la pratique de blanchiment d’argent par l’intermédiaire de ces entités.
II. La preuve de la simulation illicite : une mission plus au moins compliquée
L’analyse phénoménologique de la société écran a montré que celle-ci résulte de l’utilisation du procédé de la simulation, fortement prisée par les acteurs juridiques. Pour prouver l’existence d’une simulation illicite, il est nécessaire de rechercher les conditions réelles de l’acte afin de mettre en lumière le caractère trompeur de l’apparence. Il s’agit ainsi de démontrer que, derrière la façade d’une société, il n’y a en réalité qu’un seul maître de l’affaire.[7]Cependant, cette tâche n’est pas assez évidente.
A- L’acte sociétaire ne peut pas démasquer la fictivité d’une société
En effet, la simulation illicite n’apparaitra pas dans la majorité des cas de prime abord. Seuls les actes trahiront les mobiles réels de leurs auteurs .Il en résulte que l’appréciation de la licéité de l’objet social, n’aurait pas de sens si elle était cantonnée à l’objet statutaire, c’est l’activité réellement exercée qu’il faut apprécier pour pouvoir déceler la licéité de l’objet social.[8]
La difficulté de preuve d’une société fictive naît en effet de ce que la fictivité d’une société n’apparaît pas généralement dés sa création, car celle-ci sera formellement immunisée. En effet, il est rare en pratique qu’une société soit crée dans le mépris des conditions légales. Ce qui obligera le juge à envisager aussi la fictivité liée au déroulement de la vie sociale.
En effet, les cas d’espèce ont révélé l’existence de sociétés nées viables et valides mais qui au cours de leur existence, deviennent des sociétés écrans . Tel est le cas des sociétés qui exercent une activité légale de restauration par exemple et qui servent par la suite au blanchiment de profits résultant d’activités illicites. Il s’agit bien d’une société fictive puisqu’il y a l’utilisation de la personnalité morale avec création d’une apparence contraire à la réalité, le procédé de simulation illicite est clairement mise en œuvre L’apparence est ici l’existence d’une activité légale mais, la réalité révèle une activité illicite.[9]
Plusieurs indices de fictivité peuvent apparaitre au cours de la vie sociale, à savoir le défaut d’activité de la société, un indice qui peut être déduit à travers plusieurs faits à savoir : l’absence de réunion des organes sociaux, lorsque la société ne tient aucune assemblée générale, le conseil de surveillance ne se réunit pas. Les juges mettent aussi l’accent sur l’absence de nomination d’un commissaire aux comptes. Ils se focalisent également sur l’absence de tenue d’une comptabilité digne de ce nom, lorsque la société ne fournit aucun bilan, compte de résultat ou inventaire. L’absence de nomination d’un commissaire aux comptes au sein de la société peut refléter aussi sa fictivité. En bref, la société est jugée fictive quand elle ne fonctionne aucunement comme une société.
B- Un faisceau d’indices détermine la fictivité d’une société
La révélation d’un seul indice parmi ceux sus-indiqués ne peut suffire pour prouver la fictivité d’une société. En effet, il est nécessaire de réunir un ensemble d’indices, ce qui reflète de plus en plus la complexité de la preuve en matière de société fictive.
La société fictive est souvent caractérisée par la présence d’un associé omnipotent .Unique membre actif et seul bénéficiaire des résultats sociaux, il détient généralement la quasi-totalité du capital social alors que le solde est réparti sur la tête des personnes qui lui sont proches. A l’inverse, le rôle des autres associés est totalement gommé : ils se désintéressent des affaires sociales, n’exerçant ni leur droit de vote, ni le droit à l’information ; leurs parts dans le capital social ne sont pas libérées, ils ne perçoivent aucun bénéfice et s’il y a répartition des profits, elle est le plus souvent fictive. Pas d’affectio societatis, pas d’apports, pas de participation aux bénéfices et aux pertes : tout indique à l’évidence que ces prétendus associés ne sont que des prête-noms détenant les parts pour le compte du maitre de l’affaire.[10]
Mais, il faut noter que l’emprise exclusive d’un associé exprimée par une très forte participation au capital social est fréquemment relevée par les juges mais sans systématiquement être un indice définitif de la fictivité d’une société.[11] Ainsi la cour de cassation française a jugé que le fait qu’un associé détienne dans une SARL 480 parts sur les 500 dont se composait le capital social ne s’opposait pas à ce que la société eut une existence réelle.[12]
Dans plusieurs cas, la jurisprudence se montre tolérante en présence d’un associé prépondérant dès lors que celui-ci se borne à exercer les droits correspondant à sa participation dans le capital.
Cela confirme davantage qu’il n’existe pas de critère unique et définitif pour déterminer la fictivité d’une société. La preuve de cette fictivité résulte d’une analyse globale de divers signes qui se manifestent au cours de la vie sociale.
Réferences
[1]DIENER (P.), « Un abus de la personnalité morale : les sociétés en sommeil », In Dix ans de droit de l’entreprise, Éditions Libraire Techniques, 1978, p.83.
[2]CORNU (G.), Vocabulaire juridique, 12e édition, Presses Universitaires de France – P.U.F, 2018. p.2042.
[3]GHESTIN (J.), BILLIAU (M.), Traité de droit civil : les obligations, les effets du contrat, L.G.D.J, 1992, p707.
[4]ABEILLE (J.), La simulation dans la vie juridique et particulièrement dans le droit des sociétés, Thèse, Aix-Marseille, 1938, p.65.
[5]CUTAJAR–RIVIÈRE (CH.), La société écran : Essai sur sa notion et son régime juridique, L.G.D.J, 1998, p.248.
[6]Nations unies (Mai 1998), Étude « Paradis financiers, secret bancaire et blanchiment d’argent », Prévention du crime et justice pénale : bulletin d’information Technical series du PNUCID, Num. 34-358 , disponible sur ce lien : https://www.imolin.org/imolin/finhafre.html (consulté le 26/05/2024)
[7]STOUFFELET (J.), Cité par LAMY Sociétés commerciales, n°432.
[8]CUTAJAR (CH.), op.cit., p.321.
[9]Ibid., p.275.
[10] DEBOISSY (F.), La simulation en droit fiscal, L.G.D.G, 1997. p.93.
[11]Ibidem.
[12]MARTIN-SERF (A.), « Sociétés fictives et frauduleuses », J-C-P, Fasc.7-40, p.6.
Ghada Ghouil
Juriste en droit privé, droit des affaires