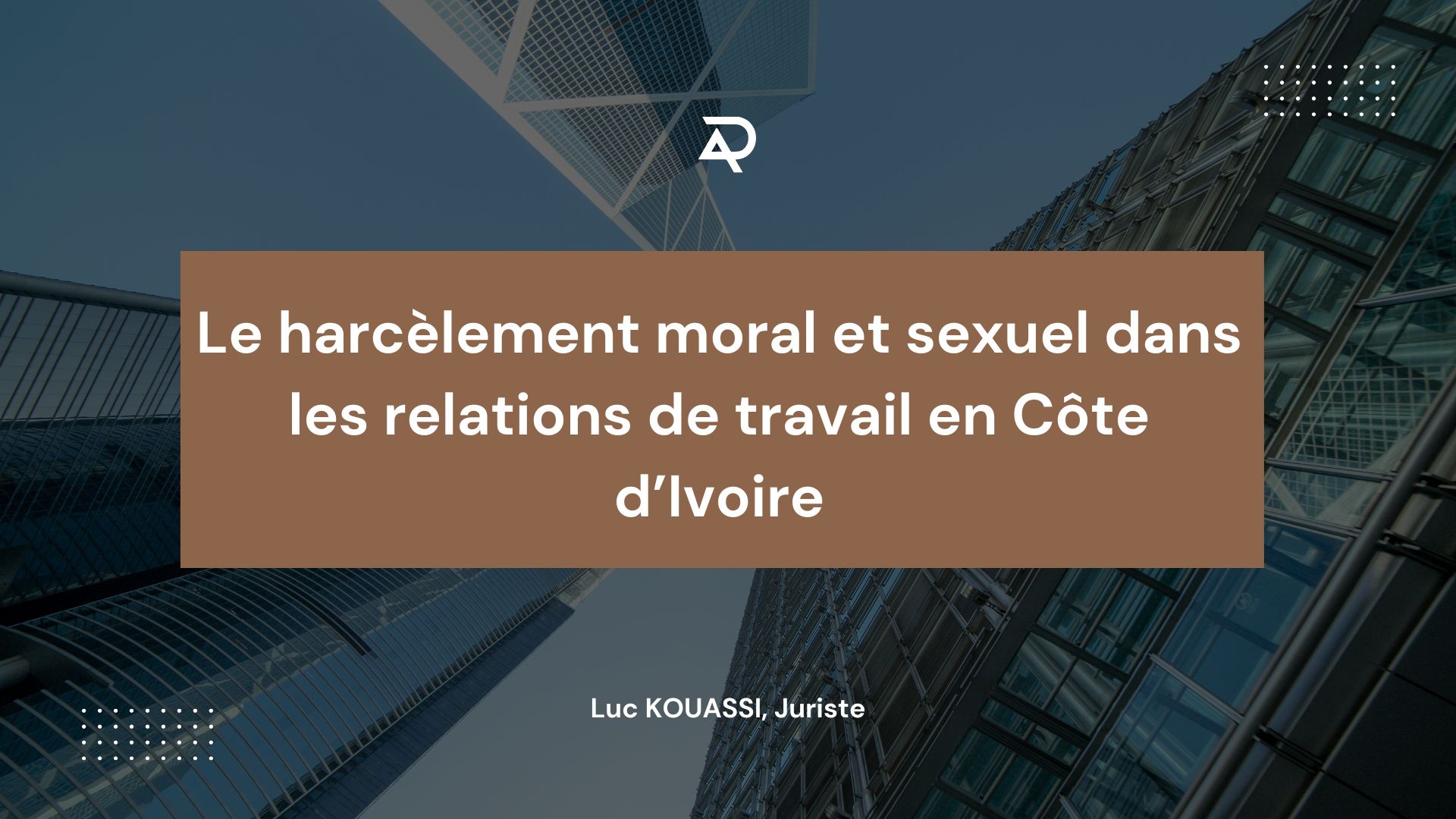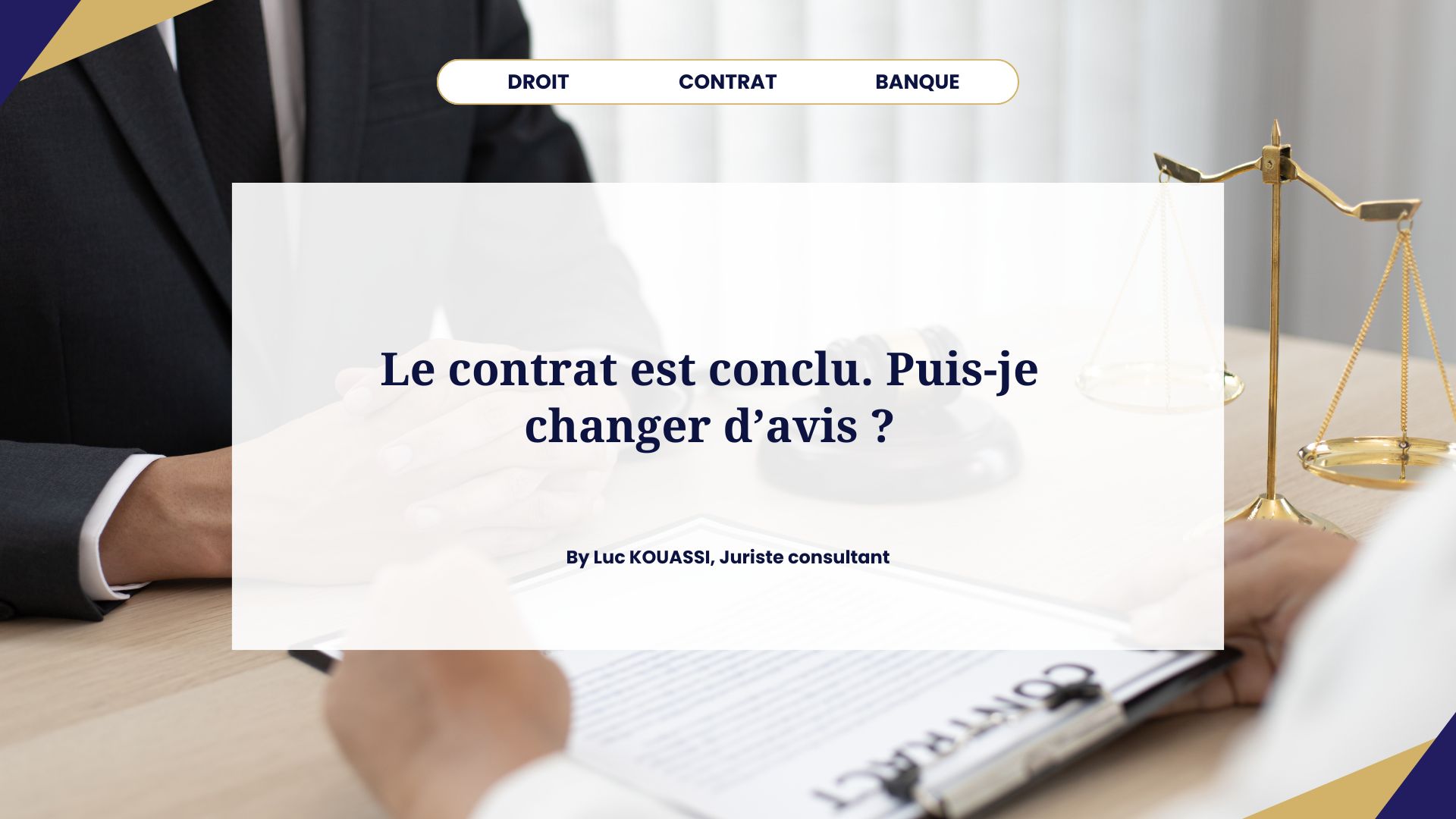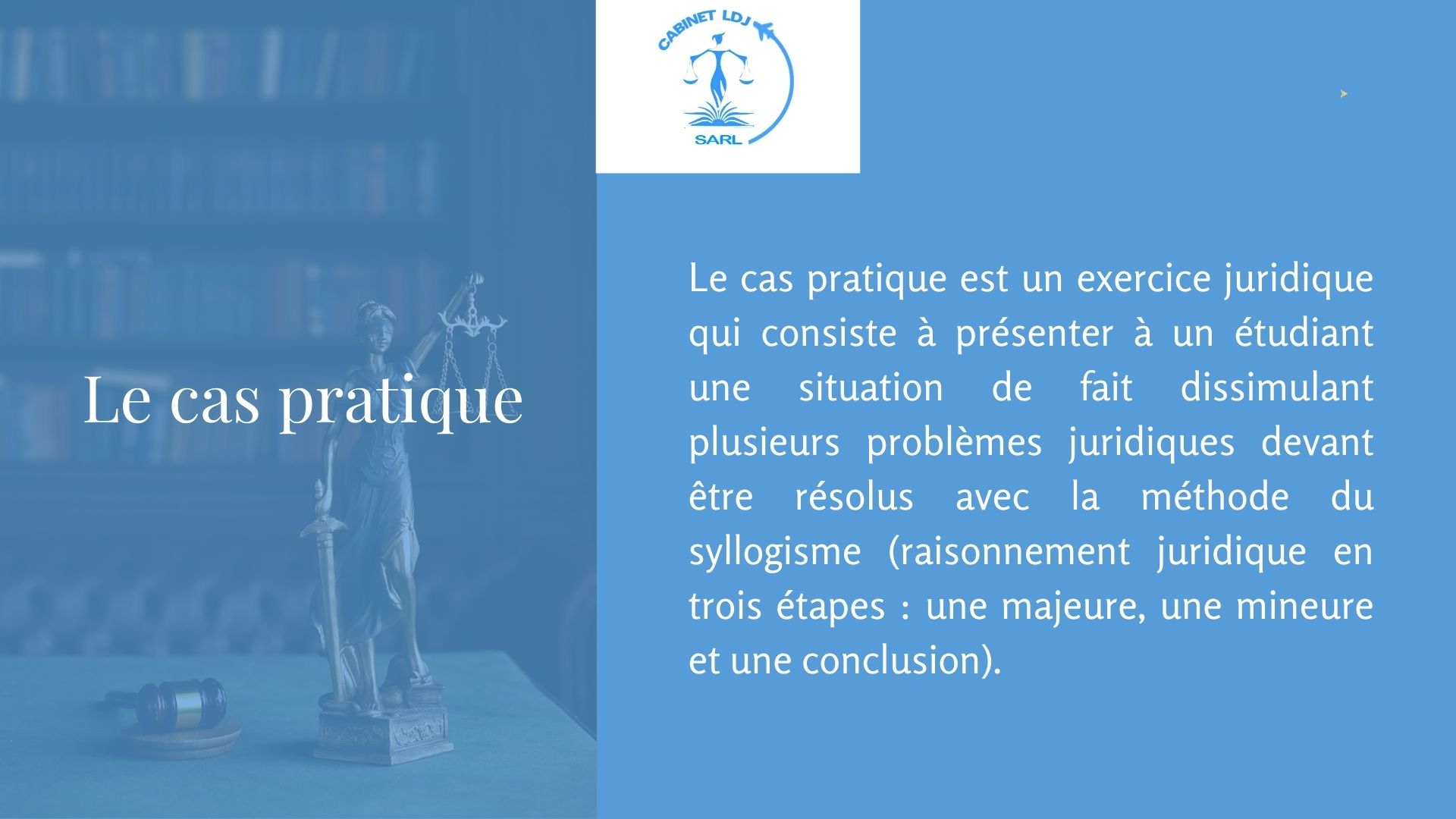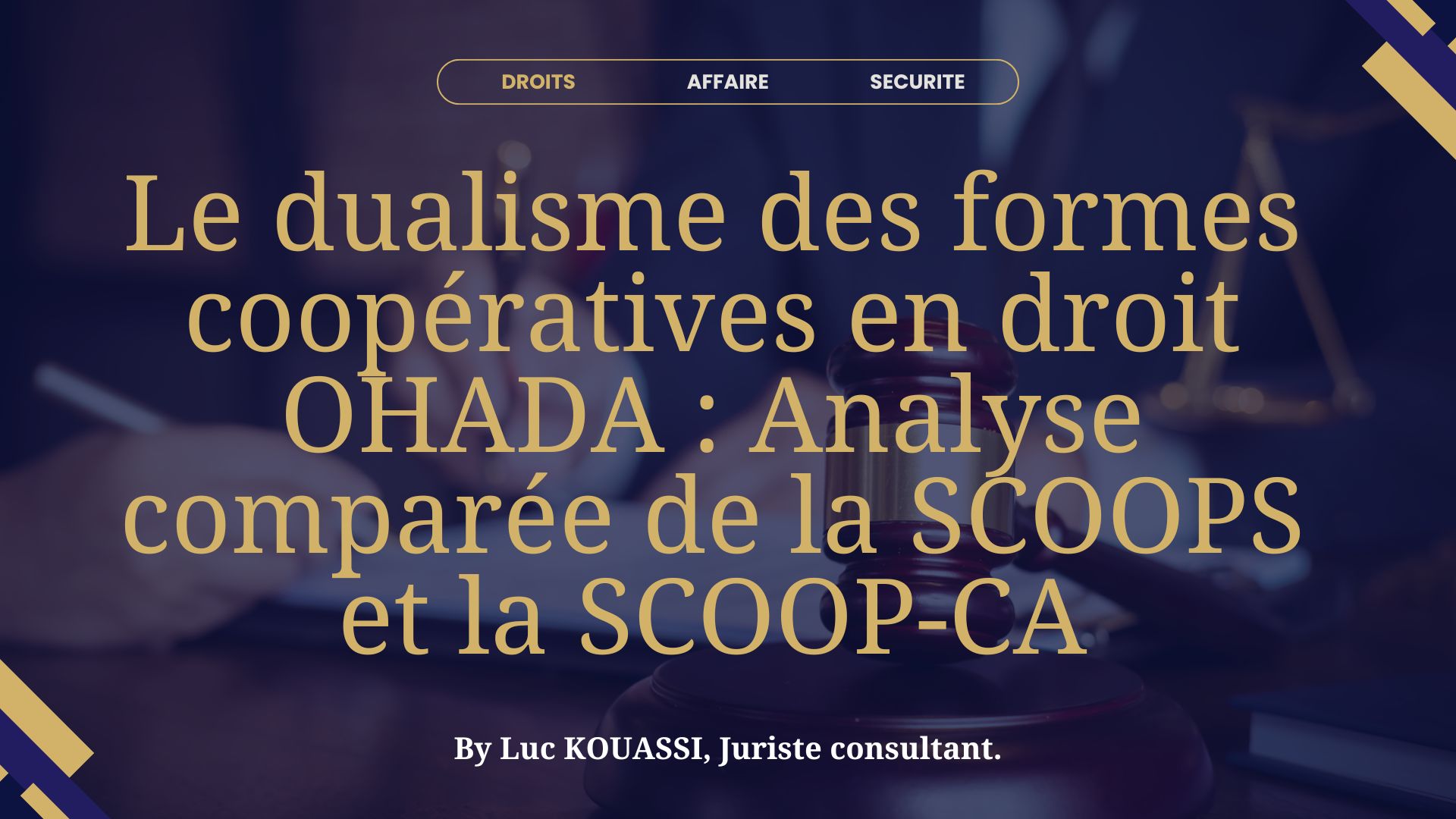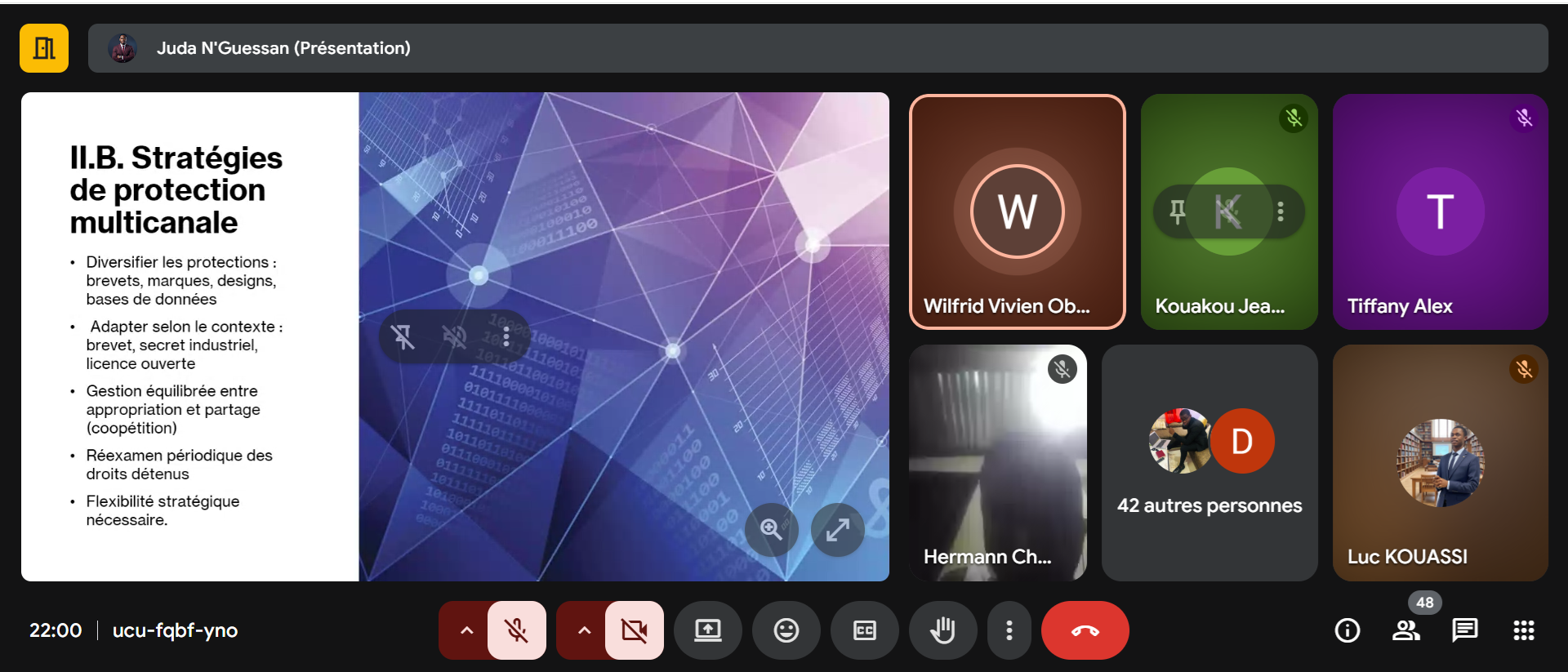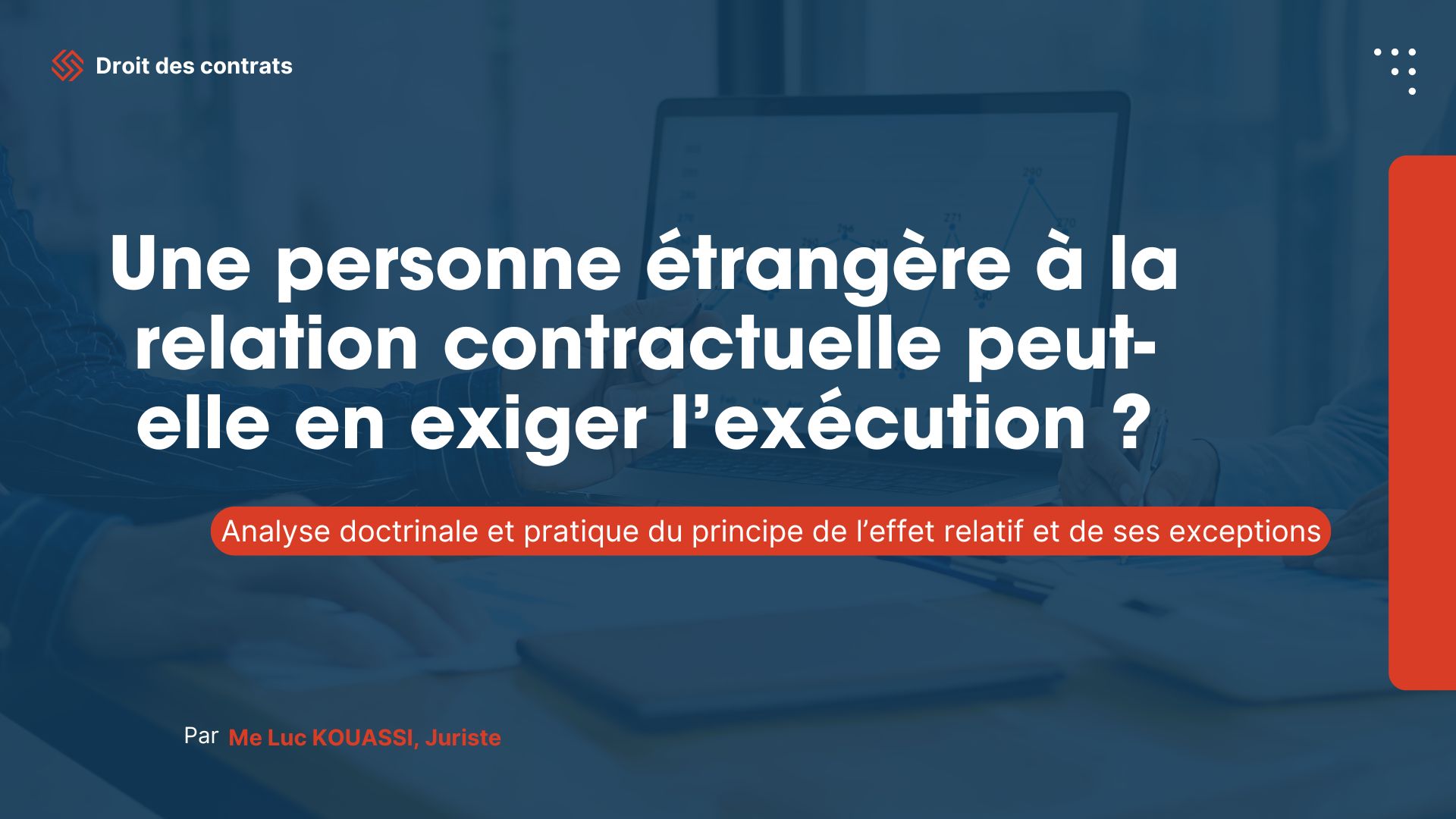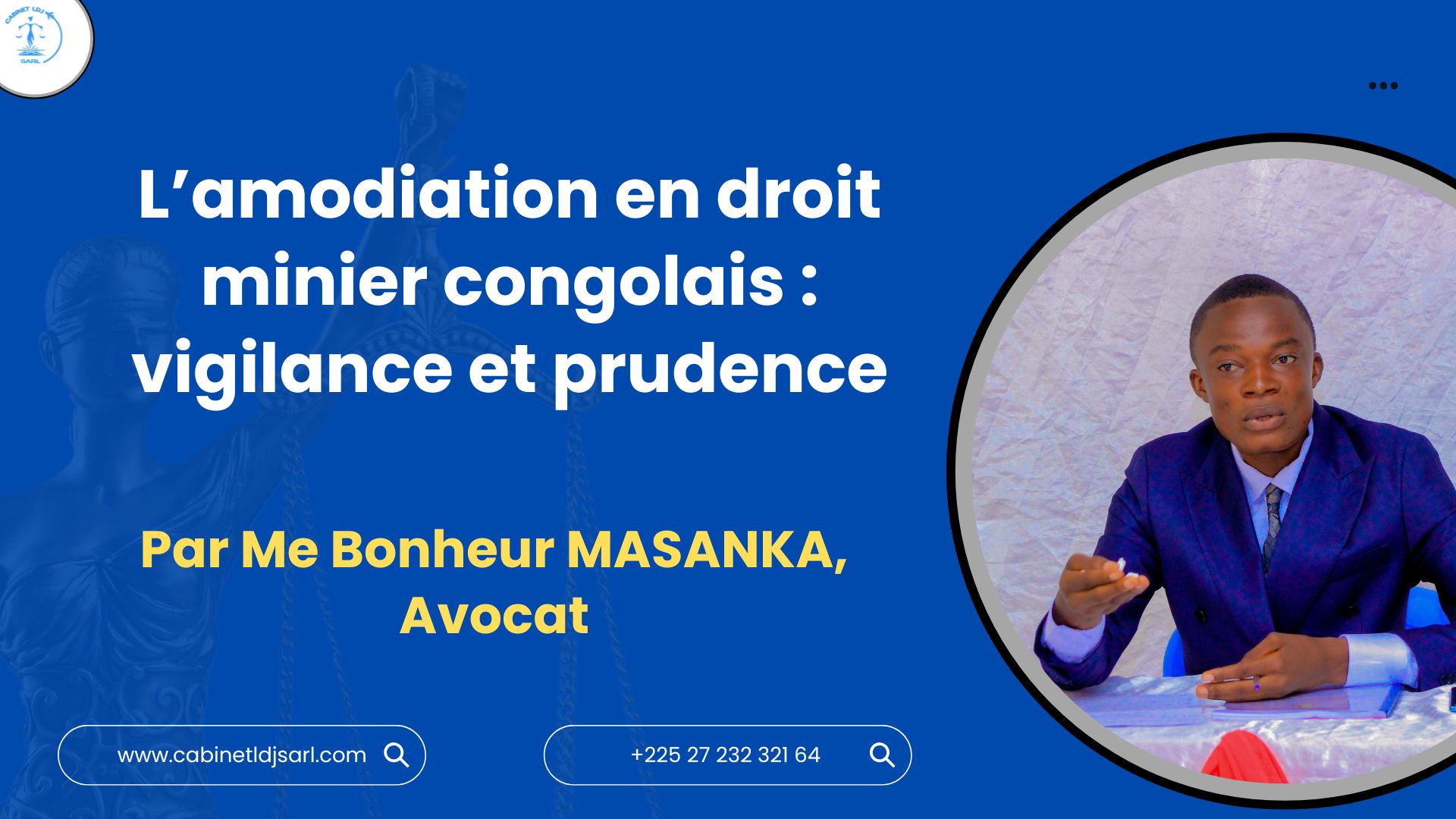Le harcèlement en milieu professionnel est aujourd’hui reconnu comme l’une des principales menaces à la santé psychologique, physique et morale du travailleur. Sa prise en compte juridique résulte d’une lente évolution du droit du travail, longtemps centré sur la protection matérielle du salarié (salaire, sécurité, durée du travail), avant d’intégrer la protection de la dignité humaine au travail comme un droit fondamental. Dans le contexte africain et particulièrement ivoirien, cette problématique prend une dimension singulière : elle se situe au croisement des mutations économiques, de la montée du chômage, de la précarisation des emplois et des rapports hiérarchiques souvent marqués par des asymétries de pouvoir. En effet, le harcèlement moral et sexuel ne se limite pas à des comportements isolés : il traduit un déséquilibre structurel dans la relation de travail. Selon l’analyse de Supiot, le pouvoir de direction de l’employeur comporte toujours une potentialité d’abus, d’où la nécessité d’un encadrement juridique strict pour préserver la personne du salarié contre la « tentation du pouvoir disciplinaire illimité »[1]. Cette dérive peut se manifester par des gestes, propos ou attitudes humiliantes, mais aussi par des mesures d’exclusion, d’isolement ou de déstabilisation systématique visant à contraindre le salarié à quitter l’entreprise.
En Côte d’Ivoire, l’émergence de cette question dans le débat juridique et social témoigne d’une prise de conscience progressive. Le législateur ivoirien a consacré la répression du harcèlement moral et sexuel dans le Code du travail de 2015, qui en offre une définition claire et opérationnelle à l’article 5. Cette évolution répond à la nécessité de lutter contre les abus en entreprise, mais aussi d’assurer la conformité du droit ivoirien aux normes internationales, notamment la Convention n° 190 de l’OIT sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail (2019)[2]. Le harcèlement constitue aujourd’hui un enjeu de santé publique et de gouvernance organisationnelle : il affecte la productivité, altère le climat social, favorise le turn-over, et compromet l’image de l’entreprise. D’un point de vue juridique, il soulève des questions fondamentales : comment concilier la liberté d’organisation de l’entreprise avec la protection de la dignité du travailleur ? Quelle est la frontière entre exigence managériale et abus de pouvoir ? Comment établir la preuve d’un harcèlement dans un contexte de subordination hiérarchique ? Ces interrogations justifient une analyse doctrinale approfondie du dispositif ivoirien.
En effet, l’article 5 du Code du travail ivoirien consacre l’interdiction du harcèlement moral et sexuel comme une règle d’ordre public social. Il définit le harcèlement sexuel comme « tout comportement abusif, menace, attaque, parole, intimidation, écrit, attitude ou agissement répété à connotation sexuelle, ayant pour but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers »[3]. Le harcèlement moral, quant à lui, recouvre « tout comportement abusif, menace, attaque, parole, intimidation, écrit, attitude ou agissement répété ayant pour objet ou pour effet la dégradation des conditions de travail du salarié, portant atteinte à sa dignité ou compromettant son avenir professionnel »[4]. Ces dispositions marquent une rupture nette avec les textes antérieurs, qui ignoraient encore les risques psychosociaux au travail. Elles visent à prévenir et sanctionner des comportements dégradants, souvent silencieux, qui peuvent avoir des conséquences graves sur la santé mentale et physique des travailleurs. Elles participent d’une dynamique globale de constitutionnalisation des droits fondamentaux au travail, dans le sillage de l’article 4 de la Constitution ivoirienne, qui proclame l’égalité de tous devant la loi sans distinction d’origine, de sexe, de religion ou d’opinion[5]. En outre, le Code du travail rattache cette interdiction à l’obligation générale de sécurité de l’employeur. Comme en droit français, celui-ci est tenu d’assurer la protection de la santé physique et mentale de ses salariés (art. L.4121-1 du Code du travail français). En droit ivoirien, cette obligation découle implicitement des articles 41.1 et suivants relatifs à l’hygiène et la sécurité. La Cour de cassation française, dans un arrêt de principe du 21 juin 2006, a jugé que « l’employeur manque à son obligation de sécurité lorsqu’un salarié est victime de harcèlement moral »[6], une interprétation qui pourrait inspirer la jurisprudence ivoirienne à mesure que les contentieux se développent.
Comme susmentionné, sur le plan comparé, la réglementation ivoirienne se distingue par sa clarté rédactionnelle et sa sobriété. Là où le droit français, influencé par les directives européennes (notamment la Directive 2006/54/CE sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes), tend à multiplier les qualifications, le législateur ivoirien opte pour une formulation plus concise mais tout aussi protectrice. Cette approche présente l’avantage de renforcer la lisibilité de la règle pour les acteurs sociaux et d’éviter les interprétations extensives. Le droit international du travail, à travers la Convention OIT n° 190 et la Recommandation n° 206 (2019), impose aux États de prévenir et d’éliminer toutes formes de violence et de harcèlement dans le monde du travail. Ces normes, adoptées avec le soutien de la Côte d’Ivoire, constituent un cadre de référence universel. Elles élargissent la notion de harcèlement au-delà de la sphère du lieu de travail pour englober toute situation professionnelle où un pouvoir est exercé, y compris dans les formations, les déplacements et les communications électroniques. D’un point de vue scientifique, l’étude du harcèlement en droit ivoirien présente un intérêt majeur. Elle permet de mesurer la capacité d’un système juridique africain à intégrer les standards internationaux tout en conservant ses spécificités socio-culturelles. Comme le souligne Jean Carbonnier, « le droit n’est jamais une mécanique universelle : il épouse les coutumes et les sensibilités des peuples qu’il régit »[7]. Le droit ivoirien du harcèlement illustre parfaitement cette adaptation : il traduit une volonté d’humaniser la relation de travail sans rompre avec les réalités économiques du pays.
Cette étude adopte une approche doctrinale, analytique et comparée. Elle s’appuie sur les sources normatives nationales (Code du travail), la jurisprudence pertinente, ainsi que sur les textes internationaux et européens relatifs à la prévention des violences et discriminations au travail. La méthode retenue consiste à examiner le harcèlement sous un double prisme : celui de la dignité du salarié et celui de la responsabilité de l’employeur. La démarche suivra une logique progressive. La première partie sera consacrée au harcèlement sexuel, envisagé comme une atteinte directe à la dignité du travailleur et à son intégrité morale (I). La seconde analysera le harcèlement moral, forme plus diffuse mais tout aussi destructrice, portant sur la dégradation des conditions de travail et la santé mentale du salarié (II). La troisième partie s’intéressera au cadre juridique ivoirien, à sa portée et à ses limites dans la prévention et la répression des faits de harcèlement (III). Enfin, la dernière partie traitera des sanctions et voies de recours, en interrogeant l’efficacité du dispositif et les perspectives d’évolution jurisprudentielle (IV).
I. Le harcèlement sexuel : une atteinte directe à la dignité du travailleur
Le harcèlement sexuel constitue l’une des formes les plus graves d’atteinte à la dignité du travailleur, car il remet en cause à la fois son intégrité physique, morale et professionnelle. Reconnu comme une faute d’une extrême gravité, il appelle une répression ferme et une vigilance accrue dans le cadre des relations de travail. Pour en cerner pleinement la portée juridique, il convient d’abord d’en rappeler la définition légale ainsi que les éléments constitutifs qui en déterminent la qualification (A), avant d’examiner les conditions dans lesquelles cette qualification est juridiquement établie, notamment à travers la question délicate de la charge de la preuve (B).
A. La définition légale et ses composantes essentielles
L’article 5, alinéa 4, du Code du travail définit le harcèlement sexuel comme « tout comportement abusif, menace, attaque, parole, intimidation, écrit, attitude ou agissement répété à connotation sexuelle, ayant pour but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers »[8]. Cette définition, d’une remarquable précision, met en lumière trois éléments constitutifs fondamentaux : la répétition des agissements, leur connotation sexuelle, et la finalité recherchée par l’auteur.
En premier lieu, le caractère répété des agissements constitue l’un des éléments clefs de la définition. Il s’agit ici de distinguer le harcèlement sexuel d’un acte isolé de nature sexuelle, qui relèverait d’une autre qualification (par exemple, une agression ou une tentative d’abus). Le législateur ivoirien rejoint en cela la conception dominante en droit comparé : en droit français, l’article L.1153-1 du Code du travail exige également la répétition d’actes, propos ou comportements ayant pour objet ou effet d’imposer à une personne des propos ou comportements à connotation sexuelle[9]. Cette exigence vise à caractériser un climat de contrainte ou d’intimidation durable au sein de la relation de travail. Toutefois, la jurisprudence française a parfois admis que des faits isolés mais d’une gravité extrême puissent suffire à constituer un harcèlement sexuel, notamment lorsqu’ils s’accompagnent d’un abus d’autorité ou d’une pression manifeste[10]. Ce glissement jurisprudentiel pourrait inspirer le juge ivoirien, surtout dans les contextes où la relation hiérarchique est marquée par une forte dépendance économique ou sociale du salarié vis-à-vis de l’employeur.
En second lieu, la connotation sexuelle constitue l’élément matériel du harcèlement. Elle peut se manifester sous diverses formes : gestes déplacés, paroles suggestives, insinuations, ou demandes explicites de nature sexuelle. Le droit ivoirien, à l’instar du droit français, ne limite pas le harcèlement sexuel aux seules propositions directes de rapports sexuels. Il englobe aussi des comportements implicites ou des allusions répétées créant un climat hostile, humiliant ou intimidant[11]. Cette conception rejoint la doctrine de Supiot, pour qui le harcèlement sexuel est une « violation de la dignité du salarié dans ce qu’elle a de plus intime : le respect de son corps et de sa volonté »[12]. Elle s’aligne également sur les principes énoncés par la Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006, selon laquelle « le harcèlement sexuel doit être considéré comme une discrimination fondée sur le sexe », imposant aux États membres de le prohiber explicitement[13]. Le caractère subjectif de la connotation sexuelle rend la qualification complexe : elle suppose une appréciation du contexte, de l’intention et de la perception du salarié. Le juge doit donc évaluer si les propos ou gestes, même anodins en apparence, ont eu pour effet de porter atteinte à la dignité du travailleur. Cette approche, centrée sur l’effet ressenti plutôt que sur l’intention, est désormais dominante dans la jurisprudence comparée[14].
En dernier lieu, le texte ivoirien mentionne expressément que les comportements doivent avoir pour « but d’obtenir des faveurs sexuelles à son profit ou au profit d’un tiers ». Ce critère distingue le harcèlement sexuel d’autres formes de comportements déplacés. Il met en exergue la dimension intentionnelle de l’acte : l’auteur agit dans le dessein d’obtenir un avantage d’ordre sexuel, souvent en abusant de sa position hiérarchique ou de son autorité professionnelle. Cependant, la jurisprudence française a progressivement admis que l’absence d’intention de nuire ne suffit pas à exclure la qualification de harcèlement, dès lors que les faits ont objectivement créé un climat intimidant ou humiliant[15]. Il est probable que le juge ivoirien, confronté à des situations analogues, adopte une approche similaire, privilégiant la protection du salarié sur la démonstration d’une intention explicite.
Ainsi, la définition ivoirienne du harcèlement sexuel, bien que concise, se révèle d’une portée protectrice considérable. Elle combine les exigences du droit comparé tout en intégrant des spécificités adaptées au contexte socioculturel national.
B. La qualification juridique et la charge de la preuve
Le harcèlement sexuel peut être appréhendé sous un double angle juridique : celui du droit disciplinaire et celui du droit civil. D’un point de vue disciplinaire, il constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat de son auteur, sans préavis ni indemnité. En effet, un tel comportement est incompatible avec la relation de confiance nécessaire au contrat de travail. Le juge ivoirien, à l’instar de la Cour de cassation française, pourrait qualifier ces faits de « manquement à l’obligation de respect due à ses collaborateurs »[16]. Sur le plan civil, le harcèlement engage la responsabilité de l’employeur au titre de son obligation générale de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des salariés. En droit ivoirien, bien que cette obligation ne soit pas expressément formulée dans les mêmes termes que l’article L.4121-1 du Code du travail français, elle découle implicitement des articles relatifs à la sécurité et à la dignité au travail. Dès lors, l’employeur peut voir sa responsabilité engagée, même s’il n’est pas l’auteur direct du harcèlement, dès lors qu’il a toléré ou ignoré des comportements abusifs au sein de son entreprise[17]. Cette logique protectrice découle d’une jurisprudence bien établie en France : dans un arrêt du 27 octobre 2004, la Cour de cassation a jugé qu’« un employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs »[18]. Cette position, reprise par la doctrine (Lhernould, Despax), a contribué à renforcer la prévention du harcèlement comme une composante essentielle du management éthique de l’entreprise[19].
Par ailleurs, la preuve du harcèlement sexuel demeure l’un des principaux obstacles à la mise en œuvre effective de la protection légale. Les faits se déroulent souvent sans témoin, dans un cadre hiérarchique fermé, et le salarié craint des représailles. Conscient de cette difficulté, le droit comparé et notamment le droit européen a introduit un aménagement de la charge de la preuve, repris en France à l’article L.1154-1 du Code du travail, selon lequel « le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement », et il appartient alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement[20]. Bien que le droit ivoirien ne contienne pas encore une disposition similaire, la jurisprudence pourrait, par analogie, adopter une telle solution. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé dans l’arrêt Danosa (2010) que l’efficacité du droit à la non-discrimination exige que la victime ne supporte pas seule la charge de la preuve[21]. Ce principe de facilitation probatoire est également consacré par l’article 9 de la Convention OIT n° 190, qui impose aux États d’adopter des mécanismes de preuve adaptés à la réalité des victimes de harcèlement[22]. Dans le contexte ivoirien, l’aménagement de la preuve apparaît indispensable pour garantir une effectivité réelle du droit. Comme le souligne Lhernould, « la force du droit du travail ne se mesure pas seulement à la rigueur de ses interdictions, mais à la possibilité pour le salarié d’en obtenir l’application »[23]. L’adoption d’une telle approche permettrait d’équilibrer le rapport de force entre employeur et salarié, et de renforcer la confiance dans les institutions judiciaires du travail.
II. Le harcèlement moral : une violence insidieuse et destructrice
À la différence du harcèlement sexuel, le harcèlement moral se distingue par sa nature sournoise et progressive, rendant souvent sa détection et sa répression plus difficiles. Il s’agit d’une forme de violence psychologique qui altère profondément les conditions de travail et compromet la santé physique et mentale du salarié. Afin d’en mesurer toute la gravité, il convient d’abord d’en préciser la définition légale ainsi que les éléments permettant sa caractérisation au regard du droit du travail (A), avant d’examiner les conséquences concrètes qu’il entraîne sur la santé du travailleur et la responsabilité juridique qui en découle pour l’employeur (B).
A. Définition et caractérisation légale du harcèlement moral
L’article 5, alinéa 3, du Code du travail ivoirien définit le harcèlement moral comme « les comportements abusifs, menaces, attaques, paroles, intimidations, écrits, attitudes, agissements répétés à l’encontre d’un salarié, ayant pour objet ou pour effet la dégradation de ses conditions de travail et qui, comme tels, sont susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »[24]. Cette disposition est d’une portée considérable : elle s’inscrit dans la continuité des réformes sociales engagées en Côte d’Ivoire depuis le Code du travail de 2015, tout en intégrant les enseignements du droit comparé et des sciences humaines sur la souffrance au travail.
Deux éléments se dégagent de la lettre de la loi : la répétition des comportements et leurs effets délétères sur le salarié. Le législateur ivoirien, suivant l’exemple français (loi du 17 janvier 2002, dite « loi de modernisation sociale »[25]), a entendu sanctionner des comportements réitérés, souvent diffus, dont la violence psychologique s’inscrit dans la durée. Le harcèlement moral se distingue ici de la simple tension professionnelle ou du conflit ponctuel : il suppose une stratégie de déstabilisation ou de mise à l’écart du salarié. Cette approche, directement inspirée des travaux pionniers de la psychiatre Hirigoyen, conçoit le harcèlement comme un processus destructeur visant à miner l’équilibre psychologique du travailleur[26]. Selon elle, « le harcèlement moral se manifeste par des comportements répétés qui, isolés, peuvent sembler anodins, mais qui, dans leur accumulation, détruisent progressivement la victime »[27]. Le droit ivoirien traduit ainsi dans le texte une réalité psychologique complexe, en reconnaissant que la violence morale peut être silencieuse, invisible, mais profondément destructrice. Sur le plan juridique, ces agissements se matérialisent par des humiliations, des critiques répétées, une surcharge de travail injustifiée, une mise à l’écart, ou encore un retrait des missions. Dans l’arrêt Cass. soc., 10 nov. 2009, n°07-45.321, la Cour de cassation française a qualifié de harcèlement moral des agissements consistant à priver un salarié de moyens matériels, à le dénigrer et à le marginaliser[28]. Une telle analyse pourrait être transposée dans le contexte ivoirien, où la hiérarchie est parfois utilisée comme instrument d’intimidation, notamment dans les structures administratives.
Le texte ivoirien, en reprenant la formule « ayant pour objet ou pour effet », intègre une approche objective du harcèlement moral : il n’est pas nécessaire que l’auteur ait voulu nuire, il suffit que ses comportements aient eu pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié. Cette orientation rejoint la doctrine de Supiot, pour qui « le harcèlement moral traduit une dérive managériale où l’individu cesse d’être un sujet de droit pour devenir un simple instrument de production »[29]. Les manifestations du harcèlement moral sont multiples. On peut en distinguer quatre types principaux :
- le management abusif, caractérisé par une pression excessive, des reproches incessants ou des ordres contradictoires ;
- l’isolement professionnel, consistant à exclure le salarié des réunions, à l’isoler de ses collègues ou à ignorer ses contributions ;
- la surcharge de travail, ou à l’inverse, la privation de tâches, utilisées comme formes de sanction déguisée ;
- les humiliations et atteintes à la dignité, par des propos dénigrants, des moqueries ou une mise en doute systématique des compétences.
Ces comportements, souvent anodins pris isolément, constituent, lorsqu’ils s’inscrivent dans la durée, une véritable violence institutionnelle. Comme l’explique Lhernould, « le harcèlement moral illustre la transformation de la subordination en domination, lorsque le pouvoir hiérarchique échappe à toute rationalité économique pour devenir un instrument d’humiliation »[30]. La définition ivoirienne s’inscrit donc dans une conception moderne du droit du travail, qui reconnaît le travailleur non seulement comme un agent économique, mais aussi comme un être psychologique et social dont la dignité et la santé mentale doivent être protégées.
B. Conséquences sur la santé du salarié et responsabilité de l’employeur
Le harcèlement moral, en dégradant les conditions de travail, produit des effets pathogènes avérés : troubles du sommeil, anxiété, dépression, burn-out, voire dans les cas extrêmes, suicide professionnel. Ces conséquences font du harcèlement une question de santé publique et de sécurité au travail. En droit ivoirien, cette dimension est implicitement encadrée par les articles 41.1 et suivants du Code du travail, relatifs à l’hygiène et à la sécurité. Ces textes imposent à l’employeur une obligation générale de prévention des risques professionnels, incluant les risques psychosociaux. Ce principe s’aligne sur le modèle français, où la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 21 juin 2006 (n° 05-43.914), a affirmé que l’employeur est tenu d’une « obligation de sécurité de résultat » en matière de santé au travail[31]. Cette obligation de prévention ne se limite pas à une simple réaction en cas de plainte. Elle implique une action proactive : formation du personnel, mécanismes de signalement, enquêtes internes et politiques de tolérance zéro. Dans l’arrêt CJUE, 19 avril 2012, aff. C-415/10, Meister, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que les États doivent garantir aux victimes de harcèlement un cadre procédural effectif pour faire valoir leurs droits[32]. Ces principes, bien que d’origine européenne, inspirent progressivement les réformes africaines du travail, notamment en Côte d’Ivoire, qui cherche à renforcer le rôle de l’Inspection du travail dans la prévention du harcèlement.
De même, le harcèlement moral a des répercussions directes sur la relation de travail : il conduit souvent à des arrêts maladie, à une inaptitude temporaire ou définitive, voire à la rupture du contrat. En France, la jurisprudence considère que lorsque le harcèlement a entraîné une dégradation de la santé, tout licenciement ultérieur pour inaptitude est nul[33]. Une telle logique pourrait être transposée dans le droit ivoirien, où l’article 18.3 du Code du travail encadre déjà la rupture du contrat en cas d’incapacité prolongée. Cette articulation entre harcèlement et inaptitude traduit un cercle vicieux : le salarié victime, affaibli psychologiquement, se trouve dans l’impossibilité de reprendre son emploi, tandis que l’employeur peut tenter de justifier une rupture pour motif médical. Il appartient alors au juge d’examiner la cause réelle de la rupture : si l’inaptitude découle directement d’un harcèlement moral, l’employeur engage sa responsabilité civile et le licenciement doit être requalifié en licenciement abusif. La responsabilité disciplinaire de l’auteur du harcèlement s’ajoute à celle de l’employeur. Ce dernier doit sanctionner tout comportement déviant constaté dans son entreprise. L’inaction équivaut à une faute in vigilando. Comme le souligne Despax, « le silence de l’employeur face à la souffrance au travail est en lui-même générateur de responsabilité »[34].
Ainsi, la lutte contre le harcèlement moral en droit ivoirien dépasse la seule répression : elle impose une culture de prévention, d’écoute et de vigilance au sein des entreprises. Cette mutation culturelle est essentielle pour faire du lieu de travail un espace de respect, de performance et de dignité.
III. Le cadre juridique ivoirien : fondement, portée et limites
La reconnaissance légale du harcèlement moral et sexuel par le Code du travail ivoirien de 2025 marque une avancée majeure dans la protection des travailleurs contre les violences psychologiques et les atteintes à la dignité en milieu professionnel. Toutefois, si la norme existe, sa mise en œuvre demeure confrontée à des limites structurelles, institutionnelles et culturelles. L’article 5 du Code du travail pose une base juridique solide, mais l’absence de mécanismes internes obligatoires, de structures référentes et de dispositifs de prévention formalisés dans les entreprises limite encore la portée pratique de ce texte. La présente partie vise à analyser, d’une part, la portée et les lacunes du cadre législatif ivoirien en matière de prévention (A), et, d’autre part, le rôle des institutions chargées de son application et les perspectives d’amélioration du système (B).
A. Une législation claire mais incomplète en matière de prévention
L’article 5 du Code du travail ivoirien constitue le fondement du dispositif de lutte contre le harcèlement. Il consacre expressément les notions de harcèlement moral et sexuel, en précisant leurs éléments constitutifs et en érigeant leur interdiction au rang de principe d’ordre public social. Ce texte, en imposant à l’employeur un devoir de vigilance, introduit une obligation implicite de prévention des comportements déviants au sein de l’entreprise. En cela, il s’aligne sur le principe fondamental posé par l’article 41.1 du même code, qui exige de l’employeur qu’il garantisse des conditions de travail conformes aux exigences de sécurité, de santé et de dignité. Toutefois, contrairement au droit français, le droit ivoirien n’impose pas la mise en place de procédures internes obligatoires pour prévenir le harcèlement, telles que la désignation d’un référent, la création d’un registre des plaintes ou l’obligation d’enquête interne en cas de signalement. Cette absence fragilise la portée préventive du dispositif. En comparaison, la loi française du 5 septembre 2018 (loi « Avenir professionnel ») a rendu obligatoire la désignation d’un référent harcèlement dans les entreprises de plus de 250 salariés, et a imposé aux comités sociaux et économiques (CSE) de jouer un rôle actif dans la prévention[35]. Cette mesure vise à instaurer une vigilance permanente, en favorisant une culture de prévention plutôt qu’une réaction postérieure à la survenance du dommage. Le législateur ivoirien pourrait s’inspirer de cette expérience pour combler le vide normatif et renforcer la protection des travailleurs, en instituant des mécanismes internes de signalement et d’enquête.
L’absence de référent interne, de formations obligatoires sur les comportements à risque ou de procédure d’enquête crée un décalage entre la norme et la pratique. La majorité des entreprises ivoiriennes, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), ne disposent pas de services juridiques ou de ressources humaines suffisamment formées pour gérer ces situations. Selon une étude menée par le Ministère de l’Emploi et de la Protection sociale (rapport 2022 sur la santé au travail), plus de 78 % des travailleurs interrogés déclarent ne pas connaître les voies de recours internes en cas de harcèlement[36]. Ce chiffre témoigne du déficit d’information et de sensibilisation sur la question, mais aussi du poids des représentations sociales : beaucoup de victimes perçoivent le harcèlement comme un « abus normal » lié à la hiérarchie, plutôt que comme une violation de leurs droits fondamentaux. En outre, la Recommandation n° 206 de l’OIT (2019) insiste pourtant sur l’importance des mesures préventives à plusieurs niveaux : établissement de politiques nationales, adoption de codes de conduite en entreprise, mécanismes confidentiels de plainte et programmes de formation. La Côte d’Ivoire, bien qu’ayant ratifié la Convention OIT n° 190, n’a pas encore mis en place l’ensemble de ces mesures. Cette lacune est d’autant plus préoccupante que le harcèlement moral et sexuel est souvent sous-déclaré : la peur de représailles, la honte, la dépendance économique et la méfiance à l’égard des institutions dissuadent les victimes d’agir. Le système actuel repose encore essentiellement sur la dénonciation individuelle, sans soutien institutionnel fort.
Ainsi, la législation ivoirienne, bien qu’innovante dans sa formulation, demeure fragile dans sa mise en œuvre pratique. Elle gagnerait à être consolidée par des dispositifs de prévention systématiques, notamment la formation des cadres, la sensibilisation du personnel et la mise en place de cellules d’écoute.
B. Le rôle des institutions de régulation et de contrôle
Le principal organe chargé de veiller à l’application des dispositions sur le harcèlement est l’Inspection du Travail et des Lois Sociales. En vertu des articles 91.3 et suivants du Code du travail, l’Inspecteur du travail a pour mission de contrôler les conditions d’exécution du travail, de veiller au respect des droits fondamentaux du salarié et de concilier les parties en cas de conflit individuel. En matière de harcèlement, son rôle est principalement préventif et conciliateur : il peut recevoir les plaintes, mener des enquêtes, entendre les témoins et recommander des mesures correctives à l’employeur. Cependant, ses moyens d’action demeurent limités. L’Inspection ne dispose ni de pouvoir de sanction autonome ni de ressources suffisantes pour intervenir dans l’ensemble du tissu économique national. Une étude interne du Ministère de la Fonction publique et de l’Emploi (Rapport 2018-2022) montre que sur 143 cas de harcèlement signalés à l’Inspection du Travail d’Abidjan, seuls 29 dossiers ont abouti à des médiations formelles, et à peine 12 ont été transmis à la juridiction compétente[37]. Cette statistique met en lumière le faible taux de traitement effectif des plaintes et la nécessité de renforcer la capacité opérationnelle de cette institution.
Quant aux juridictions sociales, elles demeurent le dernier rempart. Le juge du travail peut reconnaître le caractère abusif d’un licenciement consécutif à un harcèlement, condamner l’employeur à des dommages-intérêts, voire, dans certains cas, prononcer la nullité du licenciement. Toutefois, le manque de jurisprudence publiée en Côte d’Ivoire sur cette question limite encore la construction d’un véritable droit prétorien du harcèlement. Là encore, le modèle français et européen peut servir d’inspiration. La jurisprudence de la Cour de cassation française (arrêt du 10 nov. 2009 précité) et celle de la CJUE (aff. C-54/07, Feryn) insistent sur le devoir d’enquête et la responsabilité de l’employeur dès lors qu’un harcèlement est signalé[38]. Ces standards pourraient être transposés dans la pratique ivoirienne pour rendre l’action administrative plus effective.
En plus, les organisations syndicales ont un rôle à jouer dans la prévention et la dénonciation du harcèlement. L’article 51.1 et suivants du Code du travail leur confère la mission de défendre les droits et intérêts professionnels des travailleurs. Cependant, dans les faits, les syndicats ivoiriens interviennent rarement sur les questions de harcèlement, souvent perçues comme relevant de la sphère privée ou de la gestion interne de l’entreprise. Cette inertie s’explique par le manque de formation syndicale sur les questions psychosociales et par l’absence de mécanismes institutionnalisés de dialogue social autour de ces problématiques. Comme le rappelle Rodière, « la lutte contre le harcèlement ne peut être efficace que si elle est intégrée à la culture collective de prévention, au même titre que la sécurité physique »[39]. Dans plusieurs pays de la sous-région, des avancées intéressantes ont été observées : au Sénégal, par exemple, certaines conventions collectives sectorielles incluent désormais des clauses de prévention du harcèlement et de médiation interne[40]. La Côte d’Ivoire pourrait suivre cette voie en incitant les partenaires sociaux à négocier des accords d’entreprise ou de branche intégrant la prévention des violences psychologiques et sexuelles au travail.
Pour rendre le dispositif plus opérationnel, plusieurs pistes peuvent être envisagées :
- Renforcer les pouvoirs de l’Inspection du travail, en lui conférant la possibilité d’imposer des sanctions administratives immédiates en cas de manquement grave.
- Créer un Observatoire national du harcèlement au travail, chargé de collecter les données, d’analyser les tendances et de formuler des recommandations.
- Former les magistrats et inspecteurs aux mécanismes de preuve en matière de harcèlement moral et sexuel, afin d’harmoniser les pratiques judiciaires.
- Instituer un référent obligatoire dans les entreprises de plus de cinquante salariés, sur le modèle français, et introduire des procédures internes confidentielles.
Ces réformes contribueraient à ancrer durablement la lutte contre le harcèlement dans la culture juridique et managériale ivoirienne, en transformant la norme légale en réalité vécue.
IV. Sanctions et voies de recours : vers une effectivité du droit
L’effectivité d’un dispositif juridique ne se mesure pas uniquement à la qualité de sa rédaction ou à la clarté de ses principes, mais à la réalité de sa mise en œuvre et à la capacité du système judiciaire à en garantir le respect. En matière de harcèlement moral et sexuel, la norme ivoirienne, bien que conforme aux standards internationaux, ne saurait atteindre sa pleine efficacité sans des sanctions dissuasives et des voies de recours accessibles. Le législateur ivoirien a ainsi prévu une graduation des sanctions disciplinaires, civiles et pénales tout en offrant aux victimes des recours multiples devant l’administration du travail et les juridictions sociales. Cependant, les défis liés à la preuve, à la lenteur judiciaire et au déficit de sensibilisation des acteurs limitent encore la portée pratique du dispositif.
A. Les sanctions disciplinaires, civiles et pénales
Le harcèlement, qu’il soit moral ou sexuel, constitue une faute lourde justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, sans préavis ni indemnité. En vertu des articles 18.15 et 18.16 du Code du travail ivoirien, toute faute grave portant atteinte à la dignité ou à l’intégrité d’un salarié est susceptible d’entraîner un licenciement disciplinaire[41]. Cette sanction traduit la volonté du législateur de protéger la moralité du milieu professionnel et d’affirmer que la dignité humaine prime sur les impératifs économiques. Le juge du travail ivoirien, à l’instar de la Cour de cassation française, pourrait considérer que le harcèlement constitue un manquement à l’obligation de loyauté et de respect entre collègues ou envers les subordonnés[42]. Ainsi, l’employeur se trouve doublement responsable : il doit sanctionner l’auteur du harcèlement sous peine d’engager sa propre responsabilité pour inaction fautive, et il doit veiller à la réintégration ou à l’indemnisation de la victime. Cette exigence rejoint la logique de la jurisprudence française, notamment l’arrêt Cass. soc., 27 octobre 2004, qui consacre l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur[43].
Outre la sanction disciplinaire, la victime peut obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Les articles 18.15 et 18.16 du Code du travail précisent que toute rupture abusive du contrat ouvre droit à réparation. Dans le cas d’un harcèlement, cette réparation doit couvrir le préjudice moral, mais aussi les conséquences économiques (arrêt de travail, perte de salaire, atteinte à la carrière). Le juge apprécie souverainement le montant des dommages-intérêts, en tenant compte de la gravité des faits et de la position hiérarchique du harceleur. En France, la jurisprudence admet même une indemnisation spécifique pour les souffrances psychiques engendrées par le harcèlement, distincte de l’indemnité de licenciement[44]. En Côte d’Ivoire, l’absence de barème contraignant laisse au juge du travail une marge d’appréciation utile, mais expose à un risque d’inégalité de traitement entre victimes. D’où la nécessité, pour l’avenir, d’une harmonisation des pratiques judiciaires par des lignes directrices émanant du Conseil supérieur de la magistrature ou du Ministère de la Justice.
Le harcèlement sexuel est également sanctionné sur le plan pénal par les articles 114, 115, 130, 417 et 418 du Code pénal ivoirien. Ces dispositions consacrent la dimension criminelle du harcèlement sexuel, qui dépasse le cadre professionnel pour relever de la protection pénale de la dignité humaine. Le cumul des sanctions disciplinaires et pénales est donc possible : la faute disciplinaire sanctionne le manquement contractuel, tandis que la peine pénale vise la protection de l’ordre public. Le harcèlement moral, en revanche, n’est pas encore érigé en infraction autonome dans le Code pénal ivoirien. Cette lacune, déjà soulignée par plusieurs auteurs, pourrait être comblée à l’avenir par une réforme inspirée du Code pénal français (art. 222-33-2), qui réprime depuis 2002 le harcèlement moral au travail.
En France, les articles L.1155-2 et L.1155-3 du Code du travail prévoient des amendes et des peines d’emprisonnement en cas de harcèlement, renforcées par la loi du 6 août 2012. Au Canada, le Code canadien du travail (art. 125) impose à l’employeur une obligation stricte de prévention, et les commissions des droits de la personne peuvent ordonner des compensations financières importantes. Au Sénégal, le Code du travail prévoit également le licenciement immédiat du harceleur et la possibilité pour la victime d’obtenir des réparations civiles. Cependant, comme en Côte d’Ivoire, le harcèlement moral n’est pas encore incriminé pénalement, bien qu’il fasse l’objet de sanctions disciplinaires internes.
Cette comparaison révèle une tendance régionale : si la norme existe, l’effectivité dépend de la volonté institutionnelle et de la formation des acteurs du droit à ces questions nouvelles.
B. Les voies de recours et la construction jurisprudentielle
La première voie de recours offerte à la victime est administrative. Conformément au Code du travail, la victime peut saisir l’Inspection du Travail, qui dispose de compétences de conciliation et d’enquête. L’Inspecteur du Travail peut convoquer les parties, recueillir les témoignages et recommander des mesures de réintégration ou de réparation. Cependant, cette voie reste non contraignante : l’Inspection ne peut imposer de sanctions pécuniaires ni ordonner la réintégration du salarié. Elle joue un rôle de médiation, utile pour désamorcer les conflits mais insuffisant lorsque le harcèlement a causé un préjudice grave. Selon le Rapport du Ministère de la Fonction publique (2018-2022), à peine 10 % des dossiers de harcèlement soumis à l’Inspection aboutissent à une conciliation effective. Une réforme pourrait conférer à l’Inspection un pouvoir d’injonction en cas de manquement avéré, à l’image du modèle canadien, où les inspecteurs peuvent imposer la cessation immédiate d’un comportement harcelant.
Le recours juridictionnel demeure le moyen le plus structuré de faire reconnaître la violation. Les victimes peuvent saisir le Tribunal du Travail compétent pour demander la nullité du licenciement, la réintégration ou la réparation intégrale du préjudice moral et matériel. Les décisions rendues peuvent être attaquées devant la Cour d’Appel puis la Cour de Cassation. Même si la jurisprudence ivoirienne reste embryonnaire, quelques décisions illustrent une évolution prometteuse. Dans une décision du Tribunal du Travail d’Abidjan (2021), un employeur a été condamné à 10 millions de F CFA de dommages-intérêts pour harcèlement moral, le juge ayant retenu la dégradation volontaire des conditions de travail d’une salariée enceinte. Cette affaire, largement commentée par la doctrine, marque une prise de conscience judiciaire progressive. La jurisprudence comparée africaine renforce cette tendance : au Sénégal, la Cour suprême (arrêt du 23 mai 2019) a confirmé la nullité d’un licenciement fondé sur la dénonciation de faits de harcèlement ; au Maroc, la Cour de cassation (arrêt n° 721/2018) a imposé à l’employeur une obligation renforcée de prévention. Ces décisions convergent vers une reconnaissance continentale du harcèlement comme atteinte à la dignité constitutionnellement protégée.
L’avenir du contentieux du harcèlement repose sur la capacité des juges à construire un droit prétorien cohérent. La loi, aussi claire soit-elle, ne peut suffire si elle n’est pas accompagnée d’une interprétation protectrice. Comme le rappelle Alain Supiot, « la justice sociale est la traduction jurisprudentielle de la dignité humaine dans les relations de travail »[45]. La Côte d’Ivoire dispose d’un potentiel considérable : son système judiciaire, structuré autour des tribunaux du travail, permet une proximité avec les justiciables. En favorisant la formation des magistrats, en publiant régulièrement les décisions et en encourageant les recours, le pays pourrait devenir un modèle régional de justice sociale fondée sur la dignité et le respect des personnes.
Conclusion
Le principal mérite du dispositif ivoirien réside dans la clarté de la définition légale du harcèlement moral et sexuel (art. 5 C. trav.), qui s’aligne sur les standards internationaux. Il traduit une volonté de protection du salarié contre les violences invisibles du monde du travail. Toutefois, ce texte, bien que normativement complet, reste juridiquement orphelin d’un ensemble de mécanismes procéduraux et institutionnels indispensables à sa pleine application. L’absence d’un référent harcèlement, de procédures internes de signalement, ou encore d’une typification pénale du harcèlement moral, fragilise le dispositif. De même, la faiblesse des moyens alloués à l’Inspection du travail, la rareté des décisions publiées des tribunaux du travail et la méconnaissance du phénomène par les acteurs sociaux freinent l’émergence d’une véritable culture de prévention. Ce constat rejoint la doctrine d’Alain Supiot, pour qui « une règle n’a de valeur que par la réalité des institutions capables d’en assurer l’application ». Le droit ivoirien du harcèlement apparaît donc fort dans le principe, mais fragile dans la pratique.
Les défis à relever se situent à trois niveaux : la prévention, la preuve et la culture d’entreprise. Sur le plan préventif, le système ivoirien doit évoluer d’une logique réactive à une approche proactive. Cela suppose la mise en place d’une politique nationale de santé au travail intégrant les risques psychosociaux et le harcèlement comme priorités. Des programmes de formation destinés aux employeurs, aux cadres et aux délégués syndicaux sont indispensables pour créer une culture organisationnelle fondée sur le respect et la bienveillance. Sur le plan probatoire, la difficulté à démontrer les faits de harcèlement demeure l’obstacle majeur. L’aménagement de la charge de la preuve à l’image du modèle français depuis la loi du 17 janvier 2002 permettrait de mieux protéger les victimes sans compromettre les droits de la défense. Enfin, sur le plan culturel, il s’agit de transformer la perception du harcèlement dans les entreprises ivoiriennes. Trop souvent, ces comportements sont banalisés ou dissimulés sous couvert de « management ferme ». La lutte contre le harcèlement exige une révolution des mentalités, où la performance économique s’accorde avec la dignité humaine. Comme le souligne Marie-France Hirigoyen, « le harcèlement ne prospère que dans les organisations où la peur et le silence remplacent la confiance et la parole ».
L’avenir du droit ivoirien du travail passe par la construction d’une politique intégrée de santé au travail, articulant la prévention des risques physiques et psychiques. Cette approche globale, prônée par l’OIT à travers la Convention n° 190 et la Recommandation n° 206, suppose la coopération entre le Ministère de l’Emploi, les syndicats, les organisations patronales et la société civile. Le respect de la dignité en entreprise doit devenir une valeur managériale, un indicateur de gouvernance et un critère de responsabilité sociale. La création d’un Observatoire national du harcèlement au travail, la formation continue des magistrats et la publication systématique des décisions judiciaires renforceraient la visibilité et la crédibilité du dispositif. En définitive, la lutte contre le harcèlement moral et sexuel ne se limite pas à une question de droit, mais constitue un enjeu civilisationnel : celui de bâtir un environnement de travail où la productivité se conjugue avec le respect de la personne humaine.
La Côte d’Ivoire, en affirmant sa volonté de promouvoir la dignité au travail, trace la voie d’un modèle africain de justice sociale fondé sur la prévention, la responsabilité et la solidarité.
Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : (+225) 27 23 23 21 64 / 05 96 11 90 94 / 01 52 90 45 19 (WhatsApp)
Achetez le Kit du travailleur (Guide pour connaître tous ses droits en tant que travailleur) au prix de 35500 FCFA en suivant ce lien : https://cabinetldjsarl.com/formation/kit-du-travailleur-guide-pour-connaitre-tous-ses-droits-en-tant-que-travailleur/
Me Luc KOUASSI
Juriste Consultant Polyglotte| Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.
denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28
[1] A. Supiot, Critique du droit du travail, PUF, 2015, p. 83.
[2] OIT, Convention n°190 et Recommandation n°206 sur la violence et le harcèlement, Genève, 2019.
[3] Code du travail ivoirien, 2015, art. 5, al. 4.
[4] Ibidd., art. 5, al. 3.
[5] Constitution de la République de Côte d’Ivoire, 2016, art. 4.
[6] Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43.914, Bull. civ. V, n° 214.
[7] J. Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Ve République, Flammarion, 2022, p. 52.
[8] Ibid.
[9] Code du travail français, art. L.1153-1.
[10] Cass. crim., 11 juin 2019, n°18-83.160, Bull. crim. n°155.
[11] Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, 5 juill. 2006.
[12] A. Supiot, Op. cit., p. 83.
[13] Directive 2006/54/CE
[14] Cass. soc., 17 mai 2005, n°03-44.055.
[15] Cass. soc., 19 oct. 2011, n°09-68.272.
[16] Cass. soc., 27 oct. 2004, n°03-44.812.
[17] M. Despax, Droit du travail, PUF, 2001, 128 p.
[18] Cass. soc., 27 oct. 2004, précité.
[19] J.-P. Lhernould, Droit du travail : Relations individuelles, Edito, 2003, p. 289.
[20] Code du travail français, art. L.1154-1.
[21] CJUE, 11 nov. 2010, Danosa, aff. C-232/09.
[22] OIT, Convention n°190 sur la violence et le harcèlement, 2019, art. 9.
[23] J.-P. Lhernould, Op. cit., p. 297.
[24] Ibidd., art. 5, al. 3.
[25] Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, JO République française.
[26] M.-F. Hirigoyen, Le harcèlement moral de la violence perverse au quotidien, Syros, 1998, p. 24.
[27] M.-F. Hirigoyen, Op. cit., p. 37.
[28] Cass. soc., 10 nov. 2009, n°07-45.321.
[29] A. Supiot, Op. cit., p. 92.
[30] J.-P. Lhernould, Op. cit., p. 302.
[31] Cass. soc., 21 juin 2006, n°05-43.914, Bull. civ. V, n°214.
[32] CJUE, 19 avr. 2012, Meister, aff. C-415/10.
[33] CJUE, 19 avr. 2012, Meister, aff. C-415/10.
[34] M. Despax, Droit du travail, PUF, 2001, 128 p.
[35] Loi française n°2018-771 du 5 septembre 2018, JO République française, art. L.1153-5 et L.1153-6.
[36] Ministère de l’Emploi et de la Protection sociale, Rapport sur la santé au travail en Côte d’Ivoire, Abidjan, 2022, 23 p.
[37] Ministère de la Fonction publique et de l’Emploi, Rapport sur le traitement des plaintes liées au harcèlement moral et sexuel (2018-2022), Abidjan, 2023.
[38] CJUE, 10 juill. 2008, Feryn, aff. C-54/07.
[39] P. Rodière, Droit social de l’Union Européenne, LGDJ, 2022, p. 231.
[40] Convention collective interprofessionnelle, Sénégal, 2019, art. 21.
[41] Code du travail ivoirien, 2015, art. 18.15 & 18.16.
[42] Cass. soc., 10 nov. 2009, n°07-45.321.
[43] Cass. soc., 27 oct. 2004, n°03-44.812.
[44] Cass. soc., 3 févr. 2010, n°08-45.331.
[45] A. Supiot, Op. cit., p. 117.