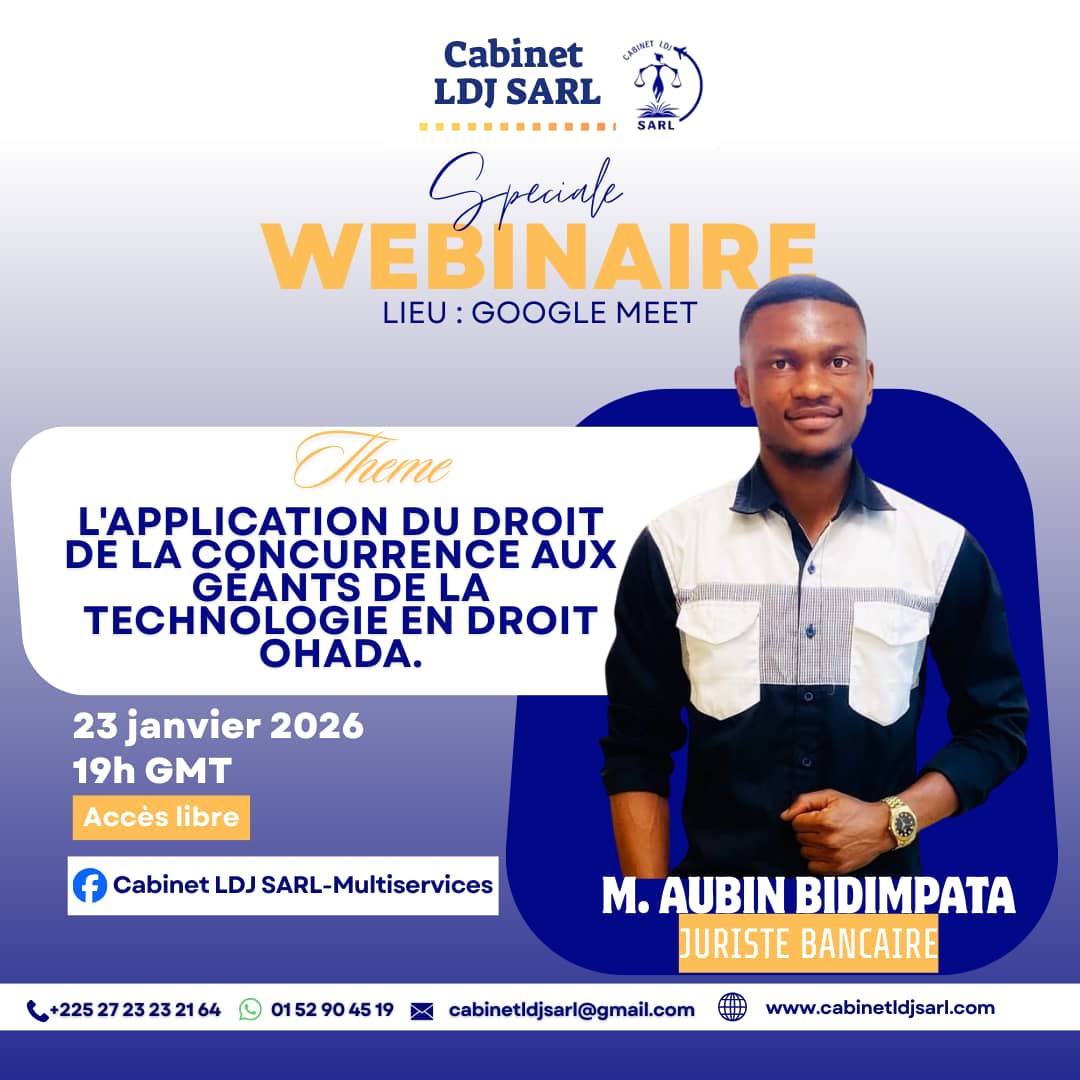La relation de travail, bien qu’inscrite dans un cadre contractuel, demeure profondément marquée par un déséquilibre structurel entre les parties. L’employeur, détenteur du pouvoir économique et organisationnel, dispose d’une capacité d’influence considérable sur le sort professionnel du salarié, lequel se trouve, par nature, dans une situation de subordination juridique. C’est précisément pour corriger ce déséquilibre que le droit du travail s’est progressivement construit comme un droit de protection, visant à garantir au travailleur l’exercice effectif de ses droits, y compris face à son employeur. Dans ce contexte, la judiciarisation croissante des relations de travail en Côte d’Ivoire apparaît comme une évolution majeure, révélatrice d’une prise de conscience accrue des travailleurs quant à leurs droits et des voies de recours dont ils disposent pour les faire respecter[1].
Cette judiciarisation s’inscrit dans un mouvement plus large de constitutionnalisation et de fondamentalisation du droit du travail. Loin de se limiter à la simple régulation économique de la relation salariale, le droit du travail contemporain tend à intégrer des valeurs essentielles telles que la dignité humaine, l’égalité, la liberté syndicale, la protection contre les discriminations ou encore le droit à un recours juridictionnel effectif[2]. Dans cette perspective, l’action en justice du salarié ne saurait être considérée comme un acte de défiance ou de rupture de loyauté à l’égard de l’employeur, mais bien comme l’expression légitime d’un droit fondamental : celui d’accéder au juge pour obtenir la reconnaissance et la protection de ses droits.
Or, dans la pratique des relations professionnelles, l’exercice de ce droit expose fréquemment le salarié à des mesures de représailles, au premier rang desquelles figure le licenciement. Le licenciement de représailles, parfois dissimulé sous des motifs fallacieux ou artificiellement construits, constitue une atteinte grave à l’État de droit social. Il a pour effet de dissuader les travailleurs de saisir les juridictions ou les autorités administratives compétentes, vidant ainsi de sa substance le droit d’action pourtant solennellement reconnu[3]. Conscient de ce risque, le législateur ivoirien a entendu ériger une protection spécifique et renforcée en faveur du salarié qui engage une action en justice pour faire respecter les principes et droits fondamentaux au travail.
C’est dans cette logique que s’inscrit l’article 6 du Code du travail ivoirien, lequel consacre une véritable immunité contre les représailles patronales. Ce texte dispose expressément que tout licenciement motivé par l’action en justice du salarié pour faire respecter les droits fondamentaux est nul et de nul effet, et que la réintégration du salarié licencié dans ces conditions est de droit[4]. Une telle formulation témoigne d’une volonté claire du législateur de dépasser le régime classique du licenciement abusif, pour entrer dans celui, plus exigeant, de la nullité de plein droit, assortie d’une sanction spécifique : la réintégration obligatoire. En cas de refus de cette réintégration par l’employeur, celui-ci s’expose au paiement de dommages-intérêts, calculés selon les modalités prévues à l’article 18.15 du même Code[5].
La spécificité du dispositif ivoirien mérite d’être soulignée. Alors que dans de nombreux systèmes juridiques, notamment en droit français, la réintégration du salarié victime d’un licenciement illicite demeure le plus souvent facultative ou subordonnée à l’accord des parties, le droit ivoirien opte pour une approche plus protectrice, faisant de la réintégration un droit subjectif du salarié. Cette orientation traduit une conception exigeante de l’effectivité des droits fondamentaux au travail, dans laquelle la sanction ne se limite pas à une réparation pécuniaire, mais vise à restaurer pleinement la situation juridique et professionnelle antérieure du travailleur[6].
L’intérêt scientifique de l’étude de l’action en justice du salarié en droit ivoirien réside ainsi dans l’articulation subtile entre plusieurs dimensions fondamentales du droit du travail : le droit d’accès au juge, la protection contre le licenciement, la nullité des actes discriminatoires ou de représailles, et la réparation du préjudice subi. Elle invite également à une réflexion comparative, notamment avec le droit français, le droit européen et les normes internationales de l’Organisation internationale du travail, qui consacrent tous, à des degrés divers, le principe de protection contre les sanctions liées à l’exercice d’un droit[7].
Dès lors, une interrogation s’impose : comment le droit du travail ivoirien garantit-il l’effectivité des droits fondamentaux du salarié qui saisit la justice, face au risque de licenciement de représailles, et quelles sont les forces et les limites de ce dispositif protecteur ? L’analyse de cette problématique permet non seulement d’évaluer la portée normative de l’article 6 du Code du travail, mais aussi d’apprécier son efficacité pratique dans un environnement socio-économique marqué par une forte asymétrie des rapports de force. Pour répondre à cette problématique, la présente étude adopte une méthodologie essentiellement qualitative, combinant l’analyse exégétique des textes applicables, une approche doctrinale fondée sur les travaux des auteurs de référence en droit du travail, ainsi qu’une ouverture comparative vers le droit français et les normes internationales.
L’étude s’articulera autour de quatre axes principaux. Elle examinera d’abord la reconnaissance de l’action en justice comme droit fondamental du salarié en droit ivoirien (I). Elle analysera ensuite la nullité du licenciement fondé sur l’exercice de ce droit (II). Elle s’intéressera, dans un troisième temps, au régime juridique de la réintégration et de l’indemnisation du salarié (III). Enfin, elle proposera une réflexion critique sur la portée, les limites et les perspectives d’évolution de ce dispositif dans le contexte ivoirien contemporain (IV).
I. LA RECONNAISSANCE DE L’ACTION EN JUSTICE COMME DROIT FONDAMENTAL DU SALARIE
La consécration de l’action en justice du salarié en droit ivoirien procède d’une construction normative articulée autour de deux axes complémentaires. D’une part, elle repose sur un fondement juridique interne solide, au premier rang duquel figure l’article 6 du Code du travail ivoirien, érigé en norme de protection des droits fondamentaux du travailleur. D’autre part, elle s’inscrit dans une dynamique normative plus large, nourrie par les principes constitutionnels d’accès à la justice et par les standards internationaux relatifs aux libertés syndicales, à la protection contre les représailles et au droit à un recours effectif. L’examen de ces fondements appelle donc, en premier lieu, une analyse approfondie du socle juridique de l’action en justice du salarié (A), avant d’en préciser, dans un second temps, le champ matériel et personnel de la protection ainsi instaurée (B).
A. Le fondement juridique de l’action en justice du salarié
Le droit ivoirien du travail consacre explicitement l’action en justice du salarié comme un instrument de protection des droits fondamentaux, en lui conférant une valeur normative élevée et une effectivité renforcée. Cette consécration se manifeste avec une clarté particulière à travers l’article 6 du Code du travail ivoirien, lequel dispose que « tout licenciement motivé par l’action en justice pour faire respecter les principes et droits fondamentaux au travail est nul et de nul effet », ajoutant que « la réintégration du salarié licencié au mépris de cette interdiction est de droit »[8]. Par cette formulation, le législateur ivoirien opère un choix normatif fort : il ne se contente pas de sanctionner l’abus, mais érige l’action en justice en droit protégé, dont la violation entraîne la nullité de l’acte patronal et la restauration de la situation antérieure.
La portée de l’article 6 dépasse ainsi le cadre classique du contentieux du licenciement abusif. Alors que, dans ce dernier cas, la sanction se limite généralement à l’octroi de dommages-intérêts, l’action en justice bénéficie ici d’un régime de protection renforcée, fondé sur la nullité absolue du licenciement de représailles. Comme l’a relevé la doctrine, la nullité constitue une sanction qualitative, distincte de la simple réparation pécuniaire, en ce qu’elle vise à préserver l’ordre public social et à empêcher toute atteinte à un droit jugé essentiel[9]. En ce sens, l’article 6 du Code du travail ivoirien s’analyse comme une véritable norme de sauvegarde des libertés fondamentales dans l’entreprise, venant limiter de manière substantielle le pouvoir de rupture de l’employeur.
Cette protection trouve un écho direct dans les principes constitutionnels d’accès à la justice et de protection juridictionnelle effective. Si la Constitution ivoirienne ne consacre pas expressément, en des termes techniques, un « droit à l’action en justice du salarié », elle proclame néanmoins l’attachement de l’État à l’État de droit, à la séparation des pouvoirs et à la garantie des droits fondamentaux[10]. Or, l’accès au juge constitue l’un des piliers de ces garanties. À cet égard, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, comme la doctrine constitutionnelle africaine, reconnaissent que le droit à un recours effectif implique non seulement la possibilité formelle de saisir une juridiction, mais aussi la protection contre toute mesure de représailles susceptible d’en dissuader l’exercice[11].
Dans cette perspective, l’article 6 du Code du travail ivoirien apparaît comme la traduction sectorielle, en droit social, du principe général de protection juridictionnelle. Il garantit que le salarié puisse faire valoir ses droits qu’il s’agisse du respect des normes relatives à la rémunération, à la durée du travail, à la non-discrimination, au harcèlement ou à la liberté syndicale sans craindre une sanction déguisée sous la forme d’un licenciement. Cette approche rejoint celle développée en droit comparé, notamment en droit français, où la jurisprudence a progressivement reconnu que le licenciement fondé sur l’exercice d’un droit constitue une atteinte à une liberté fondamentale et doit, à ce titre, être frappé de nullité[12].
Au-delà du cadre constitutionnel et interne, le fondement de l’action en justice du salarié en droit ivoirien s’inscrit clairement dans une inspiration internationale affirmée. Plusieurs instruments normatifs de l’Organisation internationale du travail consacrent, de manière directe ou indirecte, la protection du salarié contre les représailles liées à l’exercice de ses droits. La Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) garantit aux travailleurs le droit de défendre leurs intérêts professionnels sans ingérence des employeurs[13]. La Convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949) prohibe expressément les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale, y compris le licenciement motivé par l’activité revendicative ou contentieuse du salarié[14]. Quant à la Convention n° 158 sur le licenciement (1982), elle interdit toute rupture fondée sur l’exercice par le travailleur d’un recours contre l’employeur ou sur sa participation à des procédures engagées contre celui-ci[15].
À ces instruments spécialisés s’ajoute le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui consacre, en son article 2 §3, le droit de toute personne à un recours utile devant les juridictions compétentes pour faire valoir les droits reconnus par le Pacte[16]. La doctrine souligne que cette garantie implique nécessairement une protection contre les mesures de rétorsion, faute de quoi le droit au recours serait vidé de sa substance[17]. En alignant son droit interne sur ces standards internationaux, la Côte d’Ivoire affirme son engagement en faveur d’un droit du travail respectueux des libertés fondamentales et conforme aux exigences du droit international des droits de l’homme.
Ainsi, le fondement juridique de l’action en justice du salarié en droit ivoirien repose sur une construction normative cohérente, articulant droit interne, principes constitutionnels et normes internationales. Cette construction confère à l’action en justice un statut de droit fondamental protégé, dont la violation appelle des sanctions spécifiques et dissuasives. Il convient toutefois de s’interroger sur l’étendue concrète de cette protection, tant du point de vue des situations couvertes que des catégories de travailleurs bénéficiaires. C’est précisément l’objet de l’analyse du champ matériel et personnel de la protection, qui sera examinée dans la sous-partie suivante.
B. Le champ matériel et personnel de la protection
La portée de l’article 6 du Code du travail ivoirien ne peut être pleinement saisie sans une analyse rigoureuse de son champ matériel, c’est-à-dire des droits dont la défense déclenche la protection, et de son champ personnel, relatif aux catégories de travailleurs bénéficiaires. L’ambition du législateur ivoirien apparaît ici clairement : garantir une protection large et effective, propre à neutraliser toute forme de représailles patronales susceptibles de dissuader l’exercice d’un recours juridictionnel ou quasi-juridictionnel.
En ce qui concerne le champ matériel, l’article 6 vise expressément l’action en justice engagée pour faire respecter les « principes et droits fondamentaux au travail ». Cette formule, volontairement générale, appelle une interprétation extensive. Elle renvoie d’abord aux droits consacrés par le Code du travail ivoirien lui-même, notamment ceux relatifs à la non-discrimination[18], à la dignité et à la protection contre le harcèlement moral ou sexuel[19], à la liberté syndicale[20], au respect des règles de santé et de sécurité au travail[21], ainsi qu’aux garanties entourant la rupture du contrat de travail. En ce sens, tout salarié qui saisit une juridiction pour contester une atteinte à ses droits fondamentaux doit être protégé contre toute mesure de représailles.
La doctrine souligne que la référence aux « principes » permet d’englober, au-delà des droits explicitement énumérés par la loi, des principes généraux du droit du travail, tels que le principe de bonne foi dans l’exécution du contrat, l’égalité de traitement ou encore l’obligation de sécurité de l’employeur[22]. Cette approche rejoint celle développée en droit français, où la Cour de cassation considère que le licenciement motivé par l’exercice d’une action en justice constitue une atteinte à une liberté fondamentale, indépendamment de la nature précise du droit invoqué[23].
Par ailleurs, la notion de droits fondamentaux au travail doit être interprétée à la lumière des standards internationaux, en particulier ceux de l’Organisation internationale du travail. La Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998) identifie quatre catégories majeures : la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l’élimination de toute forme de travail forcé, l’abolition effective du travail des enfants et l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession[24]. En intégrant cette terminologie, le législateur ivoirien inscrit implicitement l’article 6 dans cette architecture normative internationale, ce qui renforce son interprétation extensive.
Le champ matériel de la protection est indissociable de la notion d’action en justice, que l’article 6 appréhende de manière large. Il ne s’agit pas uniquement de la saisine du Tribunal du travail ou de la Cour de cassation, mais plus largement de toute démarche contentieuse ou précontentieuse visant à faire respecter les droits fondamentaux du salarié. En premier lieu, la saisine de l’Inspection du Travail doit être regardée comme une action protégée. Institution administrative dotée de pouvoirs de contrôle et de conciliation, l’Inspection du Travail constitue souvent la première voie de recours du salarié, notamment dans les PME ivoiriennes[25]. Licencier un salarié pour avoir dénoncé une violation du droit du travail auprès de l’Inspecteur du Travail reviendrait à vider de sa substance le mécanisme de contrôle administratif. La doctrine et la pratique comparées reconnaissent d’ailleurs que les recours administratifs entrent pleinement dans la notion d’action en justice au sens fonctionnel[26].
En second lieu, la saisine du Tribunal du travail, juridiction spécialisée compétente pour connaître des litiges individuels et collectifs du travail, constitue le cœur du dispositif de protection. Toute mesure de rupture prise en représailles d’une telle saisine tombe sous le coup de la nullité prévue à l’article 6. Cette protection s’étend logiquement aux voies de recours, notamment l’appel et le pourvoi en cassation. À cet égard, la jurisprudence française a jugé que le licenciement intervenu après un pourvoi en cassation formé par le salarié constitue également une atteinte à une liberté fondamentale[27] ; il est hautement probable que les juridictions ivoiriennes adoptent une solution similaire, au regard de la proximité des textes.
Enfin, la notion d’action en justice englobe également la participation du salarié à une procédure, même lorsqu’il n’en est pas l’initiateur principal, par exemple en tant que témoin ou partie intervenante. Cette interprétation est conforme à la Convention n° 158 de l’OIT, qui prohibe toute rupture fondée sur le fait que le travailleur a porté plainte ou participé à une procédure contre l’employeur[28].
Sur le plan personnel, la protection instaurée par l’article 6 bénéficie en priorité à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail, quelle que soit la nature de celui-ci (CDI, CDD, contrat à temps partiel). Le texte ne distingue pas selon l’ancienneté ou la catégorie professionnelle, ce qui traduit une volonté d’universalité de la protection. Cette protection revêt toutefois une importance particulière pour certaines catégories de travailleurs dits « protégés », notamment les représentants du personnel et les délégués syndicaux. Ces derniers sont, par nature, davantage exposés aux risques de représailles, en raison de leur rôle de défense collective des intérêts des travailleurs. La jurisprudence comparée souligne que la protection contre le licenciement de représailles constitue un corollaire indispensable de la liberté syndicale[29]. En Côte d’Ivoire, où le dialogue social demeure parfois fragile, l’effectivité de l’article 6 apparaît comme un levier essentiel pour renforcer la confiance des représentants syndicaux dans l’institution judiciaire.
En outre, la protection doit également bénéficier aux travailleurs candidats à un emploi, lorsqu’ils subissent une mesure discriminatoire ou une rupture de promesse d’embauche en raison d’une action en justice antérieure. Bien que cette hypothèse ne soit pas explicitement visée par le texte, une interprétation téléologique, inspirée du droit international et comparé, milite en faveur de son inclusion[30].
Le champ matériel et personnel de la protection offerte par l’article 6 du Code du travail ivoirien se caractérise par sa largeur et sa finalité dissuasive. En garantissant que nul ne puisse être sanctionné pour avoir exercé un recours, le législateur ivoirien entend assurer l’effectivité des droits fondamentaux du travailleur et renforcer la crédibilité de l’ordre juridique social. Cette protection, toutefois, ne peut produire pleinement ses effets sans une mise en œuvre juridictionnelle audacieuse, laquelle dépendra largement de l’interprétation qu’en feront les juridictions sociales ivoiriennes.
II. LA NULLITE DU LICENCIEMENT FONDE SUR L’ACTION EN JUSTICE DU SALARIE
L’article 6 du Code du travail ivoirien institue un régime spécifique et particulièrement protecteur lorsque la rupture du contrat de travail est motivée par l’exercice, par le salarié, d’une action en justice destinée à faire respecter les principes et droits fondamentaux au travail. Ce régime se distingue nettement du droit commun du licenciement abusif et repose sur une sanction radicale : la nullité du licenciement. L’analyse de cette protection impose, d’une part, d’identifier la qualification juridique du licenciement prohibé et, d’autre part, d’examiner les modalités probatoires et l’appréciation juridictionnelle de ce motif illicite. Dans cette perspective, il convient d’étudier successivement la qualification juridique du licenciement prohibé (A), avant d’aborder la charge de la preuve et l’appréciation juridictionnelle (B).
A. La qualification juridique du licenciement prohibé
La qualification juridique du licenciement prononcé en représailles de l’action en justice du salarié révèle la volonté du législateur ivoirien de sanctuariser l’accès au juge en droit du travail. Loin de se contenter d’une réparation a posteriori, le Code du travail érige ce type de rupture en atteinte directe à un droit fondamental, justifiant une sanction d’une intensité exceptionnelle.
Le licenciement de représailles se définit comme toute rupture du contrat de travail décidée par l’employeur en réaction directe ou indirecte à l’exercice, par le salarié, d’une action en justice visant à faire respecter les principes et droits fondamentaux au travail[31]. Il ne s’agit donc pas d’un licenciement fondé sur la personne du salarié au sens classique (faute, insuffisance professionnelle, inaptitude), ni d’un licenciement pour motif économique, mais d’une mesure purement répressive, destinée à sanctionner un comportement juridiquement protégé. Le mécanisme de représailles repose sur une logique de dissuasion : l’employeur, conscient de l’atteinte portée à ses intérêts ou à son autorité par la contestation judiciaire, cherche à neutraliser le salarié procédurier et, plus largement, à décourager toute velléité contentieuse au sein de l’entreprise. La doctrine souligne que ce type de licenciement constitue l’une des formes les plus pernicieuses de violation des droits fondamentaux, en ce qu’il vise à priver d’effectivité le droit d’accès au juge[32].
En droit ivoirien, l’article 6 adopte une formulation sans équivoque : « Tout licenciement motivé par l’action en justice pour faire respecter les principes et droits fondamentaux au travail est nul et de nul effet ». La causalité entre l’action en justice et la rupture constitue donc l’élément déterminant de la qualification. Peu importe que l’employeur invoque un motif apparent distinct : dès lors que le véritable motif du licenciement réside dans la démarche contentieuse du salarié, la rupture encourt la nullité. Cette approche rejoint celle développée par l’Organisation internationale du travail, notamment dans la Convention n° 158, qui prohibe toute rupture fondée sur le fait que le travailleur a porté plainte ou participé à une procédure contre l’employeur[33]. Elle s’inscrit également dans le prolongement du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui consacre le droit à un recours effectif devant une juridiction compétente[34].
Par ailleurs, la sanction attachée au licenciement de représailles est d’une particulière gravité : il s’agit d’une nullité absolue, et non d’une simple irrégularité ouvrant droit à réparation. En affirmant que le licenciement est « nul et de nul effet », le législateur ivoirien signifie que la rupture est juridiquement censée n’avoir jamais existé. La conséquence première de cette nullité est la réintégration de droit du salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Contrairement au régime du licenciement abusif, où la réintégration demeure exceptionnelle et subordonnée à l’accord des parties, l’article 6 impose à l’employeur une obligation stricte de réintégration[35]. Ce choix législatif traduit une conception forte de la protection juridictionnelle : la réparation du préjudice ne suffit pas ; il faut restaurer la situation antérieure et rétablir le salarié dans ses droits.
En cas de refus de réintégration par l’employeur, celui-ci s’expose au paiement de dommages-intérêts calculés selon les modalités prévues à l’article 18.15 du Code du travail[36]. Toutefois, ces dommages-intérêts n’ont ici qu’un caractère subsidiaire : ils ne constituent pas la sanction principale, mais une compensation en cas d’impossibilité ou de refus d’exécution de l’obligation de réintégration. La doctrine compare volontiers ce régime à celui du droit français en matière de licenciement nul pour atteinte à une liberté fondamentale, notamment lorsque la rupture est motivée par l’exercice du droit d’ester en justice ou par une discrimination. La Cour de cassation française juge de manière constante que le licenciement prononcé pour avoir saisi une juridiction est nul et ouvre droit à la réintégration du salarié[37]. Le droit ivoirien s’inscrit ainsi dans une logique de convergence normative, tout en affirmant explicitement ce principe dans le texte même du Code du travail.
Il importe enfin de distinguer clairement le licenciement abusif, régi par l’article 18.15 du Code du travail, du licenciement nul prévu à l’article 6. Le licenciement abusif sanctionne l’absence de motif légitime ou le non-respect de la procédure et donne lieu exclusivement à des dommages-intérêts dont le montant est encadré par la loi[38]. La rupture demeure juridiquement valable, malgré son caractère fautif. À l’inverse, le licenciement fondé sur l’action en justice du salarié porte atteinte à un droit fondamental et justifie une sanction plus radicale. Comme le souligne Alain Supiot, la nullité est ici l’expression d’un ordre public social renforcé, destiné à protéger non seulement l’intérêt individuel du salarié, mais aussi l’intérêt collectif à l’existence d’une justice sociale effective[39]. Cette distinction est essentielle sur le plan pratique et contentieux. Elle conditionne le régime de preuve, la nature des sanctions et la stratégie procédurale du salarié. C’est précisément cette dimension probatoire et juridictionnelle qu’il convient désormais d’analyser.
C’est pourquoi il importe, dans un second temps, d’examiner la charge de la preuve et l’appréciation juridictionnelle du licenciement fondé sur l’action en justice du salarié.
B. La charge de la preuve et l’appréciation juridictionnelle
La reconnaissance de la nullité du licenciement fondé sur l’action en justice du salarié serait largement théorique si elle n’était pas accompagnée d’un régime probatoire adapté, permettant au travailleur d’établir le lien entre l’exercice de son droit d’agir en justice et la décision de rupture. La question de la preuve constitue en effet le nœud central de l’effectivité de la protection consacrée par l’article 6 du Code du travail ivoirien, car le motif réel du licenciement est rarement explicitement formulé par l’employeur comme étant une mesure de représailles.
En pratique, l’employeur dissimule le plus souvent la véritable cause de la rupture derrière des motifs apparemment légitimes tels que l’insuffisance professionnelle, la faute disciplinaire ou la réorganisation du service. Dès lors, la difficulté pour le salarié réside dans la démonstration de l’existence d’un lien de causalité entre son action en justice et le licenciement. Ce lien peut être direct, lorsque la rupture intervient immédiatement après la saisine d’une juridiction ou de l’Inspection du Travail, ou indirect, lorsque la décision patronale s’inscrit dans une série de mesures hostiles consécutives à la démarche contentieuse du salarié[40].
Le droit ivoirien ne consacre pas expressément, dans le Code du travail, un mécanisme détaillé d’aménagement de la charge de la preuve comparable à celui prévu en matière de discrimination. Toutefois, l’esprit de l’article 6, lu à la lumière des principes généraux du droit du travail et des normes internationales, invite à une interprétation favorable au salarié. En effet, exiger du travailleur une preuve directe et parfaite de l’intention de représailles de l’employeur reviendrait à neutraliser la protection instaurée par le législateur, dans la mesure où l’intention patronale est, par nature, difficile à établir.
L’approche comparative offre ici un éclairage précieux. En droit français, la Cour de cassation a progressivement élaboré un régime probatoire protecteur, notamment en matière de licenciement nul pour atteinte à une liberté fondamentale. Dans un arrêt de principe de 2016, la chambre sociale a jugé que le salarié qui invoque un licenciement de représailles doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer que la rupture est liée à l’exercice de son droit d’ester en justice, charge à l’employeur de démontrer que sa décision repose sur des motifs objectifs, étrangers à toute volonté de sanction[41]. Ce mécanisme, inspiré du droit européen et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, repose sur un renversement partiel de la charge de la preuve, justifié par l’inégalité structurelle des parties au contrat de travail[42].
Cette logique probatoire trouve également un fondement dans les instruments internationaux. La Convention n° 158 de l’OIT, tout en laissant aux États une marge d’appréciation, insiste sur la nécessité de protéger efficacement le travailleur contre les licenciements arbitraires et de permettre un contrôle juridictionnel effectif des motifs de rupture[43]. De même, le Comité des droits de l’homme des Nations unies, dans son interprétation de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, souligne que le droit à un recours effectif implique des règles de preuve qui ne rendent pas l’accès au juge illusoire[44].
Dans ce contexte, le juge ivoirien est appelé à jouer un rôle déterminant. Il lui appartient d’apprécier souverainement les faits et circonstances entourant la rupture du contrat de travail afin de déceler, au-delà des apparences, la véritable motivation de l’employeur. Cette appréciation doit être globale et contextualisée : la proximité temporelle entre l’action en justice et le licenciement, l’absence d’antécédents disciplinaires, le changement soudain d’attitude de l’employeur ou encore l’invocation de motifs imprécis ou incohérents constituent autant d’indices susceptibles de révéler une mesure de représailles[45].
La doctrine ivoirienne souligne à cet égard que le juge du travail ne saurait se limiter à un contrôle formel de la lettre de licenciement, mais doit procéder à une enquête approfondie sur les causes et circonstances de la rupture, conformément à la mission que lui confère le Code du travail en matière de contentieux social[46]. Cette exigence rejoint la conception moderne du juge du travail comme garant des droits fondamentaux dans l’entreprise, conception largement développée par Alain Supiot, pour qui la juridiction sociale doit être le lieu d’une protection substantielle et non purement déclarative des libertés du travailleur[47].
Lorsque le juge établit que le licenciement est fondé, même partiellement, sur l’action en justice du salarié, la sanction de la nullité s’impose de plein droit. Il ne s’agit pas d’une faculté laissée à l’appréciation du juge, mais d’une conséquence légale impérative découlant de l’article 6 du Code du travail. La réintégration du salarié devient alors la règle, traduisant la volonté du législateur de dissuader radicalement toute tentative de représailles patronales et de garantir l’effectivité du droit fondamental d’accès à la justice.
À terme, l’enjeu réside dans la construction d’une jurisprudence ivoirienne cohérente et audacieuse, capable d’opérer un équilibre entre la sécurité juridique des employeurs et la protection effective des salariés. En s’inspirant des solutions dégagées par le droit comparé, sans les transposer mécaniquement, le juge ivoirien peut contribuer à faire de l’article 6 un instrument vivant de promotion de l’État de droit social, dans lequel l’exercice de l’action en justice ne constitue plus un risque professionnel, mais l’expression légitime d’un droit fondamental pleinement garanti.
III. LA REINTEGRATION DU SALARIE : UN DROIT SUBJECTIF CONSACRE
L’article 6 du Code du travail ivoirien ne se limite pas à prohiber le licenciement de représailles fondé sur l’action en justice du salarié ; il en organise la sanction principale, à savoir la réintégration de droit, érigée en véritable droit subjectif au profit du travailleur. L’analyse de ce mécanisme suppose d’examiner, d’une part, le principe de la réintégration automatique et ses effets juridiques (A) et, d’autre part, les hypothèses dans lesquelles l’employeur refuse de s’y conformer, ainsi que les conséquences indemnitaires qui en résultent (B).
A. La réintégration de droit comme principe
La réintégration du salarié licencié en violation de l’article 6 du Code du travail ivoirien s’impose de plein droit. Le texte est d’une clarté remarquable : « La réintégration du salarié licencié au mépris de cette interdiction est de droit ». Par cette formule impérative, le législateur ivoirien opère un choix fort en faveur de l’effectivité de la protection juridictionnelle des droits fondamentaux du travailleur. La réintégration n’est ni une option laissée à l’appréciation du juge, ni une simple faculté offerte aux parties : elle constitue la conséquence normale et automatique de la nullité du licenciement prononcé en représailles de l’exercice de l’action en justice[48].
Cette approche s’inscrit dans une logique de restauration de la situation antérieure, conformément à la théorie générale de la nullité. En déclarant le licenciement « nul et de nul effet », l’article 6 implique que la rupture est réputée n’avoir jamais existé. Le contrat de travail est donc censé s’être poursuivi sans interruption, ce qui entraîne des effets juridiques substantiels pour le salarié. En premier lieu, l’ancienneté est intégralement préservée, y compris pour la période séparant le licenciement et la réintégration effective. Cette continuité emporte des conséquences directes sur le calcul des droits à congés, des droits à promotion, ainsi que des avantages liés à l’ancienneté[49].
En second lieu, la continuité du contrat implique le maintien des droits sociaux du salarié, notamment en matière de protection sociale. La période d’éviction doit être assimilée à une période de travail effectif ou, à tout le moins, à une période ouvrant droit à la couverture sociale, afin d’éviter que le salarié ne subisse une double peine : la rupture illicite de son contrat et la perte de ses droits sociaux[50]. Cette interprétation est cohérente avec les exigences du droit international du travail, en particulier avec la Convention n° 158 de l’OIT, qui recommande aux États de prévoir des remèdes appropriés et dissuasifs en cas de licenciement injustifié ou nul[51].
La consécration ivoirienne de la réintégration de droit ne se distingue pas de l’approche retenue en droit français. En France, en présence d’un licenciement nul pour atteinte à une liberté fondamentale, la réintégration demeure aussi possible même si l’employeur peut s’y opposer, moyennant le paiement d’une indemnité spécifique, parfois élevée, mais qui ne rétablit pas nécessairement la relation de travail[52]. Plusieurs auteurs français, à l’instar de Jean-Emmanuel Ray, ont souligné les limites de ce système indemnitaire, qui tend à monétiser la violation des droits fondamentaux plutôt qu’à en assurer une réparation en nature[53]. Par ailleurs, dans un arrêt du 10 février 2021, la Cour de cassation a réitéré sa position selon laquelle la réintégration d’un salarié, dont le licenciement avait été déclaré nul, n’était pas rendue matériellement impossible par le fait que ce dernier était entré au service d’un nouvel employeur[54].
Ainsi, le droit ivoirien fait-il le choix d’une réparation prioritairement en nature, traduisant une conception plus exigeante de la protection des libertés du travailleur. En érigeant la réintégration en principe, le législateur ivoirien affirme que l’accès au juge et l’exercice des droits fondamentaux ne peuvent jamais devenir un risque professionnel. Cette option normative contribue à renforcer la confiance des salariés dans l’institution judiciaire et à promouvoir une culture de légalité au sein de l’entreprise. Toutefois, cette protection, aussi forte soit-elle, n’est pas absolue dans sa mise en œuvre pratique. Il arrive que l’employeur refuse d’exécuter la réintégration, invoquant des difficultés organisationnelles, un climat social dégradé ou une rupture irrémédiable du lien de confiance. C’est précisément l’analyse de ces situations de refus et de leurs conséquences juridiques et indemnitaires qui fait l’objet de la sous-partie suivante, consacrée au refus de réintégration et à ses effets.
B. Le refus de réintégration et ses conséquences indemnitaires
Si la réintégration constitue, en vertu de l’article 6 du Code du travail ivoirien, la sanction de principe du licenciement prononcé en représailles à l’action en justice du salarié, la pratique révèle toutefois des situations dans lesquelles l’employeur refuse d’exécuter cette obligation légale. Ce refus, lorsqu’il est imputable à l’employeur, n’est pas neutre juridiquement : il ouvre la voie à un régime indemnitaire spécifique, organisé principalement par l’article 18.15 du Code du travail, dont l’analyse soulève d’importantes questions quant à la réparation effective du préjudice subi par le salarié et à la fonction dissuasive de la sanction.
Le refus de réintégration est d’abord envisagé par le législateur comme une faute distincte, venant s’ajouter à l’illégalité initiale du licenciement. En effet, lorsque l’employeur persiste à écarter le salarié malgré la nullité constatée de la rupture, il s’affranchit délibérément d’une obligation légale impérative. Cette attitude traduit non seulement un manquement à l’autorité de la loi, mais également une atteinte renouvelée aux droits fondamentaux du travailleur, en particulier à son droit à l’emploi et à la protection juridictionnelle effective[55]. La doctrine ivoirienne souligne à juste titre que ce refus ne saurait être assimilé à une simple inexécution contractuelle, mais doit être appréhendé comme un comportement aggravant, révélateur d’une volonté de neutraliser l’effet protecteur de l’action en justice[56].
Dans une telle hypothèse, l’article 6 renvoie expressément au régime des dommages-intérêts prévu à l’article 18.15 du Code du travail. Ce texte organise la réparation du licenciement abusif ou illicite en fixant un barème fondé sur l’ancienneté du salarié. Lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, les dommages-intérêts sont équivalents à un mois de salaire brut par année d’ancienneté, avec un plancher de trois mois et un plafond de vingt mois de salaire brut. Appliqué au refus de réintégration, ce mécanisme vise à compenser l’ensemble des préjudices subis par le salarié du fait de son éviction prolongée : perte de revenus, atteinte à la carrière, préjudice moral et déstabilisation sociale.
Toutefois, l’articulation entre la nullité du licenciement et le plafond indemnitaire de l’article 18.15 soulève des interrogations doctrinales majeures. En principe, la nullité appelle une réparation intégrale du préjudice, sans limitation prédéterminée. Or, le plafonnement des dommages-intérêts peut apparaître comme une restriction à ce principe, susceptible de réduire la portée dissuasive de la sanction. Certains auteurs estiment que l’application mécanique du plafond indemnitaire à une situation aussi grave que le refus de réintégration affaiblit la protection conférée par l’article 6, en permettant à l’employeur d’« acheter » son refus au prix d’une indemnité plafonnée[57].
La comparaison avec le droit français est, à cet égard, éclairante. En France, lorsque le licenciement est nul pour atteinte à une liberté fondamentale, le salarié peut obtenir une indemnisation sans plafond, couvrant l’intégralité du préjudice subi, indépendamment du barème instauré par l’ordonnance de 2017[58]. La Cour de cassation française a ainsi affirmé que le barème d’indemnisation ne s’applique pas aux licenciements nuls, précisément en raison de la gravité de l’atteinte portée aux droits fondamentaux[59]. Cette solution jurisprudentielle consacre une hiérarchie normative entre la liberté fondamentale violée et les mécanismes de plafonnement indemnitaire.
En droit ivoirien, en revanche, le renvoi explicite à l’article 18.15 laisse entendre que le législateur a entendu maintenir un encadrement des réparations, même en présence d’une nullité particulièrement grave. Cette option peut être interprétée comme une volonté de concilier la protection du salarié avec la prévisibilité financière pour l’employeur, dans un contexte économique marqué par la fragilité de nombreuses entreprises. Néanmoins, elle n’est pas exempte de critiques. Plusieurs analyses doctrinales plaident pour une interprétation évolutive de l’article 6, permettant au juge ivoirien d’écarter le plafond indemnitaire lorsque le refus de réintégration révèle une atteinte manifeste et répétée aux droits fondamentaux du salarié[60].
Au-delà de la réparation individuelle, la question de la fonction dissuasive de l’indemnité demeure centrale. Une indemnité plafonnée, même élevée, peut s’avérer insuffisante pour dissuader certains employeurs de persister dans des pratiques de représailles, notamment dans les grandes entreprises disposant d’une forte capacité financière. À l’inverse, une indemnisation plus largement appréciée par le juge renforcerait l’effectivité du droit à l’action en justice, en envoyant un signal clair quant au coût juridique et social des représailles patronales[61].
En définitive, le refus de réintégration constitue une épreuve décisive pour l’effectivité du dispositif ivoirien de protection des droits fondamentaux du salarié. Si le recours aux dommages-intérêts de l’article 18.15 offre une voie de réparation certaine, il soulève des débats quant à son adéquation avec la gravité de l’atteinte sanctionnée. L’avenir dira si la jurisprudence ivoirienne choisira de renforcer la portée de l’article 6 par une interprétation audacieuse et protectrice, ou si elle s’en tiendra à une application stricte du cadre indemnitaire existant.
IV. PORTEE, LIMITES ET PERSPECTIVES DU DISPOSITIF IVOIRIEN
L’analyse de l’action en justice du salarié et de la protection spécifique que lui accorde le Code du travail ivoirien conduit, à ce stade, à une réflexion plus large sur la portée normative, les apports structurants et les faiblesses persistantes de ce dispositif. Cette dernière partie se propose ainsi d’évaluer, d’une part, les acquis majeurs du régime ivoirien en matière de protection contre les représailles patronales, et, d’autre part, d’en identifier les limites pratiques et les perspectives d’évolution nécessaires à une effectivité renforcée. Elle s’articule autour de deux axes complémentaires notamment les apports ,majeurs du régime ivoirien (A), puis les limites pratiques et perspectives d’évolution (B).
A. Les apports majeurs du régime ivoirien
Le premier mérite du dispositif ivoirien réside dans la consécration explicite et autonome d’une protection contre les représailles patronales liées à l’exercice de l’action en justice. En érigeant l’action en justice pour faire respecter les droits fondamentaux du travailleur en cause de nullité du licenciement, l’article 6 du Code du travail ivoirien dépasse la logique classique de l’abus de droit pour entrer dans celle, plus exigeante, de la protection des libertés fondamentales en milieu professionnel. Cette option normative traduit une prise de position claire du législateur : le recours au juge ne saurait, en aucun cas, exposer le salarié à une sanction déguisée, sans porter atteinte à l’État de droit lui-même[62].
Cette protection renforcée s’inscrit dans une conception moderne du droit du travail, selon laquelle le salarié ne peut être effectivement titulaire de droits que s’il est en mesure de les faire valoir sans crainte. Comme l’a souligné Alain Supiot, « un droit qui ne peut être exercé sans risque cesse d’être un droit pour devenir une simple faculté théorique »[63]. En ce sens, l’article 6 joue un rôle essentiel de sécurisation de l’accès à la justice, en neutralisant l’effet dissuasif que pourrait produire la menace d’un licenciement de représailles. Il ne s’agit donc pas seulement de protéger l’emploi du salarié, mais de garantir la vitalité du contentieux social et, plus largement, l’effectivité de l’ordre public social.
Le dispositif ivoirien se distingue également par son caractère dissuasif, qui tient à la combinaison de deux mécanismes complémentaires : la nullité du licenciement et la réintégration de droit du salarié. Contrairement aux régimes fondés uniquement sur l’indemnisation, la réintégration automatique impose à l’employeur une contrainte forte, tant sur le plan organisationnel que symbolique. Elle signifie que l’employeur ne peut tirer aucun bénéfice de l’éviction illicite du salarié et qu’il doit rétablir la situation antérieure, comme si la rupture n’avait jamais existé[64]. Cette logique rejoint celle développée par la Cour de cassation française à propos des licenciements nuls pour atteinte à une liberté fondamentale, pour lesquels la réintégration constitue la sanction de principe.
Sur le plan comparatif, l’originalité du droit ivoirien apparaît avec une acuité particulière dans l’Afrique francophone. Dans de nombreux États de l’espace OHADA ou de l’UEMOA, la protection contre les représailles liées à l’action en justice demeure diffuse, souvent rattachée au régime général du licenciement abusif, sans consécration expresse de la nullité. En droit sénégalais, par exemple, si la liberté syndicale et le droit d’ester en justice sont reconnus, la sanction du licenciement de représailles reste essentiellement indemnitaire[65]. De même, en droit camerounais, la jurisprudence hésite encore à qualifier de nul le licenciement fondé sur l’exercice d’un recours juridictionnel, privilégiant l’octroi de dommages-intérêts[66].
À cet égard, le législateur ivoirien se singularise par une approche plus ambitieuse et plus protectrice, qui place l’action en justice parmi les droits intangibles du salarié, au même titre que la liberté syndicale ou la dignité au travail. Cette orientation s’inscrit pleinement dans l’esprit des conventions de l’OIT, notamment la Convention n° 158, qui prohibe toute rupture du contrat motivée par le dépôt d’une plainte ou la participation à une procédure contre l’employeur[67]. Elle confère au droit ivoirien une avance normative certaine dans la région, en faisant de la protection juridictionnelle du salarié un pilier assumé du droit du travail. Toutefois, ces apports substantiels ne doivent pas occulter les difficultés de mise en œuvre et les zones d’ombre qui affectent encore le dispositif. C’est pourquoi, après avoir mis en lumière les acquis majeurs du régime ivoirien, il convient désormais d’en examiner les limites pratiques et d’esquisser les perspectives d’évolution susceptibles d’en renforcer l’effectivité et la cohérence
B. Les limites pratiques et perspectives d’évolution
Si le régime ivoirien de protection du salarié qui agit en justice apparaît, sur le plan normatif, particulièrement ambitieux et protecteur, son effectivité concrète demeure confrontée à un ensemble de difficultés pratiques et structurelles qui en limitent parfois la portée réelle. Ces limites tiennent aussi bien aux obstacles probatoires et procéduraux qu’aux contraintes sociologiques et institutionnelles propres au contexte ivoirien. Elles appellent, en retour, une réflexion prospective sur les évolutions nécessaires afin de consolider ce dispositif et d’en faire un véritable levier de protection des droits fondamentaux au travail.
La première difficulté majeure réside dans la preuve du licenciement de représailles. En théorie, l’article 6 du Code du travail pose une interdiction claire : tout licenciement motivé par l’action en justice du salarié est nul. En pratique, toutefois, il est rarement aisé pour le travailleur d’établir le lien de causalité entre son recours juridictionnel et la rupture de son contrat. L’employeur, conscient du risque juridique, aura tendance à invoquer un motif apparemment neutre ou distinct : insuffisance professionnelle, faute disciplinaire, réorganisation interne afin de masquer la véritable raison de la rupture. Cette stratégie de contournement, bien connue en droit comparé, rend la démonstration de représailles particulièrement délicate[68].
En l’absence de texte organisant explicitement un aménagement de la charge de la preuve, le juge ivoirien se trouve placé au cœur du dispositif. Or, contrairement au droit français, où la jurisprudence a progressivement admis que le salarié n’a qu’à présenter des éléments laissant présumer l’existence d’une atteinte à un droit fondamental, la pratique ivoirienne demeure encore marquée par une approche classique de la preuve, souvent exigeante à l’égard du travailleur. Cette situation peut fragiliser l’effectivité de la protection, car le salarié, déjà en position de faiblesse économique et psychologique, se trouve confronté à une charge probatoire lourde, parfois difficilement compatible avec la réalité des relations de travail.
À cette difficulté s’ajoute celle de la durée des procédures judiciaires. Le contentieux du travail en Côte d’Ivoire, bien qu’encadré par des règles de célérité, demeure souvent marqué par des délais significatifs, liés notamment à l’encombrement des juridictions, au nombre limité de magistrats spécialisés et aux reports d’audience. Or, dans les litiges relatifs à la réintégration, le temps joue un rôle déterminant : plus la procédure s’allonge, plus la réintégration devient matériellement et humainement complexe, voire conflictuelle. Comme le souligne Jean Carbonnier, « le temps du procès peut devenir, en lui-même, une forme de déni de justice lorsque la protection attendue perd sa substance »[69].
Les pressions sociales et professionnelles constituent un autre facteur limitatif, souvent sous-estimé. Dans un contexte où le taux de chômage demeure élevé et où la dépendance économique à l’égard de l’emploi est forte, de nombreux salariés hésitent à engager une action en justice contre leur employeur, même en présence d’une protection légale théoriquement robuste. La crainte d’une stigmatisation professionnelle, d’un isolement au sein de l’entreprise ou d’une mise à l’écart informelle peut dissuader le travailleur de faire valoir ses droits. Cette dimension sociologique rappelle que l’effectivité du droit ne dépend pas uniquement de la qualité des normes, mais aussi de la culture juridique et sociale dans laquelle elles s’insèrent[70].
Ces difficultés mettent en lumière le rôle encore perfectible de la jurisprudence ivoirienne. À ce jour, les décisions publiées relatives à l’article 6 du Code du travail demeurent rares, ce qui limite la construction d’un corpus jurisprudentiel stable et prévisible. Or, comme l’illustre l’exemple français, c’est largement par l’œuvre du juge que les principes de protection contre les représailles ont acquis leur pleine effectivité, notamment par l’affirmation du caractère fondamental du droit d’ester en justice et par l’assouplissement des règles de preuve. Il serait dès lors souhaitable que les juridictions ivoiriennes s’inscrivent dans une dynamique similaire, en adoptant une interprétation téléologique de l’article 6, orientée vers la protection effective du salarié et la dissuasion des pratiques patronales abusives.
Dans une perspective d’évolution, plusieurs pistes peuvent être envisagées. La première consisterait à clarifier législativement le régime probatoire, en consacrant explicitement un mécanisme d’aménagement de la charge de la preuve inspiré des droits français et européen. Une telle réforme renforcerait la sécurité juridique des salariés et faciliterait l’intervention du juge dans la qualification de la nullité. La deuxième piste réside dans le renforcement du rôle de l’Inspection du Travail, qui pourrait être dotée de pouvoirs accrus en matière de constatation et de prévention des licenciements de représailles, notamment par des enquêtes administratives plus systématiques et des mesures conservatoires.
Enfin, l’avenir du dispositif ivoirien pourrait s’inscrire dans une logique plus large de contentieux stratégique des droits fondamentaux au travail. Cette approche, développée dans plusieurs ordres juridiques, consiste à utiliser le procès non seulement comme un moyen de réparation individuelle, mais aussi comme un instrument de transformation normative et sociale[71]. En favorisant des décisions de principe, largement diffusées et commentées, les juridictions ivoiriennes pourraient contribuer à faire émerger une véritable culture de respect des droits fondamentaux dans l’entreprise, où l’action en justice ne serait plus perçue comme une provocation, mais comme l’exercice normal d’un droit citoyen.
Si le dispositif ivoirien présente des limites indéniables, celles-ci ne remettent pas en cause sa pertinence fondamentale. Elles invitent plutôt à une consolidation progressive, à la croisée de la réforme législative, de l’audace jurisprudentielle et de la sensibilisation des acteurs sociaux. C’est à ce prix que l’article 6 du Code du travail pourra pleinement jouer son rôle de garantie effective de la liberté d’action en justice du salarié, pilier indispensable d’un droit du travail moderne et équilibré.
CONCLUSION
L’analyse du régime juridique consacré par l’article 6 du Code du travail ivoirien met en lumière une construction normative ambitieuse, dont la finalité première est de garantir l’effectivité des droits fondamentaux du travailleur face au pouvoir de direction et de sanction de l’employeur. En érigeant l’action en justice en un droit spécialement protégé, le législateur ivoirien a entendu rompre avec une logique purement réparatrice pour affirmer une protection de nature structurelle et dissuasive, fondée sur la nullité de plein droit du licenciement de représailles et sur la consécration d’un droit subjectif à la réintégration.
D’un point de vue critique, ce régime présente des atouts indéniables. La qualification du licenciement fondé sur l’action en justice comme nul, et non simplement abusif, marque une différence de nature et non de degré dans la protection du salarié. Elle traduit la reconnaissance de l’action en justice comme un droit fondamental, intimement lié aux principes constitutionnels d’accès au juge et de protection juridictionnelle effective[72]. En outre, la réintégration de droit, prévue expressément par l’article 6, confère à la norme ivoirienne une originalité notable en droit comparé, là où de nombreux systèmes juridiques, y compris le droit français, privilégient encore une logique indemnitaire souvent perçue comme insuffisamment dissuasive[73].
Toutefois, ce dispositif révèle également des limites structurelles qui en atténuent parfois l’impact pratique. L’absence de précisions législatives sur l’aménagement de la charge de la preuve, la rareté de la jurisprudence publiée et les contraintes socioprofessionnelles pesant sur les salariés constituent autant de facteurs susceptibles de fragiliser l’effectivité de la protection. Ces limites ne tiennent pas tant à une carence normative qu’à un déficit d’appropriation et de mise en œuvre, tant par les juridictions que par les acteurs de l’entreprise. À cet égard, l’expérience comparée montre que la force des droits fondamentaux au travail dépend moins de leur proclamation que de la capacité des juges à leur donner une portée concrète et opérationnelle[74].
Au-delà de son ancrage technique, l’article 6 du Code du travail ivoirien s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’État de droit social. En protégeant le salarié contre toute forme de représailles liées à l’exercice d’un recours juridictionnel, le législateur affirme que l’entreprise ne saurait constituer une zone de non-droit, soustraite aux exigences fondamentales de justice et d’égalité. L’action en justice devient ainsi un instrument de régulation des relations de travail, permettant de rééquilibrer un rapport structurellement inégal et de renforcer la légitimité du droit du travail comme droit protecteur et émancipateur[75].
L’enjeu futur réside dès lors dans la capacité du système juridique ivoirien à dépasser une approche strictement contentieuse pour promouvoir une culture de la conformité juridique et du dialogue social effectif au sein de l’entreprise. La prévention des licenciements de représailles passe non seulement par la sanction a posteriori, mais aussi par la diffusion d’une culture de respect des droits fondamentaux, impliquant les employeurs, les organisations syndicales et l’Inspection du Travail. Dans cette perspective, l’article 6 pourrait devenir le socle d’un contentieux stratégique des droits fondamentaux au travail, contribuant à faire émerger une jurisprudence structurante et à renforcer la confiance des travailleurs dans l’institution judiciaire.
En définitive, loin d’être une simple disposition technique, l’article 6 du Code du travail ivoirien apparaît comme un marqueur normatif fort de l’évolution du droit social ivoirien vers un modèle plus protecteur, plus exigeant et plus conforme aux standards internationaux. Sa pleine effectivité dépendra toutefois de la convergence des volontés législative, jurisprudentielle et sociale, condition indispensable à l’affirmation d’un droit du travail véritablement au service de la dignité humaine et de la justice sociale.
Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : (+225) 27 23 23 21 64 / 05 96 11 90 94 / 01 52 90 45 19 (WhatsApp)
Achetez le Kit du travailleur (Guide pour connaître tous ses droits en tant que travailleur) au prix de 35500 FCFA en suivant ce lien : https://cabinetldjsarl.com/formation/kit-du-travailleur-guide-pour-connaitre-tous-ses-droits-en-tant-que-travailleur/
Me Luc KOUASSI
Juriste Consultant Polyglotte | Consultant–Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et de questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.
denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28
[1] Lhernould (J.-P.), Droit du travail : Relations individuelles, Edito, 2003, p. 87.
[2] Supiot (A.), Critique du droit du travail, PUF, 2015, p. 143.
[3] Despax (M.), Droit du travail, PUF, 2001, 128 p.
[4] Code du travail ivoirien, Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015, art. 6.
[5] Ibid., art. 18.15.
[6] Verkindt (P.-Y.), Favennec-Hery (F.) et Duchange (G.), Droit du travail, LGDJ, 9e éd., 2024, p. 512.
[7] OIT, Convention n° 158 sur le licenciement, 1982, art. 5 ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 2 §3.
[8] Code du travail ivoirien, Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015, art. 6.
[9] Supiot (A.), Op. cit., p. 167.
[10] Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, Préambule, art. 2 et 20.
[11] Ouguergouz (F.), La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Graduate Institute Publications, 1993, p. 412.
[12] Lhernould (J.-P.), Op. cit., p. 92.
[13] OIT, Convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
[14] OIT, Convention n°98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
[15] OIT, Convention n°158 sur le licenciement, 1982, art. 5 c).
[16] Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, art. 2 §3.
[17] Despax (M.), Op. cit.
[18] Code du travail ivoirien, Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015, art. 4.
[19] Ibid., art. 5.
[20] Ibid., art. 51.1 et s.
[21] Ibid., art. 41.1 et s.
[22] Supiot (A.), Op. cit., p. 183.
[23] Soc. 23 sept. 2003, n° 01-41.478 : D. 2004. 102, et les obs., obs. M.-C. Amauger-Lattes
[24] OIT, Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998.
[25] Manh (Y. B), « La dignité du salarie en droit ivoirien du travail », dans Revista Estudios Jurídicos. Segunda Época, 23, 2023, p. 27.
[26] Lhernould (J.-P.), Op. cit., p. 101.
[27] Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.122, Publié au bulletin
[28] OIT, Convention n°158, art. 5 (c).
[29] Cass. soc., 10 sept. 2025, no 23-21.124 ; Lyon-Caen (G.), Supiot (A.) et Pélissier (A), Droit du travail, Dalloz, 18e éd., 2000, p. 742.
[30] Despax (M.), Op. cit.
[31] Code du travail ivoirien, art. 6, Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015.
[32] Supiot (A.), Op. cit., p. 107.
[33] OIT, Convention n°158 sur le licenciement, art. 5 (c), 1982.
[34] Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 2 §3 et art. 14.
[35] Code du travail ivoirien, art. 6, al. 2.
[36] Code du travail ivoirien, art. 18.15.
[37] Soc. 23 sept. 2003, n° 01-41.478 : Op. cit.
[38] Code du travail ivoirien, art. 18.15, al. 2.
[39] Supiot (A.), Op. cit., p. 123.
[40] Lhernould (J.-P.), Op. cit., p. 117.
[41] Cass. soc. 3-2-2016 n° 14-18.600
[42] CJUE, 19 avril 2012, aff. C-415/10, Meister.
[43] OIT, Convention n°158 sur le licenciement, art. 9 et 10.
[44] Comité des droits de l’homme, Observation générale n°32, 2007.
[45] Verkindt (P.-Y.), Favennec-Hery (F.) et Duchange (G.), Op. cit., p. 517.
[46] Manh (Y. B), Op. cit., p. 29.
[47] Supiot (A.), Op. cit., p. 125.
[48] Code du travail ivoirien, art. 6.
[49] Lhernould (J.-P.), Op. cit., p. 121.
[50] Manh (Y. B), Op. cit., p. 30.
[51] OIT, Convention n°158 sur le licenciement, art. 10.
[52] C. trav. fr., art. L. 1235-3-1.
[53] Ray (J.-E.), Droit du travail : Tout savoir sur les relations individuelles, mais aussi les rapports collectifs de travail, LIAISONS SOCIALES, 2019, p. 512.
[54] Arrêt n°19-20397, publié au Bulletin de la Cour de cassation.
[55] Code du travail ivoirien, art. 6 et art. 18.15, Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015.
[56] Manh (Y. B), Op. cit., p. 32.
[57] Supiot (A.), Op. cit., p. 127.
[58] C. trav. fr., art. L. 1235-3-1 ; https://www.village-justice.com/articles/bareme-macron-epreuve-critiques-persistantes,53137.html
[59] https://accens-avocats.com/blog/2022/05/19/la-validite-du-bareme-dindemnisation-macron-du-salarie-licencie-sans-cause-reelle-et-serieuse/#:~:text=A%20cet%20%C3%A9gard%2C%20la%20Cour%20rel%C3%A8ve%20que,fondamentale%2C%20harc%C3%A8lement%20moral%20ou%20sexuel%2C%20discrimination%2C%20etc%E2%80%A6
[60] Lhernould (J.-P.), Op. cit., p. 124.
[61] OIT, Comité de la liberté syndicale, Rapport n° 371, § 1095.
[62] Code du travail ivoirien, art. 6, Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015.
[63] Supiot (A.), Op. cit., p. 137.
[64] Lhernould (J.-P.), Op. cit., p. 131.
[65] Seck (A.), Quelle(s) finalité(s) pour le droit du travail sénégalais?, Mémoire de Master, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), 2017, disponible sur https://www.memoireonline.com/07/22/13043/Quelles-finalits-pour-le-droit-du-travail-sngalais.html, consultee le 13/12/2025.
[66] Yanpelda (V.), Le droit du travail au Cameroun, Tome 1, Dionoia, 2022, p. 312.
[67] OIT, Convention n° 158 sur le licenciement, art. 5, 1982.
[68] Lhernould (J.-P.), Op. cit., p. 133.
[69] Carbonnier (J.), Flexible droit, LGDJ, 2013, p. 276.
[70] Supiot (A.), Op. cit., p. 140.
[71] Deakin (S.) et Morris (G.), Labour Law, Hart Publishing, 2012, p. 145.
[72] Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14 ; Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016.
[73] Supiot (A.), Op. cit., p. 141.
[74] Lyon-Caen (G.), Supiot (A.) et Pélissier (A), Op. cit., p. 748.
[75] Güzel (A.), Çatalkaya (D.) et Heper (H.), « Droits et libertés fondamentaux du citoyen-salarié en droit du travail », dans Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 2022, pp. 221-263.