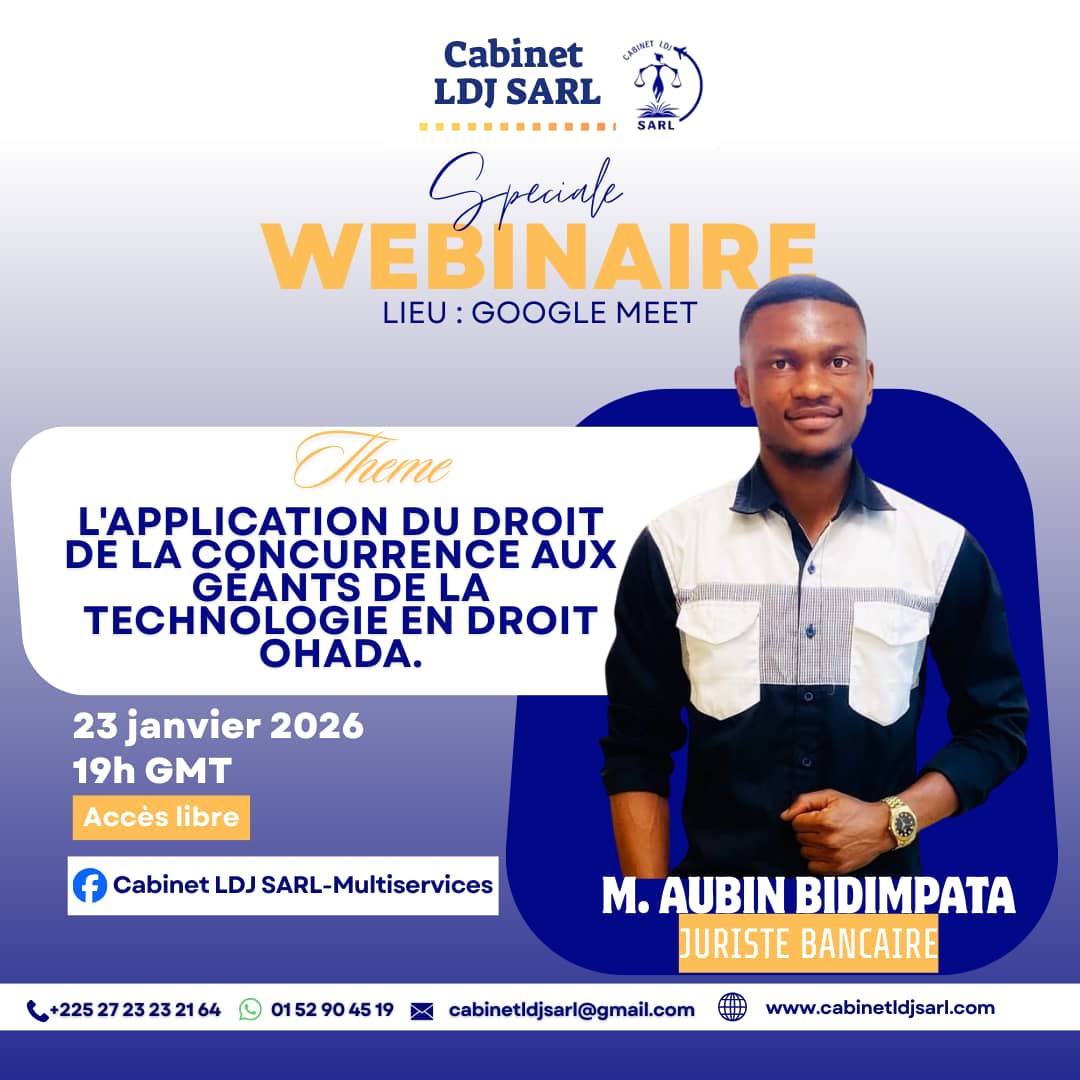L’émergence fulgurante de législations de la concurrence dans les pays en développement témoignent des vertus supposées ou réelles de telles politiques dans le processus de développement économique ; Perçues à l’origine comme faisant partie des « pilules de développement » prescrites par les institutions financières internationales[1], nous semblons nous glisser vers une acceptation volontaire des politiques de la concurrence comme un outil de développement. Certes, l’OHADA, dans son processus d’unification du droit des affaires de ses États membres, s’est fixé comme credo la mise en place d’un droit simple, moderne et adapté[2], dans l’optique d’attirer les investisseurs. En effet, à l’ère du primat de l’attractivité ou de l’impératif pour un système juridique d’être le plus « séduisant possible pour les investisseurs », le cadre réglementaire des télécoms constitue l’un des leviers retenus par les experts en développement économique comme le préalable à l’édification des infrastructures de communication électronique en Afrique. L’intégration juridique est le moteur de l’intégration économique. Ceci est d’autant plus vrai pour le droit de la concurrence, qui vise à réguler les activités des entreprises sur le marché[3]. Le droit de la concurrence est souvent perçu comme un instrument juridique qui doit accompagner la mise en place d’une union douanière ou d’un marché commun.
Cependant, l’étude démontre qu’avec l’avènement des technologies de l’information et de la communication, nous sortons d’un cadre classique de réglementation de la concurrence vers une atteinte plus structurée, intelligente où ces atteintes (pratiques anticoncurrentielles) se déroulent virtuellement pour en causer des dégâts aussi semblables que physiquement. L’analyse d’une politique de la concurrence des géants de la technologie dans l’espace OHADA ne peut être que prospective. Cette problématique requiert une analyse minutieuse des objectifs, de l’architecture institutionnelle ainsi que du droit matériel de l’OHADA à l’aune des objectifs généralement assignés à une politique régionale de la concurrence face à l’avancée technologique dont fait preuve la conjoncture actuelle de la mondialisation. Car une politique de la concurrence ne peut produire les résultats escomptés en termes de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, de promotion de l’efficience économique et d’augmentation du bien-être des consommateurs que si elle est accompagnée de la mise en place d’un cadre institutionnel adéquat.
C’est pourquoi, au-delà des intérêts de la présente analyse, il convient de préciser que l’objectif ultime et le nœud gordien de cette étude se veut d’être une réponse face à l’absence d’une politique de la concurrence dans l’armada juridique OHADA qui facilite des nombreux défis et obstacles économiques des Etats face aux géants de la technologie.
INTRODUCTION
Le droit des affaires étant un domaine si vaste et trop technique, son évolution par rapport à son adaptation aux situations des sociétés dans lesquelles il est appelé à cohabiter avec certains faits et phénomènes sociaux à toutes les fois suscité la curiosité des juristes et surtout celle des affairistes. De plus, nombre de juristes d’affaires ont eu cette encourageante tendance à s’escrimer dans le domaine des affaires ; à combien plus forte raison dans le droit de l’OHADA, une organisation d’intégration juridique et économique qui est à son apogée, ce, depuis le début du vingt unième siècle (20e) dans l’Afrique centrale et occidentale, mis à part ses influences dans d’autres cieux.
Victor KALUNGA TSHIKALA ayant analysé le Droit des affaires depuis son apparition dans les civilisations anciennes (telles que Babylone, la Phénicie, la Grèce, et le Rome) jusqu’à l’état où ces règles du droit des affaires (ou mieux le droit commercial) ont fait objet d’harmonisation dans certaines communautés, en l’occurrence le droit de l’OHADA, conclura opiniâtrement et avec obstination que le droit commercial congolais ainsi que ceux des anciennes colonies françaises d’Afrique sont quasiment des copies du code Napoléon. Tel est aussi le cas du droit issu de l’OHADA[4].
Non seulement son analyse s’apparente à la nôtre par le fait qu’il ait parlé à un moment de l’évolution du droit des affaires dans l’espace OHADA, mais celle-ci diffère à la nôtre par le fait que de notre part nous sommes en train de faire une analyse prospective du droit des affaires OHADA, notion qui fait jusque-là défaut d’harmonisation dans ce grand ensemble.
Mor BAKHOUM qui a axé son étude sur les ‘’perspectives africaines d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA’’, estime que réfléchir à la problématique d’une politique de la concurrence dans l’espace de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), c’est s’interroger d’emblée sur la pertinence des politiques de la concurrence pour l’Afrique et pour les pays en développement de manière générale. Une telle interrogation peut, continue-t-il, paraître anachronique eu égard au développement sans précédent des politiques de la concurrence dans les pays en développement depuis les années 1990[5].
Les investisseurs sont certes attirés par les zones à fortpotentiel, mais la décision de miser ou non est souvent influencée par la situation juridique de la zone. Et c’est là toute la compatibilité d’une politique de la concurrence avec les objectifs de l’OHADA : l’une cherche à attirer les investisseurs et l’autre les rassure. Car souvent, les politiques nationales de la concurrence ne sont pas assez fortes et indépendantes étant donné qu’elles sont sous tutelle d’une autre administration. Les Etats seront donc susceptibles d’aider illégalement des entreprises nationales en difficulté, sans compter sur les ententes illicites entre entreprise de grande taille en violation de toutes les règles de marché Publics, au détriment des PME. Un droit de la concurrence bien adapté à la situation OHADA serait un atout de taille.
Dans cette perspective, les puissances publiques ont, d’ores et déjà, adopté plusieurs textes de droit devant intervenir dans bien de matières de nature économique telles que dans le commerce intérieur et extérieur (ou transfrontalier), dans le transport, les investissements, les assurances, l’organisation des sociétés commerciales et coopératives, les sûretés, la réglementation des changes, la fixation et le contrôle des prix, la concurrence commerciale ; si nous ne pouvons citer que celles-là. Réfléchir à la problématique d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA, c’est s’interroger d’emblée sur la pertinence des politiques de la concurrence pour l’Afrique et pour les pays en développement, de manière générale, et sur la montée en puissance du commerce électronique qui transcende les frontières grâce aux nouvelles technologies de l’Information et de la communication.
Certes, le 21e siècle a connu une grande révolution informatique, ouvrant les frontières de la pensée et de la connaissance, emmenant avec lui des techniques nouvelles et des pratiques qui jadis n’existaient pas. Depuis lors, l’échelle planétaire a connu une évolution technologique explosive avec l’avènement de ces nouvelles technologies de l’information. Dans cette optique, l’application du droit de la concurrence sur l’espace OHADA aux géants de la technologie est soumise aux mêmes règles que les autres entreprises. Étant donné que le droit de la concurrence vise à garantir un environnement concurrentiel sain en limitant les pratiques anti-concurrentielles et en favorisant la libre concurrence. On sait en effet que l’économie contemporaine est dominée par le concept « mondialisation » dont l’une des marques essentielles de vaste sous-ensembles parfois appelés « pôles économiques » qui semble conduire à une sorte de partage d’influence sur le marché concurrentiel dominé par les géants de la technologie.
En somme, l’analyse de la problématique de la pertinence d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA. Des matières qui ont fait l’objet d’uniformisation par des actes uniformes, le droit de la concurrence est le grand absent. Pourquoi une absence d’uniformisation dans ce domaine, à l’heure où on tend vers une régionalisation des politiques de la concurrence dans les pays en développement et la mondialisation ? Une politique régionale contribuerait-elle à l’atteinte des objectifs de l’OHADA, notamment l’harmonisation du droit des affaires, la promotion et la sécurisation des investissements ? Enfin, comment le droit de la concurrence s’applique-t-il aux géants de la technologie et quels sont les défis rencontrés dans la régulation de ces acteurs ? Ainsi, l’analyse de la concurrence commerciale (chapitre I) en oscillant certes entre le droit de la concurrence OHADA à l’ère du numérique (Chapitre II) seront le cheval de bataille dans les lignes qui suivent.
Le droit de la concurrence comme branche spécialisée du droit des affaires intéresse bon nombre de juristes d’entreprises de notre ère tant et si bien qu’il regroupe l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires visant à garantir le respect du principe de la liberté de commerce et de l’industrie au sein d’une économie de libre marché.
C’est pourquoi il est question dans ce chapitre de cerner dans un premier temps les généralités sur le droit de la concurrence (Section 1), ensuite, les notions sur les principes de base de la concurrence commerciale (Section 2).
Le droit de la concurrence est l’ensemble des règles juridiques, bien entendu, qui organisent les rapports de rivalité et de coopération entre entreprises dans le cadre de leurs démarches de conquête ou de préservation de la clientèle. Il gouverne les rapports entre les entreprises et le fonctionnement du marché[6].
Entendu dans son sens le plus général, le droit de la concurrence comporte deux aspects : le droit de la concurrence en tant qu’instrument de maintien, sur le marché, d’une concurrence suffisante et le droit de la concurrence déloyale. Ces deux aspects : positif et négatif de la notion de concurrence présentent une phraséologie et un catalogue d’images bien distincts[7].
De ce fait, le droit de la concurrence poursuit des objectifs de favoriser la liberté et de préserver la loyauté de la concurrence car, dit-on, la liberté sans la loyauté n’est que chaos. Il protège la libre concurrence et garantit la libre confrontation entre opérateurs économiques et la liberté de commerce et de l’industrie. Il réprime les pratiques contraires à la loi et aux usages de commerce ; les coalitions ou ententes illicites et les abus de position économique et de position dominante.
Bien plus, on entend presque unanimement par droit de la concurrence la branche du droit qui s’intéresse à l’ensemble des règles juridiques gouvernant les rivalités entre agents économiques dans la recherche et la conservation d’une clientèle et visant à sauvegarder la concurrence non seulement en tentant de limiter la concentration d’entreprises, les monopoles, mais aussi en s’efforçant de maintenir des méthodes loyales de concurrence. Autrement dit, ce droit a pour objet de favoriser la libre concurrence[8].
Le droit de la concurrence s’applique aux entreprises commerciales et non commerciales comme les artisans, les sociétés civiles et les membres des professions libérales. Les entreprises publiques sont soumises aux règles de concurrence dès lors qu’elles exercent une activité économique dans les mêmes conditions que les entreprises privées[9].
Bref, le domaine du droit de la concurrence est fort ample du fait qu’il couvre non seulement les activités commerciales mais également toutes les activités de production, de distribution ou de service, même lorsqu’elles ont un caractère civil dès lors que ces activités sont exercées sur un marché ayant un aspect collectif. C’est le cas des activités culturelles soumises au droit de la concurrence à condition d’avoir des implications de caractère économique.
Ainsi donc, les notions générales de la concurrence commerciale sont relatives à l’historique des règles de la concurrence commerciale (Paragraphe 1), ensuite, à la démarcation entre les différents concepts tels que la concurrence, la concurrence loyale et la concurrence déloyale (Paragraphe 2).
Les règles régissant la concurrence commerciale sont d’antan et ce sont les grandes figures du droit romano-germanique et du droit anglo-saxon qui en sont les ténors et les premiers à en prendre possession. C’est pourquoi Emanuel COMBE affirme exceptionnellement qu’en matière de politique de la concurrence, les États-Unis font figure de pionnier[10].
A. En Amérique et en France
La politique antitrust voit le jour au niveau fédéral en juillet 1890 avec l’adoption du Sherman Act[11]. Ce texte législatif, relatif aux comportements d’entente et de position dominante, est né dans un contexte historique très particulier : la fin du XIXe siècle est en effet marquée sur le continent américain par une forte concentration industrielle, donnant naissance à de véritables « géants » dans des secteurs tels que le pétrole, la sidérurgie ou l’industrie électrique. Ce processus de concentration ne manque pas de susciter la crainte des consommateurs et des petits producteurs américains, crainte relayée par les hommes politiques, à l’image du sénateur Sherman.
Le Sherman Act est en réalité peu appliqué au départ et il faut attendre les crises financières du début du siècle (1902 puis 1907-1908) pour que les premiers grands « trusts » américains, à l’image de la « Standard Oil » dirigée par Rockefeller, soient inquiétés et même démantelés pour abus de position dominante.
À la suite du Sherman Act, les États-Unis adoptent en 1914 le Clayton Act et le FTC Act : ces trois textes formeront la base essentielle de la politique antitrust américaine, même s’ils connaîtront au cours du temps des amendements (en particulier le Clayton Act) et des interprétations diverses[12].
Cependant, le mouvement pour la réglementation de la concurrence a commencé plus tard. Nous le faisons remonter à un décret du 9 août 1953 qui chercha à maintenir et à établir la concurrence. La loi du 17 juillet 1977 qui portait sur le contrôle de la concentration économique, la répression des ententes illicites et des abus de position dominante. En réalité, cette loi ne faisait que traduire dans le droit français les directives des articles 85 et 86 de l’ancien traité des communautés européennes (traité de Rome dans sa version originale).
Toutefois, la première œuvre d’ensemble est l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence codifiée aux articles 410-1 et suivants du code de commerce. La loi MRE du 15 mai 2001 a modifié cette ordonnance[13].
B. En République démocratique du Congo
Il sied de retenir d’emblée, ici, que la naissance du droit de la concurrence est liée à la colonisation du Congo par les Belges. L’acte de Berlin du 26 février 1885 a consacré le principe de la liberté de commerce et de l’industrie. Le législateur a, par ordonnance législative n° 41-63 du 24 février 1950, interdit les actes de concurrence déloyale et institué l’action en cessation des actes contraires aux usages honnêtes du commerce[14].
Peu avant l’ordonnance législative n° 41-63 du 24 février 1950, l’ordonnance-loi du 1er août 1944 modifiée par l’ordonnance du 15 janvier 1945 instituait déjà un double régime de fixation de prix dont le régime applicable aux marchandises soumises à un pourcentage plafonné et le régime applicable aux marchandises dont la fixation de prix était libre pour les opérateurs économiques.
Dès lors, nombreux sont les textes législatifs et réglementaires qui se sont succédé. Mais actuellement, c’est la loi organique n° 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence qui régit la concurrence commerciale en République démocratique du Congo. Ce texte législatif a supplanté totalement et expressément toutes les dispositions de l’ordonnance-loi n° 41-63 du 24 février 1950 portant répression de la concurrence déloyale et du décret-loi du 2à mars 1961 tel que complété et modifié par l’ordonnance-loi n° 83-026 du 12 septembre 1983 sur la réglementation des prix, ainsi que toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires. Cependant, en attendant la signature du décret portant statut, organisation et fonctionnement de la commission nationale de la concurrence prévue par les dispositions de l’article 59[15] de cette loi organique, les attributions dévolues à cette dernière (la commission nationale de la concurrence) sont exercées par l’ancienne commission de la concurrence créée par l’arrêté départemental du 15 juin 1987.
C. Dans l’espace OHADA
Dans cet espace qui comprend comme nous l’avions dit ci-haut, dix-sept (17) États-membres, les règles internes qui gouvernent la concurrence commerciale préexistent bel et bien malgré qu’elles ne soient point harmonisées jusque-là par la communauté qui, tout en ayant l’objectif d’harmoniser le Droit des affaires, les regroupent tous.
§2. Concurrence, concurrence loyale et concurrence déloyale
De prime à bord, il convient de nuancer tant soit peu les concepts qui prêtent à confusion dans le langage juridique des juristes d’affaires. Ces notions sont notamment la concurrence, la concurrence loyale ainsi que la concurrence déloyale.
La concurrence se définit comme une structure du marché caractérisée par une confrontation libre d’un grand nombre d’offreurs et de demandeurs dans tout domaine et pour tout bien et service. C’est aussi une situation du marché dans laquelle il existe une compétition entre vendeurs et acheteurs. Cette compétition peut porter sur les prix, les parts du marché, etc[16].
Les économistes donnent à la concurrence une définition de résultat ; pour les économistes juristes, spécialistes du droit de la concurrence, ce terme appelle une définition de moyen, laquelle est fondée sur le principe de la liberté de la concurrence. D’où les termes concurrence-résultat et concurrence-moyen[17]. Dans les pays capitalistes occidentaux, la concurrence est considérée comme le régulateur du fonctionnement des industries et des entreprises, un stimulant du progrès technique et économique; voilà comment les économistes conçoivent généralement la concurrence. De leur côté, les économistes juristes estiment qu’elle est une notion de fait, une situation économique résultant de l’interaction des entreprises rivalisant sur un marché donné, situation dans laquelle la rivalité d’intérêts entre commerçants ou industriels qui tentent d’attirer à eux la clientèle par les meilleures conditions de prix, de qualité, de présentation des produits ou des services doit être encadrée par des politiques économiques mises en œuvre dans des lois qui favorisent le libre jeu de la concurrence en réglementant les marchés[18].
À notre humble avis, la concurrence est en quelque sorte une structure du marché dans laquelle les producteurs ou les firmes, les commerçants et les prestataires de services, qui poursuivent un même objectif (le lucre), se lancent dans une rivalité ou une compétition économique sous réserve des restrictions faites par les différents textes légaux et réglementaires.
B. La concurrence loyale
La concurrence telle que définie supra est loyale ou pure ou encore parfaite dès lors que certaines caractéristiques sont réunies. Et parmi celles-ci, citons l’atomicité des centres de décision, l’homogénéité des produits sur le marché, la transparence du marché et la fluidité parfaite de l’offre et de la demande ;
En effet, il y a atomicité des centres de décision lorsque non seulement il y a un grand nombre d’entreprises (ou d’offreurs ou encore de vendeurs) et acheteurs (ou demandeurs) mais aussi les entreprises doivent être de petite dimension et posséder une petite part du marché[19]. Les vendeurs et les acheteurs doivent subir le prix du marché ; ils ne doivent avoir aucune influence sur le prix et la valeur de la production. Ils doivent subir le marché. Et pour souligner l’apport fort notable de l’atomicité des centres de décision dans un marché concurrentiel, François PERROUX l’avait souligné pertinemment en ces termes : « Il faut que chaque acheteur soit comme une goutte d’eau dans l’océan des acheteurs et que chaque vendeur comme une goutte d’eau dans l’océan des vendeurs »[20].
Par contre, il y a homogénéité des produits sur le marché lorsque les produits (sans jeu de mots) par les firmes sont homogènes et ne comportent aucun signe d’identification des producteurs et sont vendus au même prix. Et il y a transparence du marché lorsque les offreurs et les demandeurs ont connaissance des conditions de prix appliquées sur le marché ainsi que des quantités de produits disponibles et de leurs caractéristiques[21].
Enfin, il y a fluidité parfaite de l’offre et de la demande lorsque les nombreux opérateurs économiques sont libres d’entrer dans un marché économique des biens et des services et d’y sortir librement et à n’importe quel moment. Bref, les opérateurs économiques sont mobiles sur le marché.
C. La concurrence déloyale
Elle est définie comme le recours aux procédés contraires à la loi et aux usages de commerce de nature à causer un préjudice ou simplement un trouble commercial aux concurrents[22]. Pour Gérard CORNU, c’est un fait constitutif d’une faute qui résulte d’un usage excessif, par un concurrent, de la libre concurrence, dans la recherche de la clientèle, dans la compétition économique. C’est le cas, par exemple, poursuit-il, de la confusion volontairement créée entre deux marques, notamment au moyen de la publicité, imitation des produits d’un concurrent, désorganisation de l’entreprise rivale, parasitisme, dumping, dénigrement[23].
Par contre, pour Alain BITSAMANA[24], il s’agit d’un détournement fautif de la clientèle d’un commerçant, par des procédés illégaux ou malhonnêtes, et lui causant un préjudice[25]. Pour nous, la concurrence est déloyale lorsqu’il y a détournement de la clientèle d’un concurrent par l’usage des procédés illégaux tels que le dénigrement, la confusion volontairement créée entre deux marques, la publicité mensongère, l’imitation des produits d’un concurrent, le parasitisme, la désorganisation de l’entreprise rivale, le dumping,… pour autant que ce détournement de la clientèle ait causé un préjudice à celui pour qui le détournement de la clientèle a été effectuée.
En résumé, la concurrence déloyale comprend certains éléments de la concurrence parfaite et en manque d’autres. Elle est autrement appelée concurrence imparfaite ou impure et se décline en deux, dont notamment la concurrence impure monopolistique et la concurrence impure oligopolistique.
1. La concurrence impure monopolistique
Elle comprend le monopole et le monopsone
Est une structure du marché caractérisé par la présence d’un seul producteur ou offreur avec comme conséquence ; le monopoleur peut provoquer la hausse de prix sur le marché : le marché est fermé et il a la maîtrise du prix et de la production (monopole pur). Il peut en outre vendre à chaque demandeur le même article mais à des prix différents. Enfin, il peut fixer le prix par catégorie d’acheteurs (le monopole discriminatoire)[26].
Cependant, il existe des cas où le monopole est autorisé par les pouvoirs publics sur un marché. Autrement dit, une firme ou une société commerciale ou même une entreprise publique peut obtenir l’aval de l’administration publique pour exercer le monopole sur un marché. Donc, nous nous trouvons alors dans deux situations dont d’une part, le monopole de fait et de l’autre pat, le monopole légal.
En effet, le monopole de fait est la situation économique dans laquelle le jeu de la libre concurrence n’existe pas en raison de l’extrême puissance d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises qui domine et dicte ses conditions sur le marché[27]. Au rebours, le monopole légal est le droit exclusif d’exploitation d’un service, d’un produit ou d’un titre établi en vertu d’une loi[28].
Cette situation de monopole légal a existé en RDC avec l’ordonnance-loi n° 67/240 du 02 juin 1967 octroyant le monopole des assurances à la Société Nationale des Assurances, en sigle SONAS. Cette situation a persisté dans le pays pendant bien des années ; c’est avec la promulgation en 2015 de la loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances que le secteur des assurances a été libéralisé et la Société Nationale d’Assurances ne détient plus son monopole sur le secteur des assurances.
C’est une structure du marché qui ne comprend qu’un seul acheteur et concerne généralement le marché des facteurs. Cependant, le marché dans lequel cohabitent un seul acheteur et un seul vendeur est un monopole bilatéral[29].
2. La concurrence imparfaite oligopolistique
Structure du marché dans laquelle opère un nombre réduit d’entreprises dont les affaires sont interdépendantes. Elle comprend l’oligopole et l’oligopsone.
L’article 34 de la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 dispose : « La propriété privée est sacrée. L’État garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume. Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. Nul ne peut être saisi en ses biens qu’en vertu d’une décision prise par une autorité judiciaire compétente ». Pour l’article 35 d’en ajouter : « L’État garantit le droit à l’initiative privée tant aux nationaux qu’aux étrangers. Il encourage l’exercice du petit commerce, de l’art et de l’artisanat par les Congolais et veille à la protection et à la promotion de l’expertise et des compétences nationales. La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit. ».
Ces deux articles énoncent le principe de la liberté de commerce et de l’industrie qui a donné naissance, hormis ses corollaires, à plusieurs autres principes dont, parmi eux, citons la libre concurrence (Paragraphe 1) qui, à son tour, a donné naissance aux clauses de non-concurrence (Paragraphe 2).
§1. De la libre concurrence, la liberté de commerce et de l’industrie
La libre concurrence, la liberté de commerce et de l’industrie sont des principes fondamentaux en droit comme nous l’avions ci-haut souligné tant au niveau national qu’au niveau communautaire. Certes, en droit congolais, la libre concurrence est garantie par la Constitution qui reconnait le droit à la libre entreprise. Cela signifie que les entreprises peuvent exercer leurs activités sur le marché dans le respect des règles de la concurrence. En outre, la liberté de commerce et de l’industrie est également consacrée en droit congolais dans le but de permettre aux individus de créer, d’exercer et de développer des activités économiques dans les limites définies par la loi. C’est ainsi qu’après un bref aperçu sur les notions (A), place sera faite à l’analyse du principe de la liberté de commerce et de l’industrie (B) pour chuter avec celui de la libre concurrence (C).
A. Notions
L’exercice de l’activité commerciale veut que tout opérateur économique mette en place des moyens et stratégies pour s’attirer le plus grand nombre de clients. Cependant, malgré le libre choix lui laissé, il lui est aussi imposé des limites à ne pas franchir. Le commerçant est tenu de se conformer à certaines exigences au cas où il ne veut pas se voir contraindre de se défendre devant les cours et tribunaux. À côté du principe de la liberté de commerce existe celui d’exercer ledit commerce en respectant ses usages.
Le commerçant est appelé à exercer son activité en toute honnêteté et loyauté envers ses concurrents[30]. Comme dans un ring de boxe, il est permis de se donner des coups sauf que ceux-ci doivent être conformes aux règles du jeu. C’est aussi le cas avec les commerçants qui, faut-il le dire, sont des concurrents sur le marché. Cette concurrence doit demeurer loyale entre les opérateurs économiques. Au cas contraire, il s’agira alors de ce qui est interdit et même réprimé, à savoir la concurrence déloyale.
B. De la liberté de commerce et de l’industrie
Ce principe de portée constitutionnelle, soit-il, a été consacré par l’acte de Berlin du 26 février 1885 et par la plupart des lois fondamentales qu’a connues la République Démocratique du Congo. La Constitution du 1er août 1969 s’est préoccupée de la liberté de commerce et de l’industrie. Elle disposait en son article 44 que l’exercice du commerce est garanti à tous les Congolais sur le territoire dans les conditions fixées par la loi. La circulation des biens est libre sur toute l’étendue de la République.
La garantie susvisée a été confirmée par la constitution du 24 juin 1967. Son article 24 indiquait que l’exercice de l’art, du commerce et de l’industrie ainsi que la libre circulation des biens sont garantis sur toute l’étendue de la République dans les conditions fixées par la loi. La loi n° 012 du 15 novembre 1980 portant révision de la Constitution de 1967 a maintenu la liberté de l’industrie et du commerce. Quoi dire de la constitution du 18 février 2006 qui fait de la liberté de commerce et de l’industrie son cheval de batail en lui consacrant deux articles dont les articles 34 et 35 sus-évoqués.
Cependant, la liberté de commerce et de l’industrie fonde plusieurs principes dont notamment :
- La liberté d’entreprendre : Ou la liberté de choix qui renvoi aux libertés d’accès, d’exercice, d’établissement et de contracter. Elle signifie que toute personne est libre d’exercer une activité de son choix et, par-dessus tout, dans le respect de la loi.
- La liberté d’exploitation : Toute personne est libre de déterminer la politique de son exploitation tout en se conformant aux prescriptions de la loi. Il peut s’agir soit de la production, soit de la consommation, soit encore de la distribution[31]
C. La libre concurrence
Fille du principe de la liberté de commerce et de l’industrie, la libre concurrence gouverne la vie des affaires. Cette théorie signifie que chaque opérateur économique est libre d’attirer et de conserver la clientèle, le dommage en résultant pour un concurrent malheureux étant illicite[32]. Le postulat qui fonde cette théorie est qu’en se concurrençant, les entreprises devraient fournir le meilleur produit au meilleur prix avec comme avantage :
- Les demandeurs (les consommateurs) ont la possibilité de faire librement le choix entre les différents produits offerts sur le marché à des prix concurrentiels ;
- Les offreurs (les vendeurs) améliorent continuellement leurs produits et services pour être compétitifs sur le marché ;
- La concurrence obligeant les gens à agir rationnellement, l’offre s’adapte à la demande.
Analysant la loi sous examen, son article 4 alinéas 2 et 3, dispose : « la liberté de concurrence implique le droit pour toute personne d’exercer une activité économique ou commerciale de son choix aux conditions qu’elle juge compétitives, qu’elle fixe librement sous réserve des restrictions légales. Son exercice ne doit porter atteinte ni à la protection de la propriété industrielle et intellectuelle, ni aux droits légitimes des tiers ». Par-là, le législateur ne fait pas de distinguo entre la liberté de la concurrence avec la liberté de commerce et de l’industrie. Il estime que, comme pour cette dernière (la liberté de commerce et de l’industrie), la libre concurrence fonde la liberté d’entreprendre et la liberté d’exploitation. Le législateur met également des restrictions, voire des limites à l’exercice de cette liberté par le concurrent.
Il convient d’analyser, dans ce paragraphe, les notions générales de la clause de non-concurrence, ses conditions de validité, ainsi que sa portée.
A. Notions
Une clause de non-concurrence prévue par les dispositions du code du travail en ses articles 53 et suivants peut être insérée dans un contrat de travail aux fins d’éviter qu’à la fin de la relation de travail entre le salarié et son employeur, le premier (le salarié) ne concurrence pas son ancien employeur. Il peut être également être inséré dans n’importe quel contrat commercial tel que dans la location-gérance[33], dans le contrat d’entreprise (la sous-traitance)[34], dans le contrat de franchise[35], etc.
Par définition, la clause de non-concurrence est celle par laquelle le salarié s’interdit lors de son départ de l’entreprise et pendant un certain temps par la suite d’exercer certaines activités susceptibles de nuire à son ancien employeur. C’est aussi une disposition interdisant au travailleur, après la fin du contrat, d’exploiter une entreprise personnelle, de s’associer en vue d’exploiter une entreprise ou de s’engager chez d’autres employeurs exerçant la même activité que son ancien employeur. C’est encore une disposition insérée dans un contrat commercial par laquelle une partie à ce contrat s’interdit d’exercer une activité professionnelle semblable à celle pratiquée par l’autre partie.
À titre illustratif Mme. Odette MWANGA signe un contrat de travail avec la société Vodacom Congo pour travailler comme directrice du service de marketing. Dans leur contrat, une clause de non-concurrence est insérée par la société en question. Clause selon quoi : « […] pendant la durée du contrat et deux ans au-delà, l’employé devra s’abstenir de conclure un autre contrat de travail avec une autre société de télécommunication basée en République Démocratique du Congo, dans les conditions reprises dans le présent contrat […] ». À la cessation de ce contrat, Mme. Odette ne pourra, pendant une durée de deux ans comme stipulé dans leur contrat, conclure un autre contrat de travail avec une autre société de télécommunications basée en République démocratique du Congo et, de surcroît, à un poste de responsable marketing de la société, sauf dans l’hypothèse d’un éventuel contrat conclu hors du champ d’intervention de cette clause.
La clause de non-concurrence est une disposition interdisant au travailleur, après la fin du contrat, d’exploiter une entreprise personnelle, de s’associer en vue d’exploiter une entreprise ou de s’engager chez d’autres employeurs exerçant la même activité que son ancien employeur[36].
B. Conditions de Validité
La clause de non-concurrence n’est valable que sous certaines conditions précises que sont les conditions de forme et les conditions de fond.
1. Les conditions de forme
La clause de non-concurrence ne se présume pas ; elle doit obligatoirement être rédigée par un écrit, c’est-à-dire contenue ou stipulée dans le contrat. Cette obligation est faite par le législateur pour protéger les deux parties au contrat. L’entreprise ou l’employeur, pour prouver éventuellement que son ancien employé était soumis à une clause de non-concurrence qui l’empêcherait de conclure avec ses concurrents et pour en bénéficier les avantages qui en découleraient. L’employé, pour soutenir ses allégations selon lesquelles il ne serait point soumis à une telle clause, d’où, pourrait-il conclure avec une personne de son choix en toute quiétude.
Cependant, le cocontractant qui avait préalablement consenti à l’insertion de la clause de non concurrence dans le contrat qui le lie avec son employeur ne peut, par la suite, en invoquer l’ignorance de ladite clause car, dit-on, il n’est pas porté atteinte à celui qui consent en connaissance de cause (semper in obscuris quod minimum est sequimur)[37]. Au rebours, la clause sera entachée de nullité lorsque l’employé n’avait pas pris connaissance d’une telle clause lors de la conclusion du contrat qui le liait avec son ancienne entreprise ou, pour mieux dire, son ancien employeur, car, ajoute-t-on, il n’y a pas, à coup-sûr, d’acte volontaire au regard de ce qui n’était connu au préalable (nihil volitum quod non praecegnitum).
2. Les conditions de fond
Les conditions de fond se résument à la suite :
- Il faut que le salarié ait été licencié pour faute lourde ou qu’il ait démissionné sans faute lourde de la part de son employeur ;
- Les intérêts légitimes de l’entreprise : l’employeur doit prouver ou signaler que la personne occupe un poste notable dans l’entreprise ou la compagnie avec comme conséquence que si le travailleur arrivait à contracter avec un concurrent, les intérêts de l’entreprise seraient, à cet égard, préjudiciés ;
- La spécificité de l’emploi ;
- La limitation dans le temps et dans l’espace : les durées des clauses de non-concurrence sont de deux (2) ans et celles-ci (les clauses) doivent prévoir, le plus souvent, une zone géographiquement limitée au territoire d’une ville ou d’une région ;
- L’indemnité de non-concurrence : la clause de non-concurrence est nulle dès lors qu’elle ne prévoit aucune contrepartie financière versée au salarié.
C. La portée de la clause de non-concurrence
L’intérêt d’une telle clause est donc, comme nous venons de le constater, d’empêcher le salarié de concurrencer son ancien employeur après son départ de l’entreprise. Cependant, l’absence de la clause de non-concurrence renvoie au principe de la liberté contractuelle et aussi au principe de la liberté de commerce et de l’industrie (voir supra) qui sera mis en application. En cas de non-respect de la clause de non-concurrence, le salarié perd son droit à l’indemnité compensatoire éventuellement prévue et en doit donc un remboursement. Il convient toutefois de préciser que la clause de non-concurrence n’est explicitement pas réglementée dans OHADA. Cependant, la clause de non-concurrence est très présente en droit des affaires[38].
En droit commercial, par exemple, nous remarquons souvent certains contrats tels que le contrat de distribution, l’intermédiaire commercial, la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, le contrat de commission, le contrat de cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions. De manière implicite, l’article 218 de l’ADCG dispose : « l’agent commercial peut accepter sans autorisation, et sauf stipulation contraire, de représenter d’autres mandants. Il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans l’accord écrit de ce dernier[39]. Et pour l’article 219 en ajouter « l’agent commercial ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les informations qui lui ont été communiquées par le mandant à titre confidentiel, ou dont il a eu connaissance à ce titre en raison du contrat. Lorsqu’une interdiction de concurrence a été convenue entre l’agent commercial et son mandant, l’agent a droit à l’expiration du contrat à une indemnité spéciale[40]».
En termes de conclusion partielle à ce deuxième chapitre de nos recherches, disons avec ROCKFELLER que « seul un concurrent mort n’est pas dangereux »[41] ; comme pour dire que les opérateurs économiques, en particulier les firmes, sont logiquement tentés d’éliminer leurs concurrents pour avoir le monopole du marché. Ce processus peut alors conduire à la commission d’actes de déloyauté ou à des pratiques restrictives de la concurrence qui sont, d’ailleurs, en elles-mêmes sanctionnées comme infractions à la législation en matière commerciale et économique. En clair, sur un marché économique, les opérateurs économiques sont libres d’user de tous les moyens pour attirer et conserver une clientèle, à condition que les moyens empruntés ne soient pas contraires à la loi et aux usages honnêtes dans le commerce. Voilà en quoi consiste l’importance du droit de la concurrence sur ce marché.
Ainsi donc, les lignes précédentes nous ont permis d’analyser certains éléments qui ont fait l’objet de la concurrence commerciale. La question relative à l’aperçu des notions générales sur la concurrence et des principes de base de la concurrence commerciale n’est pas d’invention contemporaine, d’où la nécessité de développer dans les lignes qui suivent le droit de la concurrence commerciale en droit OHADA à l’ère du numérique.
CHAPITRE II. DROIT DE LA CONCURRENCE COMMERCIALE EN DROIT OHADA À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Chacun de nous peut constater au quotidien la connexion toujours plus importante de la société dans laquelle nous vivons et la digitalisation des relations, aussi bien personnelles que professionnelles ou commerciales. Nous éprouvons le besoin d’avoir accès à l’information en permanence et de pouvoir tout faire à distance, au moyen de nouvelles interfaces miniaturisées devenues essentielles : faire ses courses, commander un taxi, réserver un billet d’avion, un hôtel ou une place de concert, etc. Le smartphone est ainsi couramment comparé à une extension de l’individu, aussi bien physique que psychologique, avec les dérives médicales que l’on commence à constater et à étudier sous le nom de nomophobie[42].
En effet, l’émergence combinée des technologies numériques et de l’information, ainsi que d’un réseau mondialisé, Internet, a entraîné une multiplication de la collecte, du traitement et des échanges de données. En parallèle, se sont naturellement développés de nouveaux modèles économiques où la donnée et l’information ont une valeur primordiale.
Les grands acteurs, les grands gagnants, peut-on dire, de cette évolution sont principalement issus de deux (2) sociétés technologiques américaines, ce qui n’est d’ailleurs pas sans poser des risques de dépendance, voire de perte de souveraineté.Dans ce cadre, l’étude des énigmes de l’absence de règles harmonisées de la concurrence dans la zone OHADA (Section 1) est primordiale afin de poser le soubassement de nos critiques dans une perspective de donner quelques pistes de solution (section 2).
SECTION 1. DES ENIGMES DE L’ABSENCE DES RÈGLES HARMONISÉES DE LA CONCURRENCE COMMERCIALE DANS LA ZONE OHADA
En Afrique, plusieurs organisations régionales d’intégration économique et juridique ont, d’ores et déjà, adopté ou harmonisé le droit de la concurrence dans leurs espaces. Par contre, le Droit OHADA tarde toujours à emboîter les pas dans l’harmonisation du Droit de la concurrence dans sa zone. C’est pourquoi, après avoir constaté cette absence d’une réglementation harmonisée relative à la concurrence commerciale dans l’espace OHADA en abordant les généralités et les causes de cette absence (paragraphe 1), nous tâcherons d’analyser ensuite les causes (paragraphe 2).
§1. Généralités
À coup sûr, l’OHADA, dans son processus d’unification du droit des affaires de ses États membres, s’est fixé comme credo l’harmonisation du droit des affaires dans les États-parties par la mise en place d’un Droit commun, simple, moderne et adapté à la situation de leurs économies, par la mise en œuvre de procédures judiciaires appropriés, et par l’encouragement au recours à l’arbitrage pour le règlement des différends contractuels ; dans l’optique d’attirer les investisseurs[43].
À en croire le terminus de l’article 2 du traité OHADA, nous sommes d’avis que le législateur communautaire a ouvert une brèche au Conseil des Ministres en lui laissant le soin de déterminer les matières entrant dans le champ d’application du Droit des affaires en-dehors de celles citées, pour autant que ce soit dans le strict respect du champ d’application dudit traité.
C’est pourquoi nous pouvons aisément le constater : les politiques régionales de la concurrence sont aujourd’hui légion dans les pays en développement. Dans ce contexte de surabondance de politiques régionales de la concurrence, il peut paraître curieux que l’OHADA n’ait pas encore légiféré en matière de concurrence.
À ce que nous sachions, le Conseil des ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires qui s’est tenu les 22 et 23 mars 2001 à Bangui en République centrafricaine (RCA) a laissé entendre que d’autres harmonisations seraient à envisager notamment dans le domaine du droit de la concurrence[44]. Le 24 novembre 2006, un avant-projet d’acte uniforme relatif au droit du travail fut élaboré à Douala dans la République du Cameroun mais aucun avant-projet d’acte uniforme n’est déjà adopté dans le domaine du droit de la concurrence.
C’est pourquoi nous affirmons, et sans peur d’en être contredits, qu’il existe une disharmonie dans l’espace OHADA en ce qui concerne la réglementation de la concurrence. Cette disharmonie nous pousse à croire que cette organisation n’a pas encore atteint son point culminant ou son point saillant en ce qui concerne la réalisation de son objectif d’harmonisation du droit des affaires dans son espace. De plus, nous pouvons constater que comme il n’y a point d’harmonisation du Droit de la concurrence dans l’espace OHADA, il n’y a donc pas amélioration du climat des affaires ; d’où, l’insécurité juridique en ce qui concerne la règlementation de la concurrence commerciale continue à élire domicile dans la zone OHADA. Or, une harmonie dans la réglementation de la concurrence dans la zone OHADA pourrait avoir un impact sur les géants de la technologie (A) quand bien même ceux-ci transgressent les frontières Etatiques ce qui permettra une bonne régulation et contrôle des géants de la technologie (B).
A. Impact du droit de la concurrence sur les géants de la technologie
Le droit de la concurrence permet une compétence territoriale liée aux effets sur le marché, indépendamment de la localisation géographique de l’acteur économique, ce qui lui donne un avantage fort comparé à une régulation ex ante[45]. Néanmoins, on se rend compte que l’économie numérique, et d’autant plus lorsque celle-ci touche au Big Data, à la collecte, au traitement et à l’usage des données, s’exerce sur un marché mondialisé. On peut ainsi se demander si les lois nationales constituent le bon échelon de régulation[46], et s’il ne vaudrait pas mieux que les instances internationales se saisissent plus généralement de ces affaires.
Par conséquent, l’innovation permanente à l’œuvre dans l’économie numérique rend nécessairement complexe une régulation ex ante[47]. C’est d’autant plus vrai dans le cas de ruptures technologiques qui sont bien entendu non anticipables par le régulateur. La rapidité avec laquelle une idée se développe sur un marché économique, en jouant sur la mise en relation d’usagers au moyen des nouvelles technologies, est peu compatible avec les processus de régulation conventionnels et semble quasiment impossible à encadrer, sans risque d’entraver fortement l’innovation. Tel est le cas notamment de la domination des GAFA à l’encontre d’une concurrence saine, du développement des plateformes.
Le Monde titrait le 30 août 2017[48] que les GAFA seraient les premières sociétés à dépasser le seuil de mille milliards de capitalisation, mettant un coup de projecteur de plus à un secteur qui n’en manque pas, et affichant une nouvelle fois la domination économique certaine de ces nouveaux géants. À titre de comparaison, ce montant équivaut au PIB du Mexique en 2016, 15e puissance économique mondiale[49]. Cette domination soulève des questions de respect de la vie privée, d’accès aux données personnelles et de droit du travail pour ne citer que quelques domaines. Comme on peut le voir, les problématiques liées au développement des sociétés numériques sont vastes et leur hégémonie peut rapidement devenir inquiétante. Cette tendance monopolistique naturelle induit une concentration certaine des marchés, préjudiciable en premier lieu à une concurrence forte et saine.
- Le développement des plates-formes
Les plates-formes, de part une exigence formulée dans la directive 2000/31/CE, et à l’exception de celles relevant des secteurs du financement participatif de type crowdfunding « ne peuvent en l’état du droit communautaire être tenues comme juridiquement responsable des dommages causés aux consommateurs ou au vendeur non professionnel »[50] en vertu de l’article 15 de cette directive, que ce soit aussi bien en cas de contenu erroné ou en cas d’inexécution de l’obligation entre deux particuliers. Elles agissent pour ainsi dire qu’en simple intermédiaire mettant en contact différents acteurs, et s’exonèrent ainsi des responsabilités et contraintes qu’elles pourraient avoir en étant partie au contrat. Cette directive, et la liberté qu’elle a accordé aux plates-formes, explique en partie leur important développement.
B. Régulation et contrôle des géants de la technologie
Face à cette prise de pouvoir qui semble implacable, le premier contre-pouvoir juridique reste le droit de la concurrence. Le contrôle qu’il exerce sur les concentrations et les activités restrictives de concurrence doit permettre de maintenir un marché sain et concurrentiel au bénéfice des consommateurs, en tout cas selon les missions qui lui sont dévolues en Europe.
Néanmoins, on constate que le droit de la concurrence n’est pas très largement appliqué au secteur numérique, et qu’il n’a pas su enrayer l’hégémonie de groupes comme Google ou Apple. Si les apports des sociétés numériques sont indéniables, et que la domination qu’elles exercent est notamment le fruit d’une intense innovation et de gros investissements de recherche, il est étonnant de constater le peu d’actions menées à leur encontre, aussi bien juridiques que politiques, comparativement à la place qu’ont su prendre ces sociétés dans nos vies quotidiennes[51].
C. Mécanisme d’enquête et de suivi des pratiques des géants de la technologie
Il semble nécessaire de muscler le pouvoir de sanction des autorités en matière d’abus de position dominante. En effet, plusieurs exemples historiques mettent à mal la crédibilité de l’effet dissuasif des sanctions. Si l’adaptation de la législation antitrust aux défis du numérique est un préalable, elle ne saurait combler qu’une partie des lacunes du système anticoncurrentiel. Il convient, en effet, de s’intéresser également à la manière dont le droit est interprété et appliqué.
En effet, la bonne mise en application du droit anticoncurrentiel nécessite des analyses approfondies et complexes, impliquant souvent des études techniques poussées liées aux industries concernées. La révolution numérique et son usage intensif de technologies informatiques nouvelles, de données de masse ou encore de protocoles d’échanges novateurs mettent en difficulté l’expertise des autorités antitrust, plus habituées à gérer des problématiques juridiques ou administratives que techniques. Trois exemples viennent illustrer cela.
Dans les conclusions de son enquête avalisant l’acquisition d’Instagram par Facebook en 2012, l’Office of Fair Trading (OFT), l’autorité britannique de concurrence, a pris soin de préciser qu’Instagram, en tant que simple application d’édition de photographies, présentait très peu de fonctionnalités et de propriétés propres aux réseaux sociaux, et s’avérait de fait peu susceptible de pouvoir un jour concurrencer Facebook. Le niveau de mauvaise information et l’ampleur de l’incompréhension du fonctionnement des réseaux sociaux qui transparaissent dans ces propos laissent penser que l’autorité administrative a manqué de compétences nécessaires pour mener à bien son étude. Dans ce contexte, il est donc nécessaire pour mener à bien une enquête et le suivi des pratiques des géants de la technologie, d’abord avoir une information et ensuite d’être outillé techniquement à défaut faire recours à une expertise externe afin de mieux rendre la décision.
§2. Les causes de l’absence
Le droit de la concurrence pris dans son sens le plus générique servant à réguler le marché économique et l’équilibre social des opérateurs économiques. Par conséquent, il sert de béquille dans le but d’assurer la sécurité juridique qui, du reste, est la mission que s’est assignée l’organisation d’intégration économique (OHADA). En effet, au regard des éléments ci-haut décortiqués, plusieurs faits pourraient donc justifier l’absence d’une réglementation harmonisée relative à la concurrence commerciale dans l’espace OHADA. Au nombre de ceux-ci (des faits justificatifs), nous n’avons retenu que trois, dont notamment l’intime conviction du Conseil des ministres de l’OHADA (A), l’existence inconditionnelle des règles de la concurrence commerciale interne (B) et enfin la préexistence des règles relatives au droit de la concurrence adoptées (C).
A. L’intime conviction du Conseil des ministres de l’OHADA
La concurrence est à l’origine une notion plus économique que juridique. Et peut-être définie comme le rapport entre des entreprises, généralement commerciales, qui se disputent la clientèle, chacune visant à en attirer et conserver le plus grand nombre. Un autre auteur la définit aussi comme une situation du marché dans laquelle il existe une compétition entre vendeurs et acheteurs. Cette compétition peut porter sur les prix, les parts du marché, etc[52]. Cependant, le droit de la concurrence est entendu comme l’ensemble des règles qui s’appliquent aux entreprises dans leur activité sur le marché et qui sont destinées à réguler la compétition à laquelle elles se livrent. De plus, le droit de la concurrence s’applique aux entreprises commerciales et non commerciales comme les artisans, les sociétés civiles et les membres des professions libérales. Les entreprises publiques sont soumises aux règles de concurrence dès lors qu’elles exercent une activité économique dans les mêmes conditions que les entreprises privées.
Ainsi, au regard des lignes qui précèdent, le Droit de la concurrence met en connivence les entreprises commerciales et non commerciales et même les entreprises publiques dès lors que ces dernières exercent une activité économique dans les mêmes conditions que les entreprises privées ; alors qu’il est évident que le Doit des affaires tire son existence de l’existence même des entreprises comme commerçants personnes morales. De plus, le droit de la concurrence tient son existence du fait de l’existence d’une activité économique où il y aurait par la suite une compétition économique. Ce qui nous pousse à conclure que nul ne saurait ignorer l’importance que nous devons accorder au droit de la concurrence pour parler du droit des affaires.
En outre, il ne fait l’ombre d’un moindre doute que le droit de la concurrence constitue un aspect crucial du droit des affaires. Et donc, nul ne saurait renier que le droit de la concurrence entre dans le champ d’application du droit des affaires tant et si bien que le droit de la concurrence vise à réguler les activités des entreprises tant commerciales que non commerciales sur le marché.
C’est pourquoi, nous ne sommes pas d’avis avec le Conseil des Ministres qui estimerait toujours en mal que le Droit de la concurrence ne fait pas partie du champ d’intervention du Droit des affaires OHADA. D’ailleurs, certaines autres communautés tant régionales que sous-régionales ayant la même vocation que l’OHADA ont déjà emboîté les pas en régulant la concurrence dans leurs espaces.
B. L’existence inconditionnelle des règles de la concurrence commerciale interne
En ce qui concerne le deuxième aspect que nous avons pu évoquer ci-haut qui est celui de l’existence inconditionnelle des règles de la concurrence commerciale internes ou propres à chacun des États-membres de cette organisation d’intégration juridique et économique, nous estimons que cela ne puisse pas être invoqué par le Conseil des Ministres de l’OHADA comme motif de ne pas harmoniser le Droit de la concurrence dans son espace car, il ne faut pas perdre de vue que l’OHADA se singularise en ce qui concerne son objectif puisque l’organisation a pour objectif premier l’harmonisation du droit des affaires dans ses pays membres, avec des législations uniques appelées « Actes Uniformes » applicables de manière identique dans tous les États-membres.
En clair, il l’existe dans les territoires de tous les États-membres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires des règles propres à ces États qui régissent la concurrence dans leurs territoires bien celles-ci soient désuètes sur les territoires d’autres États. Ce qui amènerait le Conseil des Ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires à ne pas légiférer sur cette matière pour éviter les conflits des lois et des juridictions.
Pour nous, l’existence inconditionnelle des règles de la concurrence commerciale internes ou propres à chacun des États membres de cette Organisation d’intégration juridique et économique ne saurait justifier l’absence d’adoption par le Conseil des ministres de l’OHADA d’une règle communautaire identique ou commune à tous les pays membres de cette communauté. Ceci est d’autant plus vrai puisse son objectif est d’harmoniser les règles relavant du champ d’application du Droit des affaires, préexistantes et devenues désuètes ou obsolètes dans les territoires de chacun des États ayant adhéré à son traité constitutif.
Par ailleurs, une ou deux questions méritent d’être soulevées sur ce point : certes le Droit de la concurrence relève bel et ben du Droit des affaires, mais, serait-il souhaitable de détacher la réglementation de la concurrence du niveau national et la confier à une autorité régionale ? Serait-il toujours souhaitable de transférer le contentieux de concurrence dévolu auparavant aux droits internes vers une autorité communautaire ? Ces deux questions paraissent à première vue anodines, mais elles nous poussent à donner une opinion selon laquelle la pluralité ou la diversité de règles devant régir la concurrence dans la zone OHADA ne fait que démontrer la disharmonie qui existe dans cet espace en ce qui concerne la réglementation de la concurrence.
C. La préexistence des règles relatives au droit de la concurrence adoptées
Enfin, pour ce qui est du troisième aspect par nous soulevé, aspect qui concerne la préexistence anodine des règles relatives au Droit de la concurrence adoptées dans le cadre des sous-communautés évoluant à l’intérieur du champ d’application du Droit issu de l’OHADA, nous estimons que malgré la spécificité de son objet d’intégration (le droit des affaires) et la diversité de ses acteurs, l’OHADA interagit avec d’autres organisations d’intégration dotées d’objectifs économiques, telles que l’UEMOA, la CEDEAO et la CEMAC. Ces différentes organisations, même si elles sont géographiquement séparées et que leur objet est spécifique, poursuivent des objectifs qui se chevauchent.
En outre, selon Mor BAKHOUM, l’OHADA n’opère pas en autarcie. Son espace, ses objectifs ainsi que son droit matériel, dans certains cas, se chevauchent avec ceux d’autres organisations d’intégration économique. C’est le cas de l’UEMOA, de la CEMAC et de la CEDEAO. Celles-ci ont déjà mis en place des politiques de la concurrence plus ou moins fonctionnelles[53].
En sus, les trois aspects tels que longuement démontrés par nous ci-dessus ne peuvent pas, d’après nos analyses, empêcher au Conseil des Ministres de l’OHADA de doter à cette organisation sous régionale sa propre règlementation de la concurrence. C’est pourquoi sa léthargie à harmoniser le droit de la concurrence dans son espace apporte des conséquences importantes sur l’amélioration du climat des affaires.
SECTION 2. CRITIQUE ET THERAPIE DE CHOC
Nous ne cesserons pas de rappeler ici que le droit de la concurrence constitue un aspect crucial du droit des affaires. Et donc, nul ne saurait renier que le droit de la concurrence entre dans le champ d’application du droit des affaires tant et si bien que le droit de la concurrence vise à réguler les activités des entreprises tant commerciales que non commerciales sur le marché. Il garantit en outre la libre confrontation entre opérateurs économiques et la liberté de commerce et de l’industrie. Son absence remarquée et cauchemardesque dans l’arsenal juridique de l’OHADA n’aurait qu’à apporter des conséquences néfastes sur l’amélioration du climat des affaires dans cet espace.
Ces conséquences sont notamment le désavantage de l’absence de la législation harmonisée devant régir la concurrence dans les territoires des États-parties au traité de Port-Louis (A) étant donné que la Technologie transperce les limites de la souveraineté étatique ; l’insécurité des investissements (B) ; d’où, l’insécurité juridique persiste dans l’espace OHADA et la désuétude de ces textes devant régir la concurrence(C).
A. Désavantage de l’absence de législation harmonisée face aux géants de la technologie
Il est clair que l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires a pour objectif d’harmoniser le droit des affaires dans son espace par la mise en œuvre d’un droit des affaires simple, adapté et commun à tous ses États membres. On retrouve aujourd’hui dans le secteur des nouvelles technologies tous les symptômes d’une diminution significative de l’intensité concurrentielle : une tendance à la concentration du marché (1) et les acquisitions (2).
1. Une tendance à la concentration
Un symptôme de désavantage qui découle de l’absence de la législation harmonisée se manifestant par la diminution de l’intensité concurrentielle réside dans la tendance marquée de consolidation qui prévaut depuis une décennie dans le secteur des nouvelles technologies. On constate en effet que la remarquable réussite des géants technologiques au cours des vingt dernières années s’est accompagnée de multiples acquisitions d’entreprises plus ou moins jeunes, opérant généralement sur des marchés adjacents. L’analyse des données extraites de la plateforme spécialisée Mergermarket[54] met en évidence une importante activité d’achats de firmes de la part des Big Tech, qui s’est intensifiée à partir de la fin des années 2010.
2. Les acquisitions
Les géants technologiques participent tous sans exception à la dynamique de consolidation du secteur, également documentée par une littérature académique fleurissante. En étudiant plus en détail ces transactions, on constate que les géants technologiques acquièrent très souvent de jeunes sociétés opérant sur des marchés similaires ou adjacents aux leurs. Ce modèle a notamment été initié par Google avec les acquisitions de YouTube (2006) et d’Android (2007), suivi par Amazon (2009), puis Facebook avec Instagram (2012)[55]. Cette consolidation s’opère également à un stade de développement plus avancé des firmes cibles. On pense par exemple au rachat de WhatsApp par Facebook en 2014.
B. L’insécurité des investissements
Dans l’espace OHADA, hormis l’aspect paix et sécurité dans un État, les investisseurs se trouvent beaucoup plus en sécurité sur le territoire d’un État que sur le territoire d’un autre État alors que tous les deux États sont membres d’une même communauté d’intégration juridique et économique qui poursuit l’amélioration du climat des affaires par l’harmonisation des règles de ses États-membres. Tout ceci, parce qu’il n’y a pas de texte juridique commun à tous les États parties au traité de Port-Louis qui doit le protéger contre les actes anticoncurrentiels ou contre la concurrence déloyale.
Les géants technologiques présentent, en effet, des ratios d’investissement cinq à six fois supérieurs à ceux des industries traditionnelles. La stratégie poursuivie est la même que celle guidant les investissements externes : tandis qu’ils allouent une partie de leur R&D à leur cœur de métier, les Big Tech maintiennent en parallèle des départements de recherche concentrés sur des verticaux totalement nouveaux. Citons comme exemple le laboratoire Google X qui a notamment travaillé sur la voiture autonome (Waymo) et la réalité augmentée (Google Glass), ou encore le défunt projet Aquila de Facebook développant un drone à énergie solaire[56]. Ainsi, les investissements en capital-risque participent donc à la forte consolidation du secteur des nouvelles technologies, déjà constatée avec les nombreuses acquisitions des Big Tech. Mais au-delà de la concentration des entreprises elles-mêmes, on remarque une concentration massive de la capacité d’innovation. Cette dernière est centralisée dans les mains d’un très faible nombre d’acteurs qui, par leurs dépenses, leurs prises de participation en capital-risque et leurs acquisitions de sociétés concurrentes ou en passe de l’être, s’assurent la mainmise sur les technologies et les marchés de demain[57].
C. La désuétude des textes juridiques devant régir la concurrence
Les textes juridiques qui régissent la concurrence sur les territoires de certains États membres d’une même communauté qu’est l’OHADA ne sont plus adaptés aux situations économiques qui les gouvernent. Ces textes longuement appliqués sur les territoires des États membres de l’OHADA n’ont pas évolué et ne sont plus adaptés aux situations actuelles des affaires. La plupart de ces textes ont été adoptés depuis le siècle précédent alors qu’actuellement le monde des affaires est devenu plus différent de celui de ce siècle.
En outre, les investisseurs se trouvent dans une situation d’incertitude permanente de l’issue d’une affaire judiciaire à laquelle ils se sont engagés lorsqu’ils se retrouvent dans un contentieux de concurrence par exemple où ils se voient butés à des obstacles causés par l’obsolescence des textes qui les gouvernent ; dans la mesure où les textes juridiques qui les régissent dans les territoires des États-membres d’une même communauté qu’est l’OHADA ne sont plus adaptés aux situations économiques qui les gouvernent.
Après avoir constaté que l’industrie des nouvelles technologies présentait des signes d’une diminution de son intensité concurrentielle, il reste à établir ce que laissent présager ces indices concordants, à savoir que les géants technologiques ont acquis des positions de domination et qu’ils s’en servent à présent pour entraver la concurrence qui, du reste est un champ libre aux entreprises sans frontière ; qui nécessite une thérapie afin de préserver l’équilibre sur le marché mondial en général et celui Africain en particulier.
§2. Thérapie de choc
Il paraît souhaitable de réfléchir à des moyens de réguler les activités qui se déploient autour du numérique, et notamment de déterminer la place que peut y prendre le droit de la concurrence. Si ce dernier a naturellement su évoluer au fil du temps, la rapidité mise en œuvre par l’économie numérique pose la question de son adaptation et de son évolution. On peut néanmoins préciser qu’il semble y avoir une prise en compte croissante des contraintes de l’économie numérique appliquées au droit de la concurrence. Il sied de retenir que nous, en notre qualité de jurisconsultes, proposons trois choses, dont notamment l’adoption d’un acte uniforme OHADA relatif au droit de la concurrence (A), adapté aux réalités du numérique (B) et enfin l’instauration d’une commission régionale de la concurrence de l’OHADA (C).
A. L’adoption d’un acte uniforme de l’OHADA relatif au droit de la concurrence
L’adoption d’un acte uniforme sur le droit de la concurrence participerait à la diffusion de la culture de la concurrence dans les pays membres de l’OHADA, qui se verraient tous dotés de législations en matière de concurrence. Toutefois, une chose est d’adopter une législation, une autre est de mettre en place des autorités compétentes pour les appliquer. L’opérationnalité d’une législation de la concurrence requiert des moyens dont les États membres de l’OHADA ne disposent pas[58], car, à l’ère du numérique où l’économie se caractérise par la mise en œuvre rapide de nouveaux business, mais aussi par leur évolution permanente, intrinsèquement liées à l’impératif d’être le premier sur le marché[59].
Ainsi adopté, ce nouvel Acte Uniforme devra comporter nécessairement (ou logiquement) les dispositions ci-après :
- Les dispositions générales : ces clauses seront relatives à l’objet de cet Acte Uniforme, à son champ d’application, aux différents principes de base de la concurrence commerciale, ainsi qu’aux différentes définitions ;
- Les dispositions relatives à la concurrence déloyale ;
- Les dispositions relatives aux pratiques restrictives de la concurrence ;
- Les dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles ;
- Les dispositions relatives à la concentration économique ;
- Les dispositions relatives à la Commission Régionale de la Concurrence ; et
- Les dispositions transitoires et finales.
B. Adapter la législation aux réalités du monde numérique
L’avènement de l’économie numérique doit nous amener à revoir en profondeur les modalités d’évaluation des positions dominantes et des fusions-acquisitions. En effet, nous avons vu qu’il est fréquent que les services proposés aux consommateurs soient gratuits ou s’échangent à des prix sans rapport avec les coûts réels engendrés car les modèles d’affaires des géants technologiques prennent en compte la perspective de gains indirects liés à l’utilisation de produits connexes ou bien de revenus engendrés par l’affichage publicitaire (selon l’adage désormais célèbre : « Si c’est gratuit, c’est que vous êtes le produit »). En conséquence, l’évaluation par l’autorité administrative d’une position dominante ou d’une concentration doit tenir compte de ces réalités. Cela signifie en pratique la possibilité de conduire des études ad hoc prenant en compte la structure multifacette des marchés, les effets de réseaux, l’interdépendance des services proposés au consommateur ou encore la nature et la quantité des données récoltées.
À cet égard, l’Allemagne a fait en 2017 un choix qui nous semble tout à fait pertinent : modifier sa loi antitrust pour mentionner spécifiquement ces subtilités. Aujourd’hui, les principes régissant la définition des marchés et segments de marché par la Commission européenne sont développés dans un texte qui n’a pas valeur de loi[60]. Afin d’écarter toute incertitude et de donner à la Commission européenne des pouvoirs de contrôle adéquats, nous proposons, sur le modèle allemand, d’inscrire les principes d’évaluation des positions dominantes dans l’acte uniforme en mentionnant expressément une liste de critères pertinents pour l’analyse des marchés numériques (effets de réseau, accès aux données, etc.).
Cette dernière suggestion est la conséquence logique des deux premières. Dès que le Conseil des ministres de l’OHADA prend l’initiative de légiférer sur le Droit de la concurrence, il va de soi qu’une Commission Régionale de la concurrence devra être installée dans le territoire de l’un des États membres de l’organisation car, dit-on, une politique régionale de la concurrence présuppose l’existence d’un cadre institutionnel apte à sa mise en œuvre. Une autorité régionale de la concurrence (comme c’est le cas avec la Commission européenne ou la Commission de l’UEMOA) est souvent en charge de son application.
Cette commission aura pour fondement les dispositions de l’Acte Uniforme tel qu’adopté par le Conseil des ministres, pour pallier les conséquences de l’absence d’une réglementation harmonisée relative à la concurrence commerciale.
En clair, la commission devra être dirigée par un coordonnateur à la concurrence, secondé par plusieurs fonctionnaires à la concurrence. Les fonctionnaires devront être nommés pour un mandat de six (6) ans par le Conseil des ministres alors que le coordonnateur, lui, devra être élu pour le même mandat par ses pairs (par les fonctionnaires à la concurrence).
Par rapport au fonctionnement de cette commission régionale de la concurrence, le Conseil des ministres devra adopter un système pyramidal des informations comme c’est le cas avec le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM). Cela voudrait dire (tout simplement) que comme dans la plupart des États-parties au traité de Port-Louis il y a des commissions nationales de la concurrence et dans d’autres, même des sous-commissions, les commissions nationales devront centraliser les informations recueillies par des sous-commissions et les envoyer par la suite à la commission régionale qui devra à son tour les analyser et accomplir ses missions.
CONCLUSION
Il serait certes difficile de conclure un thème qui nous a mené aux lisières d’un grand nombre d’hypothèses et de suggestions, lesquelles restent à coup sûr de vastes chantiers faits d’interrogations multiples et interminables ; fondamentalement parce qu’il ne peut être aisé d’arrêter le développement des études éventuelles susceptibles d’être menées par d’autres chercheurs dans le champ des réflexions que nous avons esquissées dans cet opus. La présente conclusion ne devrait, dès lors, logiquement être perçue que comme un simple essai.
Il paraît souhaitable de réfléchir à des moyens de réguler les activités qui se déploient autour du numérique, et notamment de déterminer la place que peut y prendre le droit de la concurrence. Si ce dernier a naturellement su évoluer au fil du temps, la rapidité mise en œuvre par l’économie numérique pose la question de son adaptation et de son évolution. On peut néanmoins préciser qu’il semble y avoir une prise en compte croissante des contraintes de l’économie numérique appliquées au droit de la concurrence, comme le montre l’organisation de séminaires, colloques et tables rondes de plus en plus nombreux sur le sujet, regroupant aussi bien des praticiens du droit que des autorités de concurrence ou des auteurs doctrinaux. L’essor de l’économie numérique, s’il a pu bénéficier en premier lieu au consommateur, ne s’est pas fait sans imposer une nouvelle concurrence aux acteurs traditionnels. Compte tenu des conséquences engendrées par ces nouveaux arrivants, diverses tentatives de régulation ont été initiées par les autorités. C’est pourquoi les modèles d’affaires développés par les sociétés du numérique réorganisent rapidement les marchés sur lesquels elles opèrent avec des conséquences fortes pour les acteurs en place. Cette nouvelle donne, avec une domination de plus en plus prégnante de ces nouveaux acteurs, n’est pas sans poser des questions de droit de la concurrence, et notamment d’abus.
Certes, en quelques années, ont émergé des géants du numérique surfant sur le développement d’Internet et formant de véritables conglomérats pour certains d’entre eux. Cette numérisation de l’économie s’est développée par vagues successives. Chacune de celles-ci a abouti à un business model original, même si certains facteurs, au premier rang desquels la maîtrise de la technologie numérique, sont partagés par tous les géants du numérique.
Les pratiques anticoncurrentielles des géants de la technologie montrent que ces entreprises n’hésitent plus à s’appuyer sur leurs positions dominantes pour évincer leurs concurrents, bloquer l’entrée de jeunes firmes innovantes et asseoir ainsi leur hégémonie aux dépens du reste de la société. Un cercle vicieux manifeste s’engage : leurs immenses réserves financières étudiées dans la première partie de cette note croissent à proportion de ces entraves concurrentielles en même temps qu’elles les facilitent. Derrière cet inquiétant tableau se révèle en creux l’incapacité chronique des autorités antitrust à agir dans un secteur où les modèles économiques défient leurs grilles d’analyse habituelles. Afin de recréer les conditions d’un environnement propice à l’innovation, un durcissement et une adaptation de la politique de concurrence sont nécessaires.
Cette transformation doit s’accompagner d’un renforcement des moyens et des compétences des autorités administratives, trop souvent dépassées par des pratiques anticoncurrentielles dont la technicité et la complexité ne font que croître. Enfin, des politiques proactives comme des mesures d’interopérabilité et d’ouverture des droits de propriété industrielle compléteraient utilement la démarche souvent réactive de l’antitrust. Trouver le juste équilibre entre la rémunération des innovateurs d’hier et le soutien aux innovateurs de demain demeure un exercice extrêmement délicat. Mais il est clair que le laxisme des autorités antitrust et la passivité des régulateurs mettent en péril l’entrée sur le marché de jeunes entreprises prometteuses. Il est urgent d’agir afin de ne pas laisser les anciens champions empêcher l’émergence des champions de demain.
Somme toute, l’objectif d’harmonisation du droit des affaires est la pierre angulaire du processus d’intégration dans le cadre de l’OHADA. Pour atteindre cet objectif, « le recours à la technique des règles matérielles pour harmoniser le droit des affaires dans l’espace OHADA a donné naissance aux actes uniformes » qui constituent une législation unique applicable de manière directe dans tous les États membres, sans aucune procédure supplémentaire de réception des actes uniformes dans les ordres juridiques nationaux. Elles supplantent toute législation nationale antérieure ou postérieure qui leur serait contraire, comme le précise l’article 10 du traité. Dans le cas d’espèce, une fois adoptées, les règles communes de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires vont supplanter toutes les dispositions antérieures des États membres qui leur seraient contraires.
Par M. Aubin BIDIMPATA, Juriste-Chercheur en droit bancaire et financier
[1] M. M. SALAH, La problématique du droit économique dans les pays du Sud, RIDE, n°2, 1998, p.168.
[2] Dans ce sens il est soutenu dans le préambule du Traité que : « la réalisation de ces objectifs suppose la mise en place dans les Etats membres, d’un droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté afin de faciliter l’activité des entreprises ». Dans la même mouvance, l’article 1er du Traité dispose : « Le présent Traité a pour objet l’harmonisation du droit des affaires dans les Etats parties par l’élaboration et l’adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies ».
[3] Mor BAKHOUM, Perspectives africaines d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA, dans Revue Internationale de Droit Economique, 2011, p.360.
[4] Victor KALUNGA TSHIKALA, Droit des affaires : de l’héritage colonial aux acquis de l’OHADA, Vol. 1, éd. CRESA, Lubumbashi, 2013.
[5] BAKHOUM M., « Perspectives africaines d’une politique de la concurrence dans l’espace OHADA », in Revue internationale de droit économique, N°2011/3, Louvain-La-Neuve, Belgique, novembre 2011.
[6] CAYOT M., MALO DEPINCE, et MAINGUY D., Droit de la concurrence, 3ième éd., coll. Manuels, éd. LexisNexis, Paris, 2019, 446p.
[7] Ibidem
[8] B.-E. HAWK, Op.cit., p.5.
[9] Philipe TIGER, Le droit des affaires en Afrique : OHADA, 3ème éd., PUF, Paris, 2001, p.14.
[10] Emmanuel COMBE, La politique de la concurrence, éd. La Découverte & Syros, Paris, 2002, p.6.
[11] Ibidem, p.6.
[12] Ibidem, p.7.
[13] À lire sur https://cours-de-droit.net/droit-de-la-concurrence-a121606626/, consulté le 27 mars 2024, à 16h20min.
[14] V. KALUNGA TSHIKALA, Op.cit., p.276.
[15] L’article 59 dispose : « Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission de la concurrence sont fixées par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du Ministre ayant l’Économie nationale dans ses attributions. »
[16] BESTONE A., Dictionnaires des sciences économiques, 2ième éd., Armand Colin, Paris, 2007, p.85.
[17] PICOTTE J., Juridictionnaire : recueil des difficultés et des ressources juridiques, éd. Université de Moncton, Moncton, 2018, p.1131.
[18] Ibidem
[19] DECOCQ A. et DECOCQ G., Droit de la concurrence, Droit interne et droit de l’Union européenne, 6ième éd., LGDJ, Paris, 2014, 443p.
[20] F. PERROUX et D. HENRI, Op.cit., p.21.
[21] BLAISE J.-B. et DESGORCES R., Droit des affaires : commerçants, concurrence, distribution, 8ème éd., LGDJ, Paris, 2017, 499p.
[22] Loi-organique n° 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence, Article 5, point 3, In JORDC, n° spécial, col. 105, du 23 juillet 2018.
[23] CORNU G., Vocabulaire juridique, 12ième éd., PUF, Paris, 2018, p.504.
[24] Hilarion Alain BITSAMANA, Dictionnaire OHADA, 3ème éd., L’Harmattan, Paris, 2015.
[25] HILARION BITSAMANA A., Dictionnaire de droit OHADA, OHADATA D-05-33, Pointe-Noire, 2003, p.49.
[26] Nicolas MALVERT, Le Droit de la concurrence à l’épreuve de l’économie numérique, Thèse, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 2016 – 2017, p.44.
[27] Article 5, point 7 de la loi organique n° 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence, In JORDC, n° spécial, col. 105, du 23 juillet 2018.
[28] Article 5, point 8 de la loi sus évoquée
[29] Jean MASIALA MUANDA VI, Fondamentaux du droit congolais de la concurrence (RDC), L’Harmattan, Paris, 2021, p.15.
[30] Jean MASIALA MUANDA VI, Op.cit., p.16.
[31] Marianne VILLEMONTEIX, Droit de la concurrence, 3ème éd., Gualino, Lextenso, Paris, 2022, p.19.
[32] MASAMBA MAKELA R., Guide pratique du droit des affaires en RDC, Kinshasa, 2009, p.90.
[33] L’article 138 alinéa 3 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant le Droit Commercial Général définit la locationgérance comme une convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, personne physique ou morale, en concède la location à un gérant, personne physique ou morale, qui l’exploite à ses risques et périls.
[34] La sous-traitance est l’activité ou l’opération effectuée par une entreprise dite sous-traitante, pour le compte d’une entreprise dite entreprise principale et qui concourt à la réalisation de l’activité principale de cette entreprise, ou à l’exécution d’une ou de plusieurs prestations d’un contrat de l’entreprise principale. Elle est régie par la loi n° 17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Cette loi contient des dispositions d’ordre public dont la violation est sanctionnée sur le plan civil et sur le plan pénal.
[35] La franchise (franchisage ou franchising) est un contrat par lequel un commerçant dit « le franchiseur », concède à un autre commerçant dit « le franchisé », le droit d’utiliser tout ou partie des droits incorporels lui appartenant contre le versement d’un pourcentage sur son chiffre d’affaires ou d’un pourcentage calculé sur ses bénéfices. Ce contrat porte généralement sur les droits de propriété industrielle tels qu’ils sont régis par les dispositions de la loi n°82-001 du 7/01/1982.
[36] À lire DJUMA ETIENNE G., La clause de non-concurrence face à la liberté contractuelle, disponible sur : https://www.village-justice.com/articles/clause-de-non-concurrence-face-liberte-contractuelle,35213.html consulté le 7 Avril 2024, à 14h26min.
[37] Marianne VILLEMONTEIX, Op.cit., p.20.
[38] Jean MASIALA MUANDA VI, Op.cit., p.21.
[39] Article 218 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général
[40] Article 219 du texte sus évoqué
[41] J. ROCKFELLER cité par COMBE E., Op.cit., p.50.
[42] Nicolas MALVERT, Op.cit., p.8.
[43] Voir article 1 du Traité de Québec du 17 octobre 2008 portant révision du traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 portant Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des Affaires.
[44] À retrouver en ligne sur : https://www.ohada.com, (consulté le 24 avril 2024 à 20h46min).
[45] Charlier BONATTI, Les pratiques liées à l’économie digitale : aspects de droit de la concurrence, AJCA, Dalloz, Paris, 2016, p.42.
[46] N. LENOIR, Le droit de la concurrence confrontée à l’économie du Big Data. AJCA, Dalloz, Paris, 2016, p.66.
[47] N. Lenoir, Op.cit. p.69.
[48] Victor FAGOT, Les GAFA lancés dans la course aux 1000 milliards de dollars de capitalisation. Lemonde.fr. Publié le 30/08/2017, consulté le 15/04/2024. http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/08/30/lesgafa-lances-dans-la-course-aux-1-000-milliards-de-dollars-de-capitalisation_5178484_3234.html
[49] Ibidem
[50] Enjeux et perspectives de la consommation collaborative – Rapport final. PIPAME. DGE, juin 2015. p.278.
[51] Ricardo AMARO, Les pratiques anticoncurrentielles des géants de l’Internet, dans L’effectivité du droit face à la puissance des géants de l’Internet, vol.2. Bibliothèque de l’IRJS – André Tunc, Tome 74, octobre 2016, Paris, pp. 61-63.
[52] BESTONE A. et alii, op. cit.
[53] BAKHOUM M., Op.cit., p.360.
[54] Jean-Michel DEBRAT, La politique européenne de développement : Une réponse à la mondialisation, juin 2009, p.12.
[55] Paul Adrien HYPOLITE et Antoine MICHON, Les géants du numérique (2) : un frein à l’innovation ?, dans Fondapol, Novembre 2018, p.15.
[56] Paul Adrien HYPOLITE et Antoine MICHON, Op.cit., p.17.
[57] Ibidem, p.18.
[58] Mor BAKHOUM, Op.cit., p.23.
[59] Nicolas MALVERT, Op.cit., p.45.
[60] Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, Journal officiel de l’Union, 9 décembre 1997 disponible sur http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?