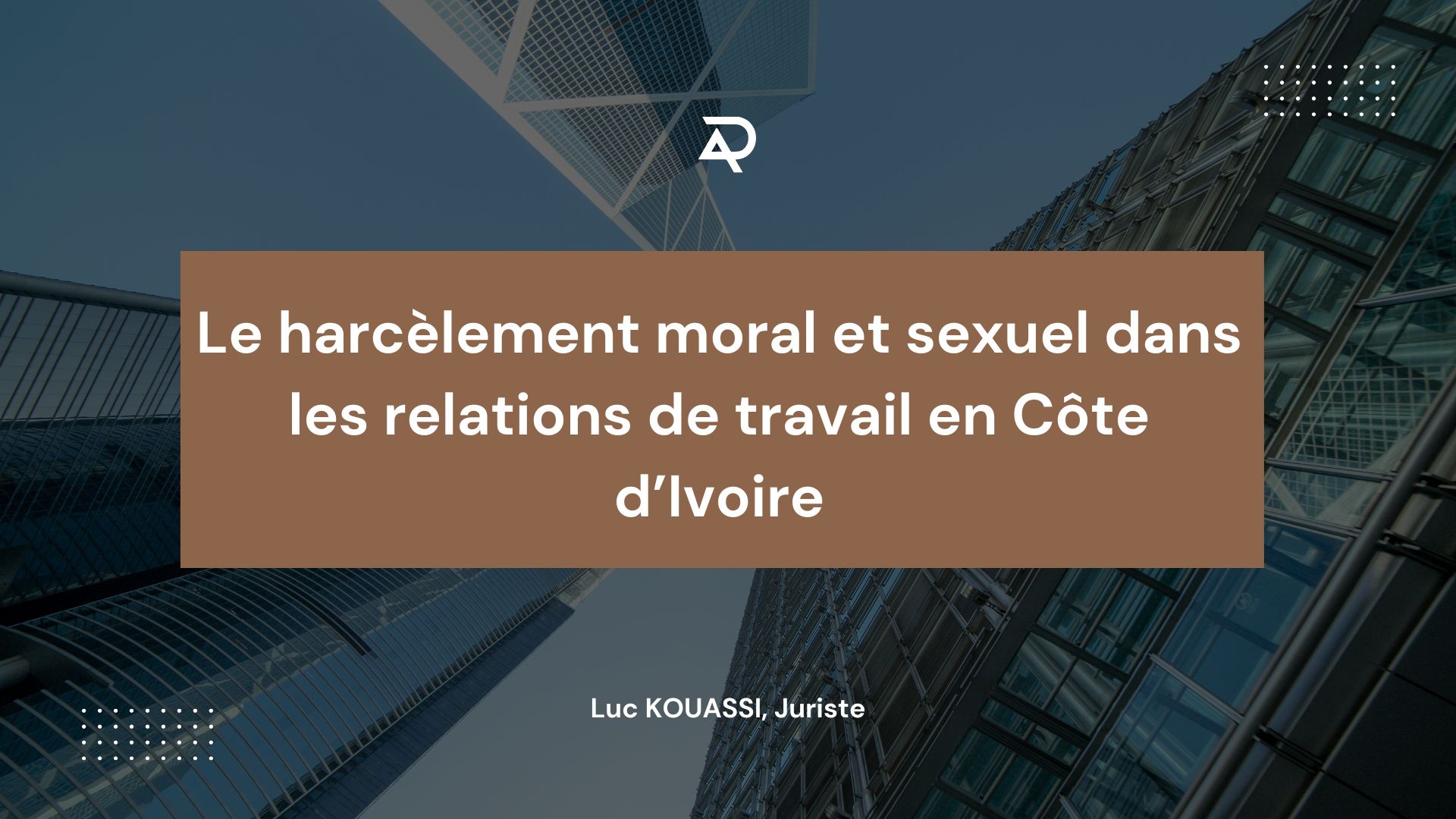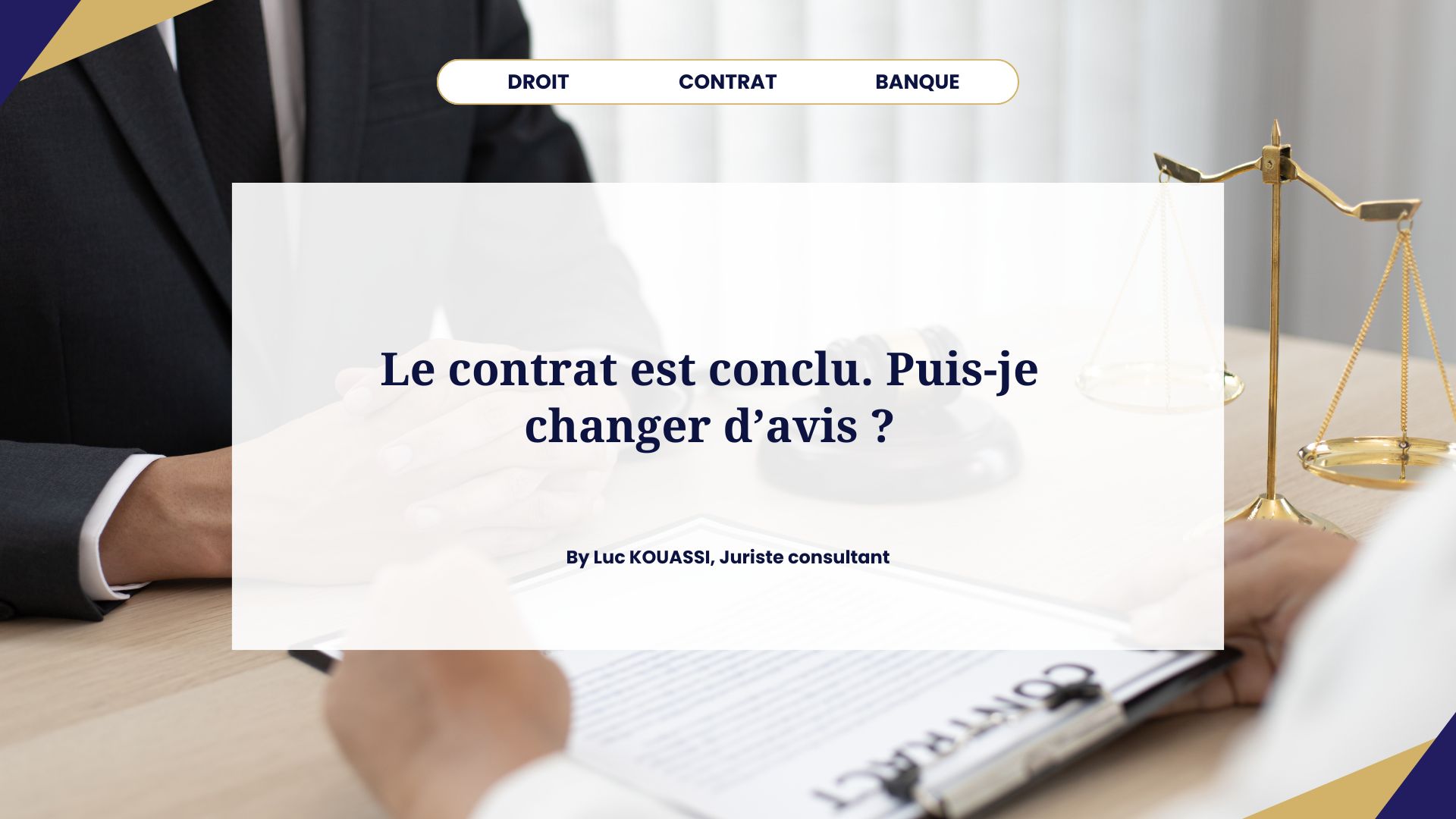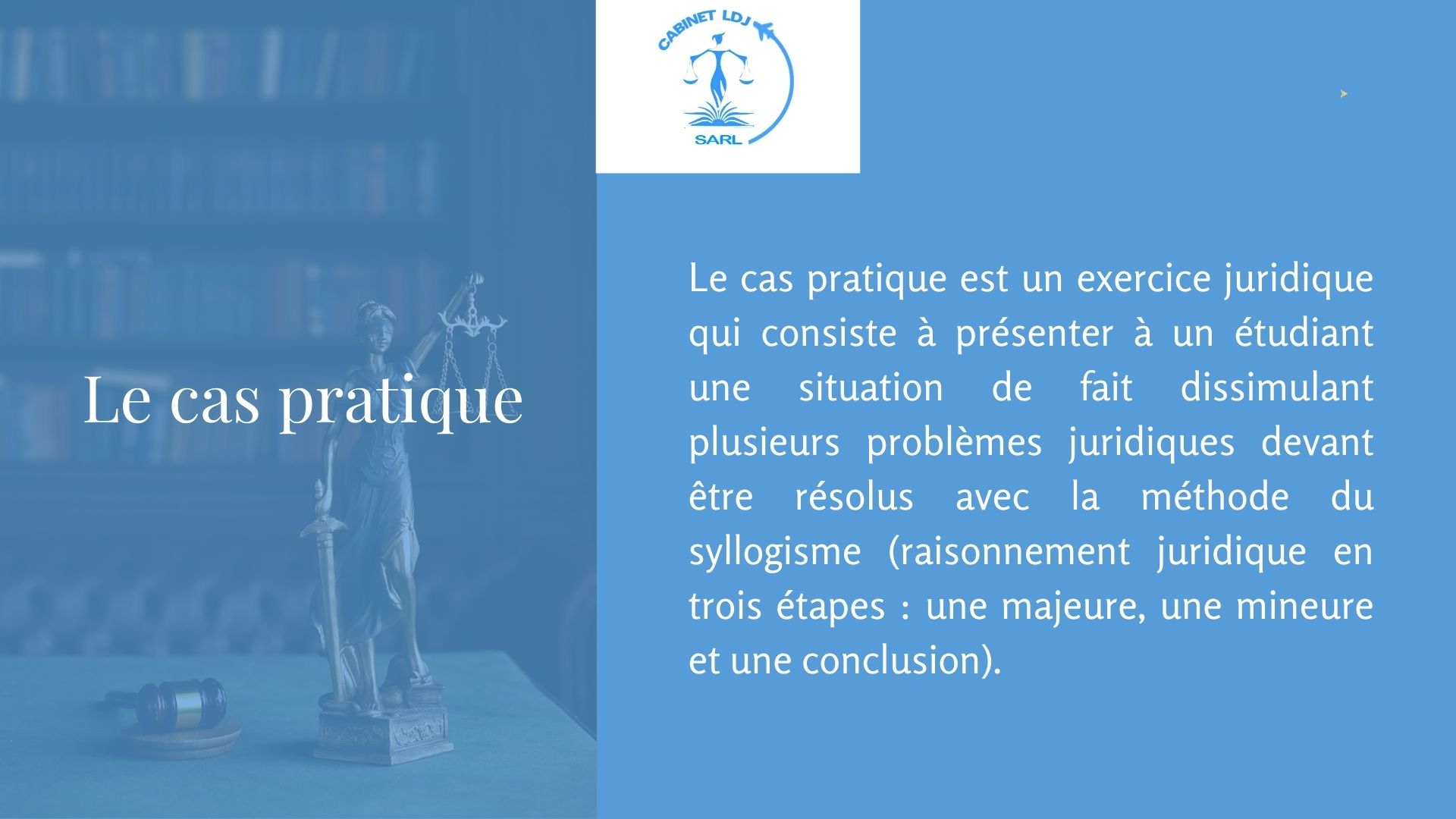RÉSUMÉ
Le financement par des tiers (Third Party Funding, TPF) s’impose progressivement comme un mécanisme incontournable dans l’arbitrage international contemporain. Cette pratique, par laquelle un tiers extérieur au litige finance tout ou partie des frais d’une procédure arbitrale en échange d’une quote-part des gains éventuels, soulève des questions juridiques, déontologiques et procédurales fondamentales. À travers une analyse systématique des cadres juridiques nationaux et internationaux, des directives des institutions arbitrales et de la jurisprudence récente, cet article examine les tensions entre l’accès à la justice arbitrale et la préservation de l’intégrité du processus. L’étude démontre que le TPF, bien que juridiquement légitime et économiquement bénéfique, nécessite un encadrement normatif rigoureux en matière de divulgation, de prévention des conflits d’intérêts et de protection des parties adverses pour garantir l’équilibre entre innovation financière et justice procédurale.
Mots-clés : financement par des tiers, arbitrage international, déontologie, conflits d’intérêts, divulgation.
ABSTRACT
Third-party funding (Third Party Funding, TPF) is progressively establishing itself as an indispensable mechanism in contemporary international arbitration. This practice, whereby a third party external to the dispute finances all or part of the costs of an arbitral proceeding in exchange for a share of any potential proceeds, raises fundamental legal, ethical, and procedural questions. Through a systematic analysis of national and international legal frameworks, arbitral institutions’ guidelines, and recent case law, this article examines the tensions between access to arbitral justice and the preservation of the process’s integrity. The study demonstrates that while TPF is legally legitimate and economically beneficial, it requires rigorous normative regulation regarding disclosure, prevention of conflicts of interest, and protection of adverse parties to ensure a balance between financial innovation and procedural justice.
Keywords: third-party funding, international arbitration, ethics, conflicts of interest, disclosure.
INTRODUCTION
L’arbitrage international a connu au cours des dernières décennies une expansion sans précédent, s’affirmant comme le mode privilégié de règlement des différends commerciaux transnationaux et des litiges d’investissement[1]. Cette croissance s’accompagne toutefois d’une augmentation substantielle des coûts procéduraux, qui peuvent atteindre plusieurs millions d’euros dans les affaires complexes, constituant ainsi un obstacle majeur à l’accès à la justice pour de nombreux justiciables[2].
Dans ce contexte économique contraignant, le financement par des tiers (Third Party Funding, ci-après « TPF ») émerge comme une réponse innovante aux défis financiers de l’arbitrage contemporain. Cette pratique consiste pour une entité tierce, sans lien préexistant avec le litige, à prendre en charge tout ou partie des frais nécessaires à une procédure arbitrale en échange d’une quote-part du montant alloué par la sentence ou d’un multiple du capital investi[3].
Le financement par des tiers peut être défini comme un mécanisme contractuel par lequel une entité tierce, sans lien préexistant avec le litige, accepte de prendre en charge la totalité ou une fraction des frais nécessaires à une procédure d’arbitrage. En contrepartie de cet investissement, le tiers financeur perçoit généralement un pourcentage du montant alloué par la sentence arbitrale ou un multiple du capital investi, selon les modalités convenues contractuellement.
Cette opération revêt une nature juridique complexe. Selon le rapport du Club des juristes de 2014, le contrat de financement doit être considéré comme un contrat composite ou sui generis, associant diverses prestations relevant potentiellement du contrat d’entreprise, du mandat, de la cession de créance ou encore du contrat aléatoire. Cette qualification hybride explique l’absence de régime juridique spécifique dans la plupart des ordres juridiques nationaux.
Il convient de distinguer le TPF d’autres mécanismes de financement du contentieux. Contrairement au pacte de quota litis, traditionnellement prohibé dans les systèmes de droit civil, le TPF n’établit pas une rémunération de l’avocat proportionnelle au résultat. De même, il se différencie de l’assurance de protection juridique par sa nature spéculative et son intervention ex post plutôt que préventive.
Né en Australie dans les années 1980 avant de se diffuser dans les pays de common law, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, le TPF connaît aujourd’hui une expansion mondiale qui interpelle les systèmes juridiques de tradition civiliste, y compris dans l’espace OHADA[4]. La rencontre entre le monde de la finance et celui de la justice soulève des interrogations fondamentales touchant à l’éthique professionnelle, à l’intégrité du processus arbitral, à l’indépendance des arbitres et des avocats, ainsi qu’à l’équilibre des droits des parties[5].
L’étude du financement par des tiers en arbitrage revêt une importance majeure à plusieurs égards. Sur le plan économique, le TPF contribue à faciliter l’accès à la justice arbitrale pour des justiciables qui, sans cette ressource, ne pourraient assumer les coûts prohibitifs d’une procédure internationale. Il permet également une meilleure répartition des risques financiers et offre aux parties une flexibilité dans la gestion de leur trésorerie.
D’un point de vue institutionnel, le TPF interroge les fondements mêmes de l’arbitrage : son caractère confidentiel, l’indépendance et l’impartialité des arbitres, l’autonomie de la volonté des parties. La présence d’un acteur économique motivé par la recherche de profit au sein d’un processus juridictionnel soulève des questions éthiques et déontologiques inédites.
Pour la profession d’avocat, le TPF constitue à la fois une opportunité et un défi. S’il offre de nouvelles possibilités de financement pour leurs clients, il impose également une vigilance accrue dans la préservation du secret professionnel, de l’indépendance du conseil et de la loyauté envers le client.
Enfin, dans le contexte spécifique du règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE), le TPF cristallise des tensions particulières. Comme le souligne le document de travail de la CNUDCI de 2019, le fait que seuls les investisseurs privés, et non les États défendeurs, bénéficient du financement par des tiers crée un déséquilibre structurel qui alimente les critiques à l’égard du système RDIE dans son ensemble.
La problématique centrale de cette étude peut être formulée ainsi : dans quelle mesure le financement par des tiers en arbitrage international peut-il concilier l’amélioration de l’accès à la justice avec la préservation de l’intégrité du processus arbitral et le respect des principes déontologiques fondamentaux ?
Cette question générale se décline en plusieurs interrogations subsidiaires : Comment garantir l’indépendance des arbitres et des avocats en présence d’un financeur tiers ? Quel équilibre trouver entre la confidentialité inhérente à l’arbitrage et l’exigence de transparence nécessaire à la prévention des conflits d’intérêts ? Quelles régulations, nationales ou internationales, sont nécessaires pour encadrer cette pratique ? Comment protéger les intérêts de la partie adverse face à un demandeur financé par un tiers ?
L’hypothèse directrice de cette recherche postule que le financement par des tiers constitue un mécanisme juridiquement et économiquement légitime qui contribue positivement à l’accès à la justice arbitrale, à condition qu’un cadre normatif approprié soit établi pour prévenir les dérives potentielles et garantir l’équilibre des intérêts en présence[6].
Cette étude adopte une approche juridique comparative et pluridisciplinaire, combinant l’analyse doctrinale, l’examen de la jurisprudence arbitrale internationale et l’étude des instruments normatifs récents (Lignes directrices IBA 2024[7], Règlement ICC 2021[8], Règlement d’arbitrage ICSID révisé en 2022[9], travaux de la CNUDCI[10]).
L’analyse s’articulera en deux parties. La première partie examine les fondements juridiques et les enjeux déontologiques du financement par des tiers, en analysant successivement sa nature juridique et sa validité (I.A), puis les défis éthiques qu’il soulève pour les acteurs de l’arbitrage (I.B). La seconde partie étudie les conséquences procédurales et les perspectives réglementaires, en examinant l’impact du TPF sur le déroulement et le coût des procédures arbitrales (II.A), avant d’explorer les différentes voies d’encadrement normatif envisageables (II.B).
I. FONDEMENTS JURIDIQUES ET ENJEUX DÉONTOLOGIQUES DU FINANCEMENT PAR DES TIERS EN ARBITRAGE
Le financement par des tiers constitue une innovation majeure dont la légitimité juridique et l’acceptabilité éthique demeurent débattues. Cette première partie examine les fondements juridiques de cette pratique et les conditions de sa validité dans différents systèmes juridiques (I.A), avant d’analyser les défis déontologiques qu’elle pose aux principaux acteurs de l’arbitrage (I.B).
A. Nature juridique et validité du financement par des tiers
L’irruption du Third Party Funding (TPF) dans le contentieux a posé, dès ses débuts, une question de principe : celle de sa compatibilité avec les systèmes juridiques. Pour y répondre, il est nécessaire, d’une part, de définir sa nature contractuelle et, d’autre part, d’évaluer sa licéité au regard des interdictions historiques, avant de considérer les solutions normatives proposées pour stabiliser sa pratique. Nous étudierons ainsi successivement :
- La qualification juridique : un contrat sui generis, qui révèle la complexité de l’opération et l’absence de régime spécifique.
- La licéité au regard des prohibitions historiques : champerty et quota litis, qui expose la confrontation entre modernité financière et tradition judiciaire.
- La sécurisation juridique et les perspectives d’évolution normative, qui souligne la nécessité d’un encadrement pour pérenniser l’outil.
1. Qualification juridique : un contrat sui generis
Le contrat de financement par des tiers échappe aux catégories contractuelles traditionnelles et doit être appréhendé comme un contrat composite ou sui generis, combinant plusieurs prestations de nature distincte[11].
Selon l’analyse développée par le Club des juristes français en 2014, le contrat de TPF associe des éléments relevant de plusieurs contrats nommés : le contrat d’entreprise (fourniture d’une prestation de financement), le mandat (gestion d’intérêts), la cession de créance (transfert partiel des droits résultant d’une éventuelle sentence favorable), et le contrat aléatoire (rémunération conditionnée au succès de la procédure)[12]. Cette nature hybride explique l’absence de régime juridique spécifique dans la plupart des ordres juridiques.
En droit français, conformément au principe de liberté contractuelle consacré par l’article 1102 du Code civil, les parties sont libres de concevoir un régime contractuel cohérent à partir de régimes fractionnés de divers contrats spéciaux[13]. Cette liberté trouve toutefois ses limites dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. Le caractère sui generis du contrat de TPF offre une flexibilité contractuelle appréciable mais génère également une incertitude juridique quant au régime applicable en cas de litige relatif au contrat lui-même[14].
Dans l’espace OHADA, l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage de 2017[15] ne contient aucune disposition explicite relative au financement par des tiers, laissant ainsi un vide juridique que la pratique arbitrale et la doctrine doivent combler par interprétation des principes généraux.
En définitive, la qualification du financement par des tiers comme un contrat sui generis est un reflet de son caractère composite, mêlant financement, gestion d’intérêts et aléa. Si cette qualification garantit aux parties une large liberté contractuelle en droit français (art. 1102 C. civ.) et dans l’espace OHADA, elle est aussi la source d’une incertitude normative majeure. L’absence de régime spécifique impose de naviguer entre les règles des contrats nommés, soulevant la question fondamentale de sa validité au regard des interdictions historiques visant à préserver l’intégrité du procès.
C’est précisément cette nature hybride et l’implication d’un tiers intéressé au succès du litige qui amènent à confronter le TPF aux prohibitions historiques de l’interventionnisme pécuniaire dans le procès, notamment celles du champerty dans la common law et du quota litis en droit civil.
2. Licéité au regard des prohibitions historiques : champerty et quota litis
La licéité du financement par des tiers suppose de dépasser les prohibitions historiques du champerty (droit anglo-saxon) et du pacte de quota litis (droit civil), en démontrant que le TPF ne tombe pas sous le coup de ces interdictions[16].
Le champerty désigne historiquement un accord illégal où un tiers finance un procès en échange d’une part des gains obtenus, motivé uniquement par le profit sans intérêt légitime dans l’affaire. Forme aggravée de « maintenance » (soutien injustifié à un procès), le champerty était condamné car il incitait à la subversion de la justice[17]. Cette doctrine, issue de la common law médiévale, a été progressivement abolie ou assouplie dans de nombreuses juridictions.
Au Royaume-Uni, la décision historique Factortame Ltd v. Secretary of State for Transport (1991) a marqué un tournant en admettant la légitimité du financement par des tiers dans certaines circonstances[18]. À Singapour, la Civil Law (Amendment) Act 2017 et les Civil Law (Third-Party Funding) Regulations 2017 ont explicitement légalisé et réglementé le TPF en matière d’arbitrage international[19]. Hong Kong a suivi une voie similaire avec l’Arbitration and Mediation Legislation (Third Party Funding) (Amendment) Ordinance 2017[20].
Le pacte de quota litis, prohibé en droit français et dans de nombreux systèmes civilistes, désigne une convention interdite où les honoraires d’un avocat dépendent exclusivement du résultat financier obtenu pour son client, sans honoraire de base[21]. Cette prohibition vise à préserver l’indépendance de l’avocat et à éviter qu’il ne soit trop intéressé par le gain au détriment de l’intérêt du client.
Le rapport du Club des juristes de 2014 considère que le financement par des tiers, tel qu’il se pratique en arbitrage international, ne constitue pas un pacte de quota litis prohibé[22]. En effet, le pacte de quota litis concerne la rémunération de l’avocat proportionnelle au résultat du litige, tandis que le TPF implique un tiers distinct qui n’exerce pas la profession d’avocat et ne se substitue pas à celui-ci. Le financeur ne fournit pas de services juridiques mais un financement, ce qui le place en dehors du champ d’application de la prohibition.
DDe plus, l’activité de financement de procès ne constitue pas une opération de crédit au sens du Code monétaire et financier français, et n’entre donc pas dans le champ du monopole bancaire[23]. Le caractère aléatoire de la rémunération du financeur (conditionnée au succès) et l’absence de remboursement en cas d’échec distinguent fondamentalement le TPF du prêt bancaire traditionnel. La confrontation du financement par des tiers avec les interdictions de la champerty et du quota litis révèle une tendance claire vers la légalisation de la pratique, sous réserve d’un encadrement. Alors que les juridictions de common law ont largement assoupli l’interdiction de l’implication d’un tiers dans le contentieux, le droit civil a maintenu une méfiance à l’égard de la rémunération excessivement liée au résultat (quota litis). La licéité du TPF repose donc sur un équilibre délicat : il est désormais admis en tant que technique de financement, mais son mécanisme contractuel (notamment la rémunération du funder) doit être scrupuleusement vérifié pour éviter la fraude à la loi ou le trouble à l’ordre public processuel.
Si l’esprit des interdictions historiques tend à s’estomper face à la reconnaissance de l’utilité du TPF, sa consécration pleine et entière exige de dépasser l’empirisme jurisprudentiel. C’est pourquoi, face à l’incertitude juridique persistante dans de nombreuses juridictions, une clarification législative ou réglementaire apparaît nécessaire pour sécuriser la pratique du financement par des tiers et en définir les contours précis.
3. Sécurisation juridique et perspectives d’évolution normative
Face à l’incertitude juridique persistante dans de nombreuses juridictions, une clarification législative ou réglementaire apparaît nécessaire pour sécuriser la pratique du financement par des tiers[24].
Le rapport du Club des juristes recommande une intervention du législateur français pour exclure expressément du champ du monopole bancaire les sociétés de financement de procès, afin de renforcer la sécurité juridique[25]. L’absence de réglementation spécifique dans des juridictions majeures comme la France contraste avec l’approche adoptée par Singapour et Hong Kong, créant un risque de fragmentation du marché international du financement de l’arbitrage.
Dans l’espace OHADA, l’absence de dispositions spécifiques dans l’Acte uniforme de 2017 relatif au droit de l’arbitrage[26] appelle une clarification, soit par voie de révision de l’Acte uniforme, soit par l’adoption de directives par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), afin d’harmoniser les pratiques dans les dix-sept États membres.
La nécessité d’une intervention normative pour la sécurisation du TPF est aujourd’hui une évidence. L’évolution passe par l’adoption de règles spécifiques relatives, notamment, à la transparence, aux conflits d’intérêts et aux exigences prudentielles. L’expérience de la Common Law, notamment le développement de codes de conduite et l’initiative de l’OHADA de 2017 sur l’arbitrage, indique la voie d’un encadrement pragmatique. À défaut d’un régime juridique autonome, la pratique du TPF continuera d’opérer dans un vide normatif qui expose les parties et le processus arbitral à des risques d’instabilité, faisant de la transparence l’enjeu central de l’évolution du droit. Si le financement par des tiers a su s’affranchir des interdits historiques grâce à sa qualification de contrat sui generis et malgré l’absence d’un régime unifié, son développement soutenu et sa complexité exigent que son rôle ne soit plus seulement considéré sous l’angle de sa validité. L’analyse doit désormais se déplacer de la licéité à l’utilité du TPF.
C’est pourquoi il est impératif d’examiner dans quelle mesure cette technique financière, initialement perçue comme un risque pour l’intégrité du procès, peut être considérée comme un vecteur d’amélioration de l’accès à la justice et, in fine, un outil de bonne administration de la justice.
B. Défis éthiques et déontologiques pour les acteurs de l’arbitrage
La reconnaissance de la validité du financement par des tiers (TPF) et sa montée en puissance ont mis en lumière une série de défis éthiques et déontologiques qui menacent l’intégrité de la procédure arbitrale et la confiance dans ses acteurs. L’introduction d’un tiers intéressé rompt l’équilibre traditionnel de la relation avocat-client-juge, imposant de revoir les règles fondamentales de déontologie. Nous analyserons comment le TPF met à l’épreuve :
- L’indépendance de l’avocat face au tiers financeur, pilier de la relation de confiance et de la défense du client.
- Le secret professionnel et la confidentialité de l’arbitrage, principes garants de la sécurité et de la discrétion de la procédure.
- L’Indépendance et l’impartialité des arbitres : la question des conflits d’intérêts, enjeu crucial pour l’exequatur des sentences.
1. L’indépendance de l’avocat face au tiers financeur
L’intervention d’un tiers financeur dans une procédure arbitrale menace potentiellement l’indépendance de l’avocat, principe cardinal de la déontologie juridique, en créant une relation triangulaire complexe entre le conseil, son client et le financeur[27].
Selon les principes déontologiques fondamentaux, l’avocat doit exercer sa mission en toute indépendance, libre de toute pression extérieure et exclusivement guidé par l’intérêt de son client. Le Barreau de Paris, dans son rapport de février 2017, réaffirme avec force que « l’avocat reste tenu par ses obligations d’assistance, de représentation, de conseil et de loyauté à l’égard de la partie financée, qui demeure son seul client »[28].
Cette exigence d’indépendance se heurte à la réalité économique du TPF : le financeur, qui supporte le risque financier de la procédure et qui rémunère parfois directement l’avocat, peut être tenté d’exercer une influence sur la conduite du litige, notamment en matière de stratégie procédurale, de choix des experts ou de négociation d’un éventuel règlement amiable[29].
L’Ordre des Barreaux Flamands, dans ses recommandations de 2023, va plus loin en prohibant explicitement toute représentation simultanée du financeur et du justiciable par le même avocat : « L’avocat ne peut agir simultanément pour le financeur et pour le justiciable, sans préjudice de l’article 6 du Code de déontologie des avocats (interdiction des conflits d’intérêts) »[30]. Cette prohibition vise à éviter que l’avocat ne se trouve dans une situation de conflit d’intérêts structurel.
Pour préserver l’indépendance de l’avocat, le Barreau de Paris recommande d’établir, dès l’origine de la relation tripartite, « des modalités pratiques, claires et précises, sur la conduite de la procédure », précisant notamment les limites de l’information et de la consultation du financeur, tout en réservant au client le pouvoir de décision final sur les questions stratégiques essentielles[31]. L’indépendance de l’avocat est préservée à la condition que la primauté des intérêts du client soit expressément maintenue et que le pouvoir de décision finale lui soit toujours réservé. Si les ordres professionnels cherchent à encadrer la relation triangulaire, ils doivent également s’assurer que la communication nécessaire à la gestion du financement ne porte pas atteinte à une autre obligation fondamentale de l’avocat : la garde du secret professionnel. En effet, l’accès du financeur aux informations sensibles de l’affaire pose immédiatement la question de la compatibilité du TPF avec le secret professionnel de l’avocat et le caractère confidentiel de l’arbitrage, deux principes essentiels à la sécurité des échanges.
2. Secret professionnel et confidentialité de l’arbitrage
Le financement par des tiers entre en tension avec deux principes essentiels : le secret professionnel de l’avocat et la confidentialité inhérente à la procédure arbitrale[32].
Le secret professionnel constitue un principe fondamental de la profession d’avocat, protégeant les communications entre le conseil et son client contre toute divulgation à des tiers. Or, le fonctionnement pratique du TPF implique généralement que le financeur accède à des informations sensibles sur le litige pour évaluer la viabilité du financement (due diligence), puis pour suivre l’évolution de la procédure[33].
Comme l’analyse le document de la CNUDCI de 2019, « les tiers financeurs ne sont pas nécessairement liés par des obligations de confidentialité, et rien ne leur interdit d’utiliser les informations qui leur sont transmises dans le cadre d’un autre litige faisant l’objet d’un financement »[34]. Cette situation pose un risque sérieux de dissémination d’informations confidentielles.
Le Barreau de Paris adopte une position stricte : « en principe, l’avocat de la partie financée ne peut communiquer directement avec le tiers financeur, quelles que soient les dispositions du contrat de financement… La divulgation au tiers financeur des informations… ne peut donc émaner que du client »[35]. Cette recommandation établit une séparation claire entre l’avocat et le financeur, le client jouant le rôle de filtre.
L’Ordre des Barreaux Flamands confirme cette approche : « L’avocat est tenu au secret professionnel. Il ne transmet aucune information au financier sans l’accord préalable du client. … Même dans ce cas, l’avocat ne fournira que les informations nécessaires à la sauvegarde des intérêts du client »[36].
Au-delà du secret professionnel de l’avocat, la confidentialité de l’arbitrage lui-même est menacée par le TPF. L’intervention d’un financeur tiers, acteur économique extérieur à la relation contractuelle initiale, élargit le cercle des personnes ayant connaissance du différend, fragilisant ainsi cette confidentialité[37]. Pour maintenir l’équilibre entre l’exigence d’information du financeur et la protection des principes fondamentaux, il est impératif de subordonner toute divulgation du dossier à l’accord éclairé et exprès du client, et d’imposer au funder des clauses contractuelles strictes de confidentialité. Néanmoins, le risque de diffusion d’informations ne concerne pas seulement les parties et leurs conseils ; il touche également l’instance elle-même, en soulevant un défi plus fondamental pour l’organe de jugement : l’impartialité des arbitres.
La question de la connaissance et de l’identification du tiers financeur devient alors cruciale, non plus pour les avocats, mais pour les arbitres, dont l’indépendance et l’impartialité sont directement menacées par les potentiels conflits d’intérêts liés au TPF.
3. Indépendance et impartialité des arbitres : la question des conflits d’intérêts
La présence d’un tiers financeur dans une procédure arbitrale crée des risques inédits de conflits d’intérêts pour les arbitres, menaçant l’intégrité du processus arbitral et la légitimité des sentences rendues[38].
L’indépendance et l’impartialité des arbitres constituent des principes cardinaux de l’arbitrage international. Selon la Convention de New York de 1958 et la plupart des lois nationales sur l’arbitrage, une sentence peut être annulée si l’indépendance ou l’impartialité d’un arbitre est compromise[39].
Le document de travail de la CNUDCI de 2019 identifie « la question des conflits d’intérêts entre arbitres et tiers financeurs comme l’une des premières à avoir appelé l’attention, du fait de ses incidences potentielles sur le caractère exécutoire des sentences arbitrales et, plus largement, sur l’intégrité du processus arbitral »[40].
Ces conflits d’intérêts peuvent prendre plusieurs formes. Un arbitre peut avoir des liens professionnels ou financiers directs avec le financeur (par exemple, avoir été conseil dans d’autres affaires pour le même financeur). Plus subtilement, le cabinet d’avocats de l’arbitre peut représenter régulièrement des clients du financeur ou avoir lui-même conclu des accords de financement avec la même entité pour d’autres dossiers[41].
La difficulté majeure réside dans le fait que ces conflits potentiels ne peuvent être identifiés et divulgués que si les arbitres et les parties ont connaissance de l’existence et de l’identité du financeur. Or, traditionnellement, les parties n’étaient pas tenues de révéler l’existence d’un financement par un tiers, créant ainsi un angle mort dans le système de prévention des conflits d’intérêts[42].
Les Lignes directrices IBA 2024 sur les conflits d’intérêts en arbitrage international ont considérablement renforcé les obligations de divulgation[43]. La nouvelle version stipule expressément que :
- Les parties doivent divulguer « toute relation, directe ou indirecte, entre l’arbitre et toute personne ou entité ayant un intérêt économique direct dans la sentence ou une obligation d’indemniser une partie » (General Standard 7(a))[44].
- Les « tiers financeurs et assureurs peuvent avoir un intérêt économique direct dans la poursuite ou la défense de l’affaire, une influence de contrôle sur une partie, ou une influence sur la conduite de la procédure, y compris la sélection des arbitres » (Explanation to General Standard 6(b))[45].
Dans l’affaire Muhammet Çap & Sehil Inşaat v. Turkmenistan (ICSID Case No. ARB/12/6), le Turkménistan a demandé la récusation d’un arbitre après avoir découvert l’existence d’un financement par un tiers, arguant que l’arbitre aurait dû être informé de cette situation pour évaluer d’éventuels conflits d’intérêts[46].
Cette évolution vers une obligation de divulgation marque un changement de paradigme dans la pratique de l’arbitrage international, traditionnellement attachée à la confidentialité et à l’autonomie des parties[47]. L’obligation de divulgation de l’identité du tiers financeur est devenue la mesure indispensable pour restaurer la confiance dans l’arbitrage et permettre aux arbitres d’exercer pleinement leur devoir d’auto-évaluation de leur impartialité conformément aux Lignes directrices IBA 2024. En définitive, les défis éthiques et déontologiques soulevés par le TPF ne remettent pas en cause sa validité, mais appellent à un renforcement des règles de transparence et de déontologie pour tous les acteurs. La réglementation spontanée issue des ordres professionnels et des institutions arbitrales comble ainsi progressivement le vide législatif, conditionnant l’acceptabilité du TPF à son encadrement strict.
Après avoir établi la validité et les impératifs déontologiques du TPF, il convient d’analyser les incidences concrètes de ce mécanisme sur la dynamique même du litige, en examinant comment le financement par des tiers modifie l’équilibre des forces et influence la gestion des coûts et du risque processuel.
II. CONSÉQUENCES PROCÉDURALES ET PERSPECTIVES RÉGLEMENTAIRES DU FINANCEMENT PAR DES TIERS
Au-delà des questions de validité juridique et de conformité déontologique, le financement par des tiers produit des effets concrets sur le déroulement des procédures arbitrales. Cette dimension pratique soulève des interrogations majeures quant à l’équité procédurale, à l’allocation des frais d’arbitrage et à la protection des parties adverses (II.A). Face à ces enjeux, la question de l’opportunité et des modalités d’une régulation du TPF se pose avec acuité (II.B).
A. Impact du financement par des tiers sur le déroulement et le coût des procédures arbitrales
L’introduction du tiers financeur dans l’équation arbitrale ne se limite pas à un apport de capital ; elle modifie l’équilibre des forces et introduit de nouvelles variables dans la gestion du contentieux, notamment en matière de stratégie, d’allocation des coûts et de protection de la partie adverse. Nous examinerons :
- L’Influence du financeur sur la conduite de la procédure, source potentielle de conflits d’intérêts stratégiques.
- L’Allocation des coûts et la récupération des frais de financement, qui mettent à l’épreuve le principe du « loser pays ».
- La Security for costs et la protection de la partie adverse, mécanisme de rééquilibrage procédural.
1. Influence du financeur sur la conduite de la procédure
L’intervention d’un tiers financeur peut potentiellement influencer la stratégie procédurale et les décisions des parties, notamment en matière de règlement amiable[48].
Le document de la CNUDCI de 2019 identifie « l’influence potentielle du tiers financeur sur la procédure, notamment lors des négociations en vue d’un règlement, en particulier lorsque sa rémunération dépend de l’issue de la procédure »[49] comme une préoccupation majeure.
Cette influence s’explique par la structure économique du financement. Le financeur investit son capital en anticipant un retour sur investissement substantiel, généralement calculé comme un multiple de la somme investie ou un pourcentage des gains obtenus. Cette logique financière peut entrer en conflit avec l’intérêt du client dans trois situations principales[50]:
Premièrement, lors des négociations de règlement amiable, le financeur peut privilégier un règlement rapide garantissant un retour certain, même si ce règlement est sous-optimal du point de vue du client. À l’inverse, il peut refuser un règlement raisonnable si sa formule de rémunération l’incite à miser sur une victoire totale.
Deuxièmement, dans les décisions relatives à la conduite de la procédure (choix des témoins et experts, stratégie d’interrogatoire, ampleur des écritures), le financeur peut exercer une pression pour limiter les coûts ou au contraire pour maximiser les chances de succès, sans que ces choix correspondent nécessairement à l’intérêt du client.
Troisièmement, le financeur peut avoir un intérêt stratégique propre dans l’issue du litige, notamment s’il finance d’autres affaires similaires ou s’il souhaite établir un précédent juridique favorable à son portefeuille d’investissements[51].
Pour limiter ces risques, le Barreau de Paris recommande que « des modalités pratiques, claires et précises, sur la conduite de la procédure » soient établies dès l’origine, réservant au client « le pouvoir de décision final sur les questions stratégiques essentielles »[52]. L’influence du financeur, inhérente à son investissement, représente un risque de dévoiement de l’intérêt du client au profit d’une logique purement financière. La gestion de ce risque passe par une clarté contractuelle maximale dès le contrat de financement, qui doit garantir le maintien du pouvoir de décision final au seul client, limitant ainsi l’impact du funder sur les questions stratégiques essentielles comme le règlement amiable. Toutefois, l’impact le plus direct et le plus quantifiable du TPF se manifeste dans la gestion économique du litige lui-même.
Si le financeur investit pour couvrir les frais, il est légitime de se demander si la rémunération de cet investissement doit être supportée uniquement par la partie financée ou si elle peut être récupérée auprès de la partie adverse perdante, question qui divise la jurisprudence arbitrale.
2. Allocation des coûts et récupération des frais de financement
Le financement par des tiers soulève des questions complexes en matière d’allocation des coûts de l’arbitrage, notamment quant à la possibilité pour la partie financée de récupérer les frais de financement auprès de la partie adverse perdante[53].
En arbitrage international, le principe général veut que la partie perdante supporte les frais de la procédure, incluant les honoraires du tribunal arbitral, les frais administratifs de l’institution arbitrale, et les frais juridiques raisonnables de la partie gagnante (principe du « costs follow the event » ou « loser pays »)[54]. La question se pose de savoir si les frais payés au financeur tiers entrent dans la catégorie des « frais juridiques raisonnables » récupérables.
Deux positions s’opposent. Selon une approche restrictive, les frais de financement ne constituent pas des frais de représentation juridique mais des frais financiers comparables à des intérêts d’emprunt, et ne devraient donc pas être récupérables auprès de la partie adverse[55]. Cette position repose sur l’idée que la décision d’une partie de recourir au TPF relève de ses choix de gestion financière privés.
Selon une approche extensive, les frais de financement doivent être considérés comme une composante des frais d’accès à la justice et devraient donc être récupérables, au moins partiellement, dès lors qu’ils sont raisonnables et nécessaires[56]. Cette position s’appuie sur l’argument que le recours au TPF constitue souvent le seul moyen pour une partie d’accéder à l’arbitrage.
La jurisprudence arbitrale demeure hésitante et casuistique. Dans l’affaire Essar Oilfields Services Limited v. Norscot Rig Management Pvt Limited, le tribunal arbitral a considéré que les frais de financement par un tiers ne constituaient pas des « coûts raisonnables » et a refusé leur récupération[57]. À l’inverse, d’autres tribunaux ont accepté d’inclure tout ou partie de ces frais dans les coûts recouvrables[58].
Cette incertitude jurisprudentielle plaide en faveur d’une clarification normative, soit par les institutions arbitrales dans leurs règlements, soit par les tribunaux dans leurs sentences motivées établissant des principes directeurs. La question de la récupérabilité des frais de financement met en lumière la nature hybride du TPF, à mi-chemin entre frais de justice et frais financiers. L’incertitude jurisprudentielle actuelle, oscillant entre une approche restrictive et une approche extensive, fragilise l’équité procédurale. Une clarification normative est nécessaire pour établir des critères précis permettant aux tribunaux arbitraux de déterminer si ces frais sont raisonnables et nécessaires, sans quoi la partie adverse victorieuse risque d’être condamnée à payer des frais sans lien direct avec la procédure. Ce risque pour la partie adverse justifie le recours à un mécanisme de protection : la security for costs. Dès lors que le financeur échappe à la condamnation aux dépens, le TPF peut créer un déséquilibre entre les parties. C’est pourquoi la protection de la partie adverse est devenue un enjeu majeur, nécessitant l’analyse de la security for costs comme mécanisme de rééquilibrage face au risque d’insolvabilité de la partie financée.
3. Security for costs et protection de la partie adverse
La présence d’un financement par un tiers peut justifier l’octroi d’une ordonnance de security for costs (garantie pour frais) au bénéfice de la partie adverse[59].
La security for costs est une mesure procédurale par laquelle le tribunal arbitral ordonne au demandeur de fournir une garantie financière destinée à couvrir les frais de la partie défenderesse en cas de succès de cette dernière. Traditionnellement, cette mesure était réservée aux situations où le demandeur présentait un risque d’insolvabilité ou était domicilié dans une juridiction rendant difficile l’exécution d’une condamnation en dépens[60].
Avec l’émergence du TPF, certains tribunaux arbitraux ont considéré que l’existence d’un financement par un tiers constituait un facteur pertinent pour l’octroi d’une security for costs, au motif que :
- Le financeur n’est généralement pas partie à la procédure et ne peut donc être condamné aux dépens[61] ;
- Les contrats de financement prévoient souvent que le financeur cesse de financer en cas de décision défavorable, laissant le demandeur potentiellement insolvable ;
- L’existence d’un financement démontre que le demandeur ne dispose pas des ressources propres pour financer la procédure, suggérant un risque accru d’insolvabilité.
Dans l’affaire South American Silver Limited v. Bolivia (PCA Case No. 2013-15), la Bolivie a soulevé la question de l’obligation de divulgation du financement par un tiers, arguant que la non-divulgation violait le principe de bonne foi et pouvait justifier une ordonnance de security for costs[62].
Cependant, cette approche reste controversée. Certains auteurs soutiennent qu’accorder systématiquement une security for costs en présence d’un TPF viderait de sa substance le bénéfice principal du financement, à savoir permettre à des parties aux ressources limitées d’accéder à l’arbitrage[63]. La security for costs constitue le principal rempart procédural contre les conséquences négatives du TPF sur la partie adverse. Si le TPF facilite l’accès à la justice, il ne doit pas créer un risque asymétrique où seule la partie adverse vainqueur serait exposée à l’insolvabilité de la partie financée. Toutefois, l’octroi de cette garantie doit rester exceptionnel et ne pas être systématique, sous peine de vider le TPF de son objet en décourageant l’accès au financement pour les parties aux ressources limitées. En somme, l’impact du TPF sur le déroulement de l’arbitrage exige un arbitrage constant entre l’objectif louable d’accès à la justice et le maintien de l’équité procédurale.
Face aux incertitudes juridiques, aux enjeux éthiques et aux défis procéduraux posés par le TPF, il est devenu indispensable d’analyser les réponses normatives apportées par les États et les institutions. Il convient désormais d’examiner les perspectives réglementaires et l’encadrement normatif du financement par des tiers mis en place ou envisagés à travers le monde.
B. Perspectives réglementaires et encadrement normatif du financement par des tiers
La nécessité d’un encadrement normatif du TPF est aujourd’hui admise par la communauté arbitrale internationale. Les efforts se concentrent sur la création d’un cadre juridique qui maximise les bénéfices du financement (accès à la justice) tout en minimisant les risques (conflits d’intérêts, influence indue, iniquité procédurale). Nous analyserons :
- Les Approches nationales : les modèles de Singapour et Hong Kong, qui ont opté pour une législation claire.
- Les Approches institutionnelles : règlements arbitraux et lignes directrices, qui assurent un encadrement transnational de soft law.
- Les Perspectives pour l’espace OHADA, qui doit encore combler le vide juridique.
- Les Recommandations pour un encadrement équilibré, synthétisant les meilleures pratiques.
1. Approches nationales : les modèles de Singapour et Hong Kong
Les législations de Singapour et Hong Kong, adoptées en 2017, constituent des modèles de référence en matière de régulation du financement par des tiers[64].
À Singapour, la Civil Law (Amendment) Act 2017 et les Civil Law (Third-Party Funding) Regulations 2017, entrées en vigueur le 1er mars 2017, ont aboli les torts de common law de champerty et maintenance et ont établi un cadre réglementaire complet pour le TPF en arbitrage international et médiation[65]. Les Régulations stipulent que les financeurs éligibles doivent :
- Exercer comme activité principale le financement de procédures de règlement des différends ;
- Disposer d’un capital minimum ou d’une assurance professionnelle suffisante ;
- Respecter des normes de conduite professionnelle, incluant la gestion des conflits d’intérêts.
À Hong Kong, l’Arbitration and Mediation Legislation (Third Party Funding) (Amendment) Ordinance 2017 a aboli les délits de champerty et maintenance et a modifié l’Arbitration Ordinance pour autoriser explicitement le TPF dans les arbitrages ayant leur siège à Hong Kong ou, s’ils sont situés à l’étranger, pour le financement de services fournis à Hong Kong[66].
Ces deux modèles partagent plusieurs caractéristiques communes[67] :
- Abolition explicite des prohibitions historiques du champerty ;
- Limitation du TPF aux procédures d’arbitrage international et de médiation ;
- Exigences de qualification professionnelle et de capacité financière pour les financeurs ;
- Obligation de divulgation de l’existence du financement et de l’identité du financeur ;
- Préservation du privilège du secret professionnel de l’avocat.
Ces législations ont contribué à faire de Singapour et Hong Kong des places d’arbitrage internationales attractives, offrant un cadre juridique clair et prévisible pour les parties et les financeurs[68]. Les modèles de Singapour et Hong Kong illustrent l’efficacité d’une intervention législative directe qui légalise le TPF tout en lui imposant un cadre strict (exigences de qualification, obligation de divulgation limitée à l’identité). Ces approches ont créé une sécurité juridique qui renforce leur attractivité en tant que places d’arbitrage. Elles démontrent qu’une réglementation claire est possible, même si, en l’absence de lois nationales comparables dans de nombreux États, ce sont les institutions arbitrales qui ont dû prendre le relais. Face à la lenteur du processus législatif étatique, les règlements des institutions d’arbitrage et les instruments de soft law de la communauté professionnelle, comme ceux de la CCI et de l’IBA, se sont imposés comme le véritable moteur de l’encadrement normatif transnational du TPF.
2. Approches institutionnelles : règlements arbitraux et lignes directrices
Face à l’absence de régulation nationale dans de nombreuses juridictions, les institutions arbitrales et les organisations professionnelles ont développé leurs propres normes et lignes directrices[69].
Le Règlement d’arbitrage de la CCI de 2021 a introduit à l’article 11(7) une obligation de divulgation : « Chaque partie informe sans tarder le Secrétariat, les autres parties et tout arbitre confirmé ou nommé de l’existence et de l’identité de toute personne non partie qui a conclu un accord de financement avec elle pour l’instance arbitrale et en vertu duquel elle s’est engagée à rembourser, en totalité ou en partie et de manière substantielle, les montants dépensés pour engager et poursuivre l’instance arbitrale »[70].
Cette disposition marque une évolution significative vers la transparence, bien qu’elle se limite à l’identité du financeur sans exiger la divulgation du contenu de l’accord de financement[71].
Le Règlement d’arbitrage ICSID, révisé en 2022, contient à la Rule 14 une disposition similaire imposant la divulgation du nom et de l’adresse de toute personne non-partie finançant l’arbitrage[72]. Cette évolution répond aux préoccupations exprimées lors des travaux du Groupe de travail III de la CNUDCI sur la réforme du règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE)[73].
Les Lignes directrices IBA 2024 sur les conflits d’intérêts, révisées en mai 2024, intègrent désormais explicitement le financement par des tiers dans leur cadre d’analyse des conflits d’intérêts[74]. L’Explanation to General Standard 6(b) précise : « Third-party funders and insurers may have a direct economic interest in the prosecution or defence of the case in dispute, a controlling influence on a party to the arbitration, or influence over the conduct of proceedings, including the selection of arbitrators »[75].
Cette reconnaissance explicite du TPF dans les Lignes directrices IBA, instrument de soft law largement adopté dans la communauté arbitrale internationale, constitue une étape importante vers l’harmonisation des pratiques[76].
Les Guidelines on Third-Party Funding du CIArb (Chartered Institute of Arbitrators), publiées en 2025, fournissent des recommandations pratiques détaillées sur la divulgation, la gestion des conflits d’intérêts et les considérations déontologiques liées au TPF[77]. Ces Guidelines soulignent l’importance d’une divulgation précoce et transparente, tout en respectant la confidentialité des termes commerciaux de l’accord de financement. Les dispositions récentes des règlements de la CCI (Art. 11(7)) et du CIRDI (Rule 14), ainsi que les Lignes directrices IBA 2024, confirment l’émergence d’un standard transnational de soft law : l’obligation de divulgation de l’identité du financeur. Cette approche institutionnelle permet une régulation rapide et flexible qui s’adapte à l’évolution de la pratique. Cependant, l’efficacité de cet encadrement reste limitée dans les juridictions où l’arbitrage est majoritairement ad hoc ou dans les espaces régionaux qui n’ont pas encore intégré ces évolutions, comme celui de l’OHADA. L’absence de disposition explicite dans l’Acte uniforme OHADA de 2017 sur l’arbitrage crée un vide juridique dans un espace économique majeur. Il devient essentiel d’analyser les perspectives réglementaires qui s’offrent à l’espace OHADA pour rattraper son retard et intégrer le TPF dans son cadre juridique.
3. Perspectives pour l’espace OHADA
Dans l’espace OHADA, l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage de 2017 ne contient aucune disposition explicite relative au financement par des tiers[78]. Cette lacune soulève des questions importantes pour les dix-sept États membres, d’autant plus que l’arbitrage OHADA joue un rôle croissant dans le règlement des différends commerciaux en Afrique subsaharienne[79].
Plusieurs options s’offrent aux décideurs de l’OHADA pour encadrer le TPF[80] :
Option 1 : Révision de l’Acte uniforme. Une révision de l’Acte uniforme pourrait introduire des dispositions spécifiques sur le TPF, inspirées des modèles de Singapour et Hong Kong, incluant :
- Une reconnaissance explicite de la licéité du TPF en arbitrage international ;
- Des obligations de divulgation de l’existence et de l’identité du financeur ;
- Des garanties pour préserver l’indépendance des avocats et des arbitres ;
- Des dispositions sur l’allocation des coûts et la security for costs.
Option 2 : Directives de la CCJA. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pourrait adopter des directives ou recommandations sur le TPF, complétant l’Acte uniforme sans nécessiter sa révision formelle. Ces directives pourraient s’inspirer des Lignes directrices IBA 2024 et des Guidelines du CIArb.
Option 3 : Intégration dans le Règlement d’arbitrage de la CCJA. Le Règlement d’arbitrage de la CCJA pourrait être révisé pour inclure une disposition similaire à l’article 11(7) du Règlement ICC, imposant la divulgation du TPF dans les arbitrages administrés par la CCJA.
Option 4 : Approche graduée. Une combinaison des options ci-dessus, avec une reconnaissance progressive de la pratique accompagnée d’un encadrement normatif adapté aux spécificités du contexte juridique et économique africain.
L’adoption d’un cadre réglementaire clair en matière de TPF dans l’espace OHADA présenterait plusieurs avantages[81] :
- Renforcer l’attractivité de la CCJA comme centre d’arbitrage régional ;
- Faciliter l’accès à l’arbitrage pour les PME et les parties aux ressources limitées ;
- Harmoniser les pratiques entre les États membres ;
- Prévenir les conflits d’intérêts et protéger l’intégrité du processus arbitral ;
- Contribuer au développement d’une jurisprudence cohérente sur les questions liées au TPF.
Pour l’espace OHADA, l’adoption d’un cadre réglementaire clair – qu’il passe par la révision de l’Acte uniforme, les Directives de la CCJA ou la modification du Règlement d’arbitrage – est impérative pour renforcer l’attractivité de la région et garantir un accès équitable à l’arbitrage. L’alignement sur les standards internationaux en matière de divulgation permettrait de prévenir les conflits d’intérêts tout en exploitant le TPF comme un levier de développement économique et judiciaire. Cet alignement s’inscrit dans un ensemble plus large de recommandations visant un encadrement global.
L’analyse des modèles nationaux et institutionnels permet de synthétiser les meilleures pratiques. Il est désormais possible de formuler un ensemble de recommandations concrètes et équilibrées visant à assurer la pérennité et l’intégrité du financement par des tiers dans le contentieux international.
4. Recommandations pour un encadrement équilibré
Sur la base de l’analyse comparative des différents modèles réglementaires et des enjeux identifiés, plusieurs recommandations peuvent être formulées pour un encadrement équilibré du financement par des tiers en arbitrage[82] :
Recommandation 1 : Obligation de divulgation. Instaurer une obligation claire de divulgation de l’existence d’un accord de financement et de l’identité du financeur, applicable dès le début de la procédure et de manière continue. Cette divulgation devrait être faite au tribunal arbitral, aux co-arbitres, aux parties adverses et, le cas échéant, à l’institution arbitrale[83].
Recommandation 2 : Limites de la divulgation. La divulgation devrait se limiter à l’existence et à l’identité du financeur, sans exiger la révélation des termes commerciaux de l’accord de financement (montant investi, pourcentage de rémunération), afin de préserver la confidentialité commerciale légitime[84].
Recommandation 3 : Gestion des conflits d’intérêts. Adopter des protocoles stricts pour identifier et gérer les conflits d’intérêts potentiels entre arbitres et financeurs, en s’inspirant des Lignes directrices IBA 2024. Les arbitres devraient avoir l’obligation de vérifier l’existence de liens avec les financeurs divulgués[85].
Recommandation 4 : Protection de l’indépendance de l’avocat. Établir des règles déontologiques claires interdisant :
- La représentation simultanée du financeur et du client par le même avocat ;
- L’intérêt financier direct de l’avocat dans le fonds de financement ;
- La subordination des décisions stratégiques du client aux volontés du financeur[86].
Recommandation 5 : Préservation du secret professionnel. Clarifier que la divulgation d’informations au financeur doit respecter le secret professionnel de l’avocat et que toute transmission d’information doit être autorisée par le client et limitée aux informations strictement nécessaires[87].
Recommendation 6: Encadrement de la security for costs. Établir des principes directeurs pour l’octroi d’une security for costs en présence de TPF, évitant à la fois l’octroi systématique (qui annulerait le bénéfice du financement) et le refus systématique (qui exposerait injustement la partie adverse)[88].
Recommandation 7 : Allocation des coûts. Développer une jurisprudence cohérente sur la récupérabilité des frais de financement, en distinguant entre :
- Les frais directs d’arbitrage (toujours récupérables) ;
- Les frais d’avocat (récupérables dans la mesure du raisonnable) ;
- Les frais de financement proprement dits (à évaluer au cas par cas selon des critères objectifs)[89].
Recommandation 8 : Qualification professionnelle des financeurs. Envisager, à terme, un système de qualification ou d’agrément des financeurs, garantissant leur capacité financière, leur intégrité et leur adhésion à un code de conduite professionnelle[90].
Les recommandations formulées, centrées sur l’obligation de divulgation limitée à l’identité du financeur, le respect strict de l’indépendance de l’avocat et de l’arbitre, et l’encadrement des mécanismes de coûts (récupérabilité, security for costs), dessinent un cadre normatif idéal pour le TPF. Cet ensemble de mesures, combinant hard law (législations nationales) et soft law (règlements institutionnels), est la condition sine qua non pour que le financement par des tiers soit durablement accepté, non pas comme une menace, mais comme un outil performant au service de la justice arbitrale.
L’analyse de l’impact du TPF sur la procédure arbitrale a confirmé que, si le financement par des tiers introduit des risques procéduraux réels (influence stratégique, incertitude sur la récupérabilité des frais, besoin accru de security for costs), ces risques sont largement gérables par un encadrement normatif adéquat. Les modèles législatifs (Singapour/Hong Kong) et les évolutions des règlements institutionnels (CCI/CIRDI) convergent vers un même principe directeur : la transparence contrôlée. Le TPF représente une innovation irréversible et nécessaire pour l’accès à la justice dans un contexte d’arbitrage coûteux. Le défi pour l’avenir est de s’assurer que sa légalisation ne soit pas synonyme d’une commercialisation excessive du procès, mais qu’elle soit subordonnée à la primauté des principes éthiques et déontologiques qui garantissent la confiance dans l’arbitrage international.
CONCLUSION
Le financement par des tiers en arbitrage international constitue une innovation financière majeure qui répond à un besoin réel d’accès à la justice arbitrale dans un contexte de coûts procéduraux croissants. Cette étude a démontré que, malgré les prohibitions historiques du champerty et du pacte de quota litis, le TPF peut être considéré comme juridiquement légitime dans la mesure où il se distingue fondamentalement de ces pratiques prohibées par sa structure tripartite et sa nature sui generis.
Toutefois, la légitimité juridique du TPF ne saurait occulter les défis déontologiques et procéduraux qu’il soulève. L’analyse a révélé trois tensions fondamentales :
Premièrement, la tension entre l’indépendance professionnelle et l’influence économique. Les avocats et arbitres doivent préserver leur indépendance et leur impartialité tout en évoluant dans un environnement où un tiers financier poursuit des objectifs de rentabilité. Cette tension peut être gérée par des règles déontologiques claires et des mécanismes de divulgation robustes.
Deuxièmement, la tension entre confidentialité et transparence. L’arbitrage repose traditionnellement sur un principe de confidentialité, tandis que la prévention des conflits d’intérêts exige une transparence accrue concernant l’identité des financeurs. L’équilibre doit être trouvé en limitant la divulgation à l’existence et à l’identité du financeur, sans exiger la révélation des termes commerciaux de l’accord.
Troisièmement, la tension entre l’accès à la justice et l’équité procédurale. Le TPF facilite l’accès à l’arbitrage pour les parties aux ressources limitées, mais peut créer un déséquilibre procédural si la partie adverse est exposée à des risques accrus sans protection adéquate. Des mécanismes comme la security for costs, appliqués de manière nuancée, peuvent contribuer à rétablir cet équilibre.
L’analyse comparative des différents modèles réglementaires (Singapour, Hong Kong) et des instruments normatifs récents (Lignes directrices IBA 2024, Règlement ICC 2021, Règlement ICSID 2022, Guidelines CIArb 2025) révèle une convergence progressive vers un consensus international sur certains principes fondamentaux :
- Reconnaissance de la licéité du TPF en arbitrage international ;
- Obligation de divulgation de l’existence et de l’identité du financeur ;
- Prise en compte du TPF dans l’analyse des conflits d’intérêts ;
- Protection de l’indépendance des avocats et des arbitres ;
- Respect de la confidentialité des termes commerciaux de l’accord de financement.
Pour l’espace OHADA, cette étude plaide en faveur d’une clarification normative progressive, combinant éventuellement une révision de l’Acte uniforme de 2017, l’adoption de directives par la CCJA et la modification du Règlement d’arbitrage de la CCJA. Un tel cadre réglementaire harmonisé contribuerait à renforcer l’attractivité de l’arbitrage OHADA et à faciliter l’accès à la justice pour les opérateurs économiques africains.
En définitive, le financement par des tiers n’est ni une panacée ni une menace existentielle pour l’arbitrage international. C’est un outil financier qui, correctement encadré par des règles transparentes et des principes déontologiques solides, peut contribuer positivement à la démocratisation de l’accès à la justice arbitrale tout en préservant l’intégrité et la légitimité du processus arbitral. L’hypothèse de recherche initiale est donc confirmée : le TPF constitue un mécanisme légitime à condition qu’un cadre normatif approprié soit établi.
Les perspectives de recherche futures pourraient utilement porter sur :
- L’analyse empirique de l’impact du TPF sur les taux de succès et les montants alloués dans les sentences arbitrales ;
- L’étude comparative de l’efficacité des différents modèles réglementaires nationaux ;
- L’analyse de la jurisprudence arbitrale émergente sur l’allocation des coûts de financement ;
- L’évaluation de l’impact du TPF sur l’équilibre entre pays développés et pays en développement dans l’arbitrage d’investissement.
Par Président OBAMBI Wilfrid Vivien
Magistrat et Conseiller à la Cour d’Appel de Dolisie (Congo). Ancien Juge au Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire, il a également exercé la fonction de Président du Tribunal du travail de Pointe-Noire.
Il est par ailleurs Secrétaire adjoint du Réseau Africain des Magistrats de Propriété Intellectuelle (RAMPI), ainsi que Secrétaire chargé des affaires administratives, juridiques et du contentieux du Réseau des Experts en Propriété Intellectuelle du Congo (REPIC).
Enfin, il figure sur la liste des médiateurs neutres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
Linkedin : https://linkedin.com/in/wilfrid-vivien-obambi
[1] Gary B. BORN, International Commercial Arbitration, 3e éd., Wolters Kluwer, 2021, pp. 1-45.
[2] Club des juristes, Financement de l’arbitrage par un tiers. Rapport du groupe de travail, février 2014, p. 7.
[3] Vanina FRIGNATI, « Ethical implications of third-party funding in international arbitration », Arbitration International, vol. 32, n° 3, 2016, p. 506.
[4] Khaled MECHANTAF, Financement de l’arbitrage par un tiers: une approche française et internationale, Thèse de doctorat, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2019, pp. 45-78.
[5] Yihua CHEN, Third-Party Funding in International Arbitration: A Transnational Study of Ethical Implications and Responses, Thèse de doctorat, Université Erasmus de Rotterdam, 2022, pp. 15-32.
[6] Thibault DE BOULLE, Third-Party Funding in International Commercial Arbitration, Mémoire de Master, Université de Gand, 2014, p. 118.
[7] International Bar Association, IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, approuvées par le Conseil de l’IBA, 25 mai 2024.
[8] Chambre de Commerce Internationale, Règlement d’arbitrage de la CCI, 1er janvier 2021, article 11(7).
[9] ICSID, ICSID Arbitration Rules, en vigueur le 1er juillet 2022, Rule 14.
[10] CNUDCI, Possible reform of investor-State dispute settlement (ISDS): Third-party funding, Document de travail A/CN.9/WG.III/WP.172, 2019.
[11] Club des juristes, op. cit., note 2, pp. 12-15.
[12] Ibid., pp. 13-14.
[13] Code civil français, article 1102.
[14] Université de Liège, Le financement par des tiers en arbitrage international, Travail universitaire, 2016-2017, pp. 28-32.
[15] Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, OHADA, Conakry, 23 novembre 2017.
[16] Khaled MECHANTAF, op. cit., note 4, pp. 95-142.
[17] Robert HOWIE et Garth MOYSA, « Financing disputes: Third-party funding in litigation and arbitration », Alberta Law Review, vol. 57, n° 2, 2019, pp. 492-495.
[18] Factortame Ltd and Others v. Secretary of State for Transport [1991] 1 AC 603 (House of Lords).
[19] Civil Law (Amendment) Act 2017, Singapour, Act No. 2 of 2017; Civil Law (Third-Party Funding) Regulations 2017, S 68/2017.
[20] Arbitration and Mediation Legislation (Third Party Funding) (Amendment) Ordinance 2017, Hong Kong, Ordinance No. 6 of 2017.
[21] Barreau de Paris, Le financement par un tiers en matière d’arbitrage – Rapport de la Commission Arbitrage, février 2017, pp. 18-20.
[22] Club des juristes, op. cit., note 2, pp. 16-18.
[23] Ibid., pp. 19-22.
[24] Ibid., pp. 54-56.
[25] Ibid., p. 55.
[26] Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, op. cit., note 15.
[27] Yihua CHEN, op. cit., note 5, pp. 145-187.
[28] Barreau de Paris, op. cit., note 21, p. 28.
[29] Club des juristes, op. cit., note 2, pp. 25-27.
[30] Ordre des Barreaux Flamands, Aanbevelingen over third party funding in arbitragezaken, 2023, p. 7.
[31] Barreau de Paris, op. cit., note 21, p. 30.
[32] Vanina FRIGNATI, op. cit., note 3, pp. 515-520.
[33] Université de Liège, op. cit., note 14, pp. 52-58.
[34] CNUDCI, op. cit., note 10, p. 12.
[35] Barreau de Paris, op. cit., note 21, p. 32.
[36] Ordre des Barreaux Flamands, op. cit., note 30, p. 9.
[37] Thibault DE BOULLE, op. cit., note 6, pp. 78-82.
[38] Yihua CHEN, op. cit., note 5, pp. 189-245.
[39] Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, New York, 10 juin 1958, article V(1)(d).
[40] CNUDCI, op. cit., note 10, p. 8.
[41] Université de Liège, op. cit., note 14, pp. 62-67.
[42] Kelsie MASSINI, « The Increasing Use of Third Party Funders in International Arbitration », Penn State Journal of Law & International Affairs, vol. 7, n° 1, 2019, pp. 335-340.
[43] IBA, IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, op. cit., note 7.
[44] Ibid., General Standard 7(a), p. 12.
[45] Ibid., Explanation to General Standard 6(b), p. 11.
[46] Muhammet Çap & Sehil Inşaat Endustri ve Ticaret Ltd. Sti. V. Turkmenistan, ICSID Case No. ARB/12/6, Décision sur la compétence, 13 février 2015.
[47] Kelsie MASSINI, op. cit., note 42, pp. 345-352.
[48] Elena V. SITKAREVA, Yulia A. ARTEMYEVA et Svetlana MENDOSA-MOLINA, « Third-party Funding: Practical, Ethical and Procedural Issues », in Integration and Clustering for Sustainable Economic Growth, Springer, 2019, pp. 188-190.
[49] CNUDCI, op. cit., note 10, p. 14.
[50] Université de Liège, op. cit., note 14, pp. 72-76.
[51] Club des juristes, op. cit., note 2, pp. 28-30.
[52] Barreau de Paris, op. cit., note 21, p. 30.
[53] Sebastian BATIFORT, Matthew HARWOOD et Chrystalla TRAHANAS, « Third-party funding: security for costs and other key issues », Transnational Dispute Management, vol. 14, n° 5, 2017, pp. 1-3.
[54] Gary B. BORN, op. cit., note 1, pp. 3645-3702.
[55] Essar Oilfields Services Limited v. Norscot Rig Management Pvt Limited, Award on Costs, 2016, paras. 35-42.
[56] Sebastian BATIFORT et al., op. cit., note 53, pp. 8-12.
[57] Essar Oilfields, op. cit., note 55.
[58] Sebastian BATIFORT et al., op. cit., note 53, pp. 10-11.
[59] Ibid., pp. 3-8.
[60] Gary B. BORN, op. cit., note 1, pp. 2948-2965.
[61] Sebastian BATIFORT et al., op. cit., note 53, p. 5.
[62] South American Silver Limited v. Bolivia, PCA Case No. 2013-15, Sentence sur la compétence, 18 novembre 2016, paras. 155-178.
[63] Robert HOWIE et Garth MOYSA, op. cit., note 17, pp. 510-512.
[64] Khaled MECHANTAF, op. cit., note 4, pp. 285-328.
[65] Civil Law (Amendment) Act 2017, op. cit., note 19 ; Civil Law (Third-Party Funding) Regulations 2017, op. cit., note 19.
[66] Arbitration and Mediation Legislation (Third Party Funding) (Amendment) Ordinance 2017, op. cit., note 20.
[67] Khaled MECHANTAF, op. cit., note 4, pp. 310-325.
[68] Thibault DE BOULLE, op. cit., note 6, pp. 105-112.
[69] Yihua CHEN, op. cit., note 5, pp. 247-298.
[70] ICC, Règlement d’arbitrage de la CCI, op. cit., note 8, article 11(7).
[71] Kelsie MASSINI, op. cit., note 42, pp. 352-355.
[72] ICSID, ICSID Arbitration Rules, op. cit., note 9, Rule 14.
[73] CNUDCI, Groupe de travail III, Draft provisions on procedural and cross-cutting issues, Document A/CN.9/WG.III/WP.253, 2023, pp. 28-32.
[74] IBA, IBA Guidelines, op. cit., note 7, Introduction, paras. 2-3.
[75] Ibid., Explanation to General Standard 6(b), p. 11.
[76] Kelsie MASSINI, op. cit., note 42, pp. 345-357.
[77] CIArb, Guideline on Third-Party Funding, 2025.
[78] Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, op. cit., note 15.
[79] OHADA, disponible sur : https://www.ohada.org
[80] Analyse développée par l’auteur sur la base des modèles comparatifs étudiés.
[81] Ibid.
[82] Synthèse des recommandations formulées par le Club des juristes, le Barreau de Paris, l’Ordre des Barreaux Flamands et les travaux de la CNUDCI.
[83] IBA, IBA Guidelines, op. cit., note 7, General Standard 7(a).
[84] Club des juristes, op. cit., note 2, pp. 48-50.
[85] IBA, IBA Guidelines, op. cit., note 7, Explanation to General Standard 6(b).
[86] Ordre des Barreaux Flamands, op. cit., note 30, pp. 7-10.
[87] Barreau de Paris, op. cit., note 21, pp. 32-35.
[88] Sebastian BATIFORT et al., op. cit., note 53, pp. 12-15.
[89] Gary B. BORN, op. cit., note 1, pp. 3680-3702.
[90] Civil Law (Third-Party Funding) Regulations 2017 (Singapour), op. cit., note 19, Regulations 4-6.