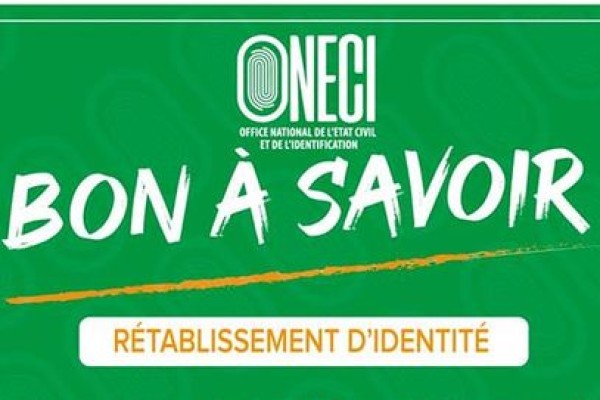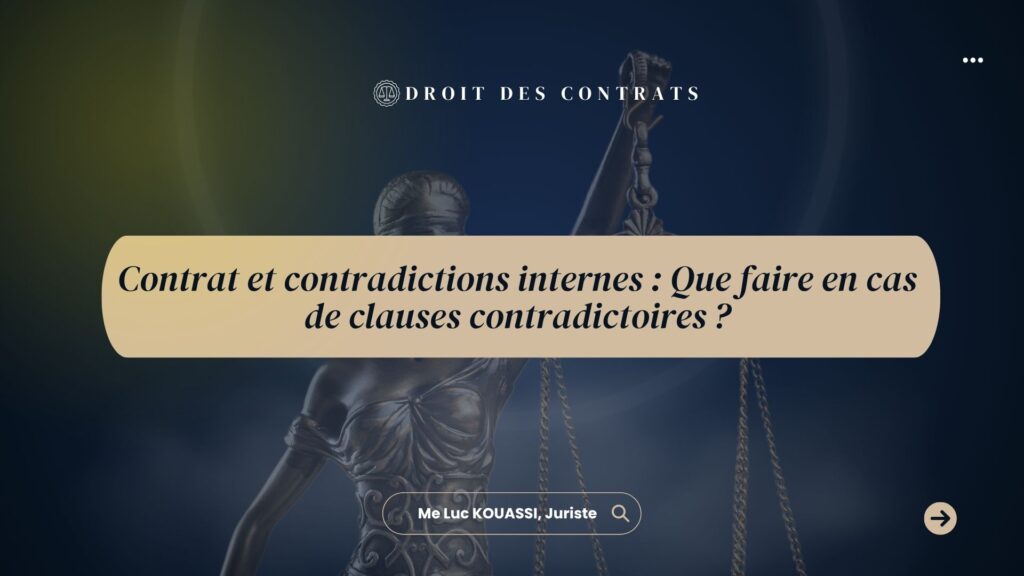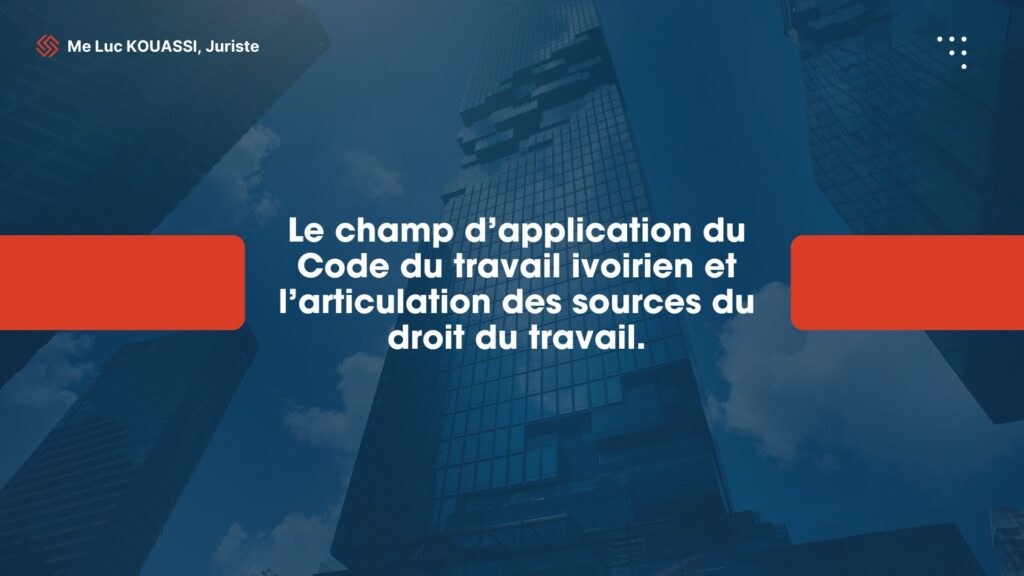
Le Code du travail ivoirien[1] constitue l’ossature juridique qui encadre les relations professionnelles dans le pays. Sa compréhension, tant dans sa portée spatiale et matérielle que dans son articulation avec d’autres sources, est indispensable à tout praticien, étudiant, salarié, employeur ou consultant RH désireux d’appréhender la régulation du travail en Côte d’Ivoire.
I. Le champ d’application territorial et personnel du Code du travail ivoirien
Le Code du travail ivoirien s’applique à l’ensemble du territoire de la République de Côte d’Ivoire, sans distinction de région, de localité ou de situation administrative[2]. Il constitue ainsi un texte à vocation nationale, garantissant l’uniformité des règles du travail sur tout le territoire. Cependant, il arrive que des salariés soient temporairement employés en Côte d’Ivoire alors que leur lieu habituel d’exécution de contrat se trouve à l’étranger. À cet égard, l’article 1er alinéas 3 et 4 introduit une règle de droit international privé de grande simplicité : tout contrat de travail exécuté de façon occasionnelle en Côte d’Ivoire est régi par le Code du travail ivoirien[3]. Autrement dit, même si le contrat a été conclu à l’étranger, dès lors qu’il s’exécute temporairement en Côte d’Ivoire, ses clauses et modalités doivent respecter la législation ivoirienne.
Cependant, la loi prévoit une exception notable à ce principe. Les travailleurs détachés (appelés « déplacés » par le législateur) en contrat à durée indéterminée, mais exécutant une mission temporaire n’excédant pas trois mois en Côte d’Ivoire, ne sont pas soumis aux règles du Code du travail ivoirien[4]. Ce régime particulier se justifie par le caractère éphémère de leur mission, qui ne crée pas un rattachement suffisant à l’ordre juridique national.
S’agissant de son champ matériel, le Code du travail régit les relations entre employeurs et salariés nées du contrat de travail. La loi définit le travailleur ou salarié comme « toute personne physique qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur »[5]. Cette définition classique met en avant la notion de subordination juridique, considérée comme le critère déterminant du salariat. La subordination implique que l’employeur exerce un pouvoir de direction et de contrôle sur l’activité du travailleur, lui donnant des ordres, directives et instructions, tout en sanctionnant ses fautes éventuelles[6].
Il est important de noter que ni le statut juridique de l’employeur, ni celui du salarié n’a d’incidence sur la qualification de contrat de travail[7]. Ainsi, peu importe que l’employeur soit une société anonyme, une ONG, une personne physique exerçant en nom propre ou même une administration publique pour ce qui concerne ses agents contractuels. De la même manière, le statut social, administratif ou fiscal du travailleur n’a pas d’impact sur sa qualification en qualité de salarié, dès lors qu’il existe un lien de subordination.
Cependant, cette généralité souffre d’une exception majeure : le Code du travail ne s’applique pas aux personnes nommées dans un emploi permanent au sein d’une administration publique[8]. Ces agents relèvent plutôt de la législation relative à la fonction publique. De plus, les travailleurs employés au service de l’État ou des personnes morales de droit public, et qui bénéficient d’un statut particulier, échappent partiellement au Code du travail, dans la limite des dispositions de leur statut et des principes généraux du droit administratif[9].
La loi de 2015 réaffirme également que son champ personnel concerne tous les salariés du secteur privé sans aucune distinction de sexe, de race ou de nationalité[10]. Cette précision traduit l’attachement du législateur ivoirien aux principes d’égalité et de non-discrimination, piliers essentiels du droit du travail moderne. Toutefois, l’application du Code est partielle pour certaines catégories comme les apprentis et les personnes en insertion professionnelle, encadrées spécifiquement aux articles 13.1 à 13.22 du Code du travail[11].
II. Le principe de faveur : fondement protecteur du droit du travail ivoirien
Un autre point fondamental réside dans l’articulation du Code avec les autres sources du droit du travail, notamment les conventions collectives, les décisions unilatérales de l’employeur, les contrats individuels et les usages professionnels. Les articles 8 et 9 consacrent ici le principe de faveur, pilier du droit social. Ils disposent que, sauf dérogation expresse, les dispositions du Code du travail sont d’ordre public[12]. Ainsi, toute clause, convention ou décision unilatérale qui viendrait à prévoir des conditions moins favorables que celles prévues par le Code est réputée nulle de plein droit[13].
Toutefois, le principe d’ordre public social n’interdit pas aux employeurs ou aux conventions collectives d’accorder des droits plus favorables aux travailleurs. Bien au contraire, la logique protectrice du droit du travail encourage l’adoption de garanties supplémentaires. Ainsi, une entreprise peut décider d’octroyer un congé de maternité plus long que celui prévu par le Code, ou d’instaurer une prime de rendement plus avantageuse que celle fixée dans la convention collective. Dans ce cas, la norme la plus favorable s’applique au salarié[14].
De plus, la loi de 2015 a pris soin de préserver les avantages acquis par les travailleurs avant son entrée en vigueur. Les salariés qui bénéficiaient déjà de droits ou garanties supérieurs en vertu d’un contrat, d’une convention collective, d’un accord d’établissement ou d’une décision unilatérale continuent à en bénéficier pendant la durée d’application de ces avantages[15]. Ce mécanisme garantit une sécurité juridique et sociale aux travailleurs, en évitant que la réforme du Code du travail n’entraîne une réduction des acquis sociaux antérieurs.
III. Conclusion générale
Ainsi, le Code du travail ivoirien présente un champ d’application étendu, tant sur le plan territorial que personnel et matériel. Son articulation avec les autres sources juridiques se fait sous l’empire du principe de faveur, traduisant la vocation éminemment protectrice du droit social. Toute pratique qui méconnaîtrait ces principes essentiels serait sanctionnée par la nullité et exposerait l’employeur à un contentieux potentiellement lourd. En définitive, cette architecture normative vise un objectif clair : assurer aux travailleurs de Côte d’Ivoire un cadre juridique stable, protecteur et conforme aux standards internationaux du travail.
Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le Cabinet LDJ SARL : (+225) 27 23 23 21 64 / 01 52 90 45 19 / 05 96 11 90 94 / 07 05 06 67 04 (WhatsApp)
Achetez le Kit du travailleur (Guide pour connaître tous ses droits en tant que travailleur) au prix de 35500 FCFA en suivant ce lien : https://cabinetldjsarl.com/formation/kit-du-travailleur-guide-pour-connaitre-tous-ses-droits-en-tant-que-travailleur/
Me Luc KOUASSI
Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Spécialiste en rédaction de contrats, d’actes extrajudiciaires, d’articles juridiques et des questions relatives au droit du travail | Politiste | Bénévole humanitaire.
denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28
[1] Loi n° 2015‑532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail ivoirien.
[2] Article 1er, alinéa 1, Code du travail ivoirien.
[3] Article 1er, alinéas 3 et 4, Code du travail ivoirien.
[4] Ibid.
[5] Article 2, alinéa 1, Code du travail ivoirien.
[6] TIA, Lucien, Traité de droit du travail ivoirien, L’Harmattan Côte d’Ivoire, 2019, p. 14.
[7] Article 2, alinéa 2, Code du travail ivoirien.
[8] Article 2, dernier alinéa, Code du travail ivoirien.
[9] Ibid.
[10] Ibid.
[11] Articles 13.1 à 13.22, Code du travail ivoirien.
[12] Articles 8 et 9, Code du travail ivoirien.
[13] Ibid.
[14] DAOUDA, Kouakou, Le droit du travail ivoirien commenté, Les Classiques Africains, Abidjan, 2018, p. 52.
[15] Article 9, Code du travail ivoirien.